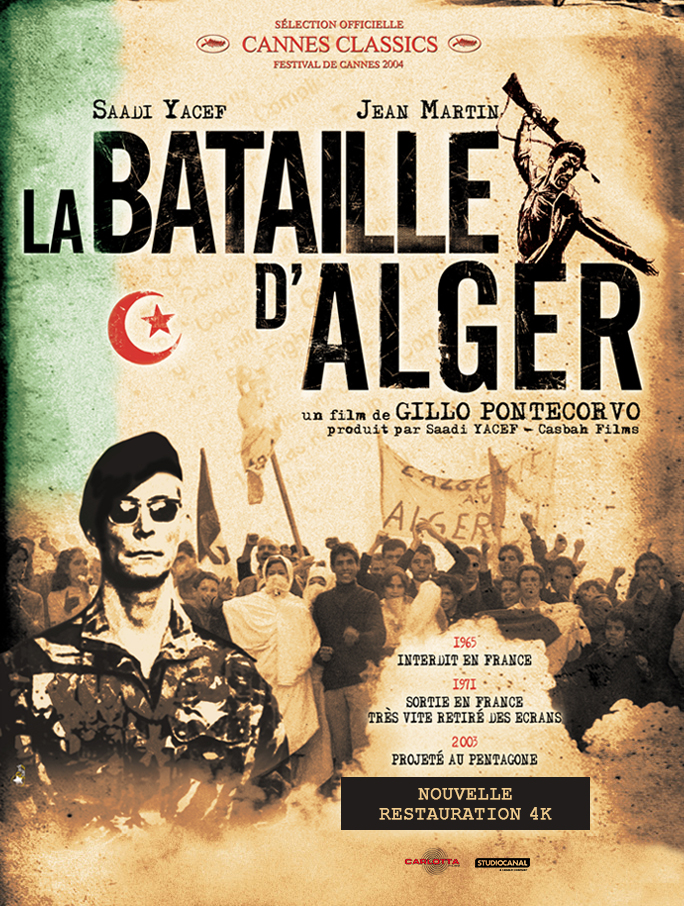Algérie, communauté algérienne, transferts – $1,7 MM : Le transfert des algériens vers leur pays
LA COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE À L’ÉTRANGER NE TRANSFÈRE QUE 1,7 MILLIARD DE DOLLARS
Les fonds perdus de la diaspora
Selon un rapport de la Banque mondiale, les transferts d’argent de la diaspora algérienne demeurent négligeables. En 2021, ils ont stagné autour de 1,7 milliard de dollars, alors que pour les pays de la région, ils ont connu une hausse considérable, notamment pour l’Égypte avec 33 milliards de dollars.
Les envois d’argent des migrants vers l’Algérie devraient légèrement augmenter cette année. C’est ce qui ressort de la dernière note d’information de la Banque mondiale sur les migrations et le développement. Les envois de fonds officiellement enregistrés vers l’Algérie devraient atteindre 1,759 milliard de dollars en 2021 contre 1,7 milliard de dollars l’année dernière, soit une hausse de près de 3,5%. Ils ne représentent que 1,1% du produit intérieur brut. Un niveau jugé très faible, il y a quelques jours par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.
Lors des travaux de la conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires algériennes, organisée au Palais des nations au Club-des-Pins (Alger), le Premier ministre avait estimé que le montant des transferts de devises de l’émigration ne reflète pas les capacités de la communauté algérienne établie à l’étranger. L’Algérie, a-t-il constaté, “ne bénéficie que très peu des transferts de fonds de la communauté algérienne à l’étranger”.
Comparés à d’autres pays de la région, les envois de fonds de la diaspora algérienne, notamment ceux qui empruntent les voies officielles et bancaires, paraissent, en effet, “faibles”.
La note d’information de la Banque mondiale indique que les envois de fonds vers les pays en développement de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord devraient avoir augmenté d’environ 9,7% en 2021 pour atteindre 62 milliards de dollars, grâce au retour à la croissance dans les pays d’accueil de l’Union européenne (France et Espagne notamment) et à la flambée des prix mondiaux du pétrole qui a eu un impact positif sur les pays du CCG.
Cette hausse est due aussi à la forte progression des flux entrant vers l’Égypte (12,6%, soit 33 milliards de dollars) et vers le Maroc (25%, soit 9,3 milliards de dollars), les migrations de retour et de transit jouant – respectivement – un rôle important dans ces résultats favorables.
Les envois de fonds vers le Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) ont fait un bond de 15,2% du fait de la croissance de la zone euro. En revanche, les flux se sont ralentis dans plusieurs pays en 2021 : Jordanie (-6,9%), Djibouti (-14,8%) et Liban (-0,3%).
“Pour les pays en développement de la région Mena, les transferts d’argent constituent depuis longtemps la principale source de ressources extérieures, devant l’APD, l’IDE et les flux de placement et d’endettement. Les perspectives pour 2022 sont celles d’une progression plus lente de 3,6%, en raison des risques liés à la Covid-19”, relève le document de la Banque mondiale.
Selon certains experts le niveau des transferts de fonds des émigrés vers l’Algérie est beaucoup plus important que celui capté par les statistiques de la Banque mondiale. Le circuit informel demeure un canal d’exécution privilégié pour l’envoi des fonds malgré l’amélioration des services financiers offerts par les banques.
Les lenteurs et les complications des procédures bancaires en Algérie poussent certains membres de la communauté algérienne établie à l’étranger à utiliser le circuit informel que le canal bancaire. Le gouvernement a annoncé, à maintes reprises, la possibilité d’ouvrir des succursales de banques publiques dans les pays d’accueil où il existe une forte communauté algérienne. Mais sur le terrain rien n’a été fait.
Lors des travaux de la conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires algériennes, le Premier ministre s’est attardé sur le rôle attendu de la communauté et des compétences nationales à l’étranger, le but étant “de renforcer leurs liens avec la nation et les impliquer effectivement dans tous les aspects liés au développement du pays, en prenant des mesures pratiques pour inciter les ressortissants algériens à investir dans des projets économiques et en les associant dans la stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures”.
Meziane RABHI
Liberté, 21/11/2021
#Algérie #Transferts #Communauté_algérienne #Devises