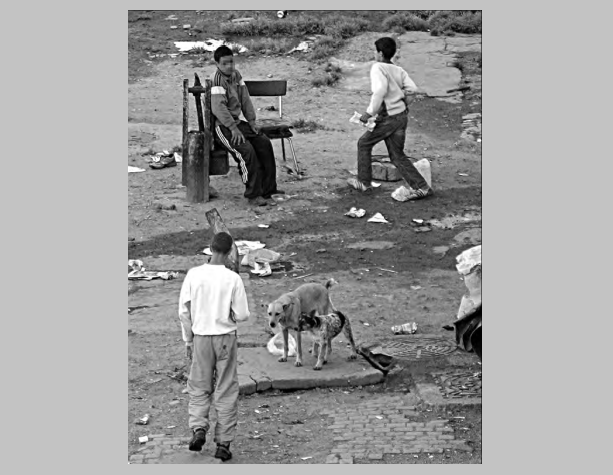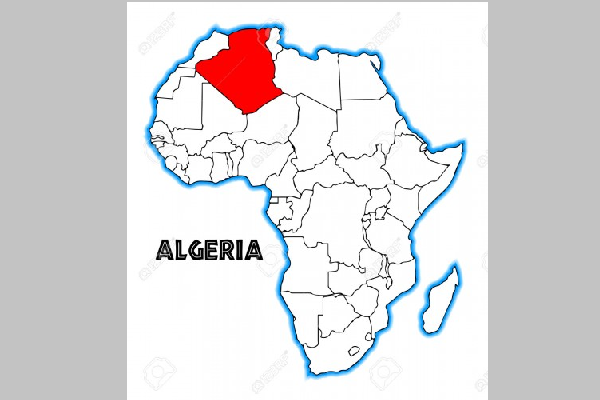Tags : Algérie, Rue de l’Emir Abdelkader – Algérie.- Une rue, une histoire
Après l’indépendance, la rue Carnot située entre la rue d’Isly et le boulevard Abdelhamid Benbadis change de nom et devient rue de l’Emir Abdelkader, en hommage au précurseur de la résistance algérienne et en remplacement du militaire et homme politique français Lazare Carnot. C’est une grande artère qui donnait accès, sur le côté-ouest de la ville, à l’ex-hôpital et la vieille mairie d’El-Asnam, et à l’opposé, du côté- est, à la cité administrative et la gare ferroviaire.
C’est une rue très animée, débordante de vie ; chaque mètre de route raconte l’histoire des hommes qui ont foulé ses larges trottoirs ombragés jalonnés de ficus impeccablement alignés. Avant le tremblement de terre, la rue desservait le quartier et l’entrée des groupes scolaires des sœurs Bedj, de Benbadis et El-Khawarizmi ; elle était animée par le souffle des âmes qui résidaient dans les modestes maisons et les HLM et par les nombreux lieux de commerces qui faisaient la prospérité de la ville. La rue rappelle aussi l’histoire inoubliable des douloureux événements de la guerre d’Algérie. En 1961 eut lieu un accrochage inégal sur ces lieux, engagé par les soldats français lourdement armés pour déloger deux valeureux moudjahidine El-Hadj M’Hamed et Si Allal, deux héros qui tomberont au champ d’honneur, les armes à la main. L’échange de tirs a duré toute une journée. Une stèle est érigée aujourd’hui en leur mémoire, tout près des lieux où ils ont succombé honorablement.
Rue mémorable, plus que centenaire qui a vu, lors du dernier tremblement de terre, plusieurs de ses bâtisses s’effondrer, emportant avec elles des dizaines d’innocentes victimes.
par Hamid Dahmani
———————————————————————-
Sedrata : l’«Atlantide» et la «Pompéi» du Sahara
Par sa position, son étendue, sa matérialité et ses symboliques multiples, le site archéologique de Sedrata (Wilaya de Ouargla) est significatif d’une construction historique qui remonte aussi loin que les royaumes médiévaux rostémide (VIIIe-XIXe siècles), ziride (Xe siècle), hammadite (XIe-XIIe siècles) et abdalwadide (XIIIe-XIVe siècles).
Cette construction participe de la compréhension du mode de structuration et d’administration de l’espace réticulaire algérien, fondé sur le commerce caravanier transsaharien. Une organisation en réseau autour des axes et points stratégiques, dans une logique de transferts et d’échanges.
Sedrata faisait partie du réseau des cités relais, qui liaient les grandes routes méridiennes, entre l’Afrique sahélienne et les pôles commerciaux du Nord du Maghreb (Sidjilmassa Touat – Ouargla – Ghadamès). Elle fut l’un des grands pôles économiques, un interface entre l’Afrique sahélienne et les pôles commerciaux méditerranéens.
Au commerce des esclaves, de l’or et du sel, qui garantissait le maintien et le développement de ces pôles d’échanges, s’est ajouté l’institution du pèlerinage, l’une des obligations de l’Islam, qui impulsa une nouvelle dynamique au commerce caravanier, donnant naissance à des recompositions à caractères religieux et culturel : le Touat-Gourara dominait le transect reliant Sijilmassa, Fès et Tlemcen à Gao et Tombouctou, et le M’zab et l’Oued Righ dominaient le reste du territoire, sous les influences successives Hammadides, Ibadites, Almohades et Hafsides.
Aux temps des royaumes médiévaux, c’est la trame réticulaire qui déterminait la structure géométrique du territoire algérien, au sens même de l’écosystème et qui maintenait en vie le flux commercial transsaharien, par un métabolisme ingénieux créé autour du dromadaire, du palmier et du savoir-faire de l’eau.
L’affaiblissement puis la ruine de ce métabolisme par le déplacement des itinéraires commerciaux transsahariens va démailler, de proche en proche, ces fils de tissu en réseau. Le changement orbitaire va enlever au Sahara sa fonction de centre de gravité et d’interface, pour lui conférer, désormais, la fonction de marge et d’extrémité.
L’historiographie médiévale du Maghreb-Sahara est dominée par les récits des premiers grands voyageurs arabes. El-Bakri (1040-1090), dans son «livre des routes et des royaumes», dessina les itinéraires commerciaux, qui aboutirent au Niger et à Blad es Soudan, en décrivant les us et coutumes des populations traversées. Il est le premier à avoir parlé des hommes voilés, dans un sentiment d’étonnement et d’effarement, nourrissant, des siècles plus tard, l’imaginaire occidental, en quête d’exotisme. Ibn Hawqal (943-988) parla avec émerveillement de Sidjilmassa et d’Aoudaghost, dans «la configuration de la terre». Il est le premier à avoir accédé au lac Tchad, pour atteindre le Fezzan. Il emprunta, depuis Ghadames, l’itinéraire transsaharien entre le Fezzan et le Hoggar, traversant l’Adrar des Ifoghas, pour rejoindre Gao et le fleuve Niger. Cette route était déjà tracée, depuis la préhistoire, alors que le Sahara était encore humide.
Ibn Battuta (1304-1377) est le géographe arabe qui a réalisé le plus long périple (24 ans), parcourant tout le Sahara, pour parvenir à La Mecque et au-delà jusqu’à l’Asie. C’est dans ses récits «Voyages» et «Divertissement de celui qui désire parcourir le monde» que sont portés les premiers jugements sur les us et coutumes des populations sahariennes. Léon l’Africain (1483-1552), (278) Al Idrissi (1100-1166) et Ibn Khaldoun (1342-1406) complétèrent ce corpus de données et informations, que les Occidentaux découvrirent des siècles plus tard, pour en extraire les substances, en déformer parfois et le plus souvent même le sens et la portée.
En quoi le site archéologique de Sedrata est déterminant dans la reconstitution de l’espace réticulaire médiéval et comment il a constitué un problème pour la France coloniale, dans sa théorie du «vide saharien» ?
Sedrata est le lieu d’une centralité, qui réalisa la jonction entre un versant méditerranéen et un versant sahélien ; une configuration géo-historique qui assurait la continuité nord-sud. Ce lieu de centralité est antithétique de la construction historique coloniale, qui a fait de la «pénétration saharienne» son œuvre exclusive, de parachèvement de l’ «œuvre romaine», d’où la nécessité d’un vide et d’un hiatus de justification et de légitimation.
Voici ce que déclarait, en 1961, l’un des négociateurs d’Evian, Mr Roland Cadet, à propos de la question sur le Sahara : «L’Algérie n’a jamais étendu sa souveraineté sur les territoires du Sahara. Ses occupants ou ses conquérants ne s’y sont jamais installés, qu’il s’agisse des Romains, des Vandales, des Byzantins, des Turcs. Les deux territoires [Algérie-Sahara] n’ont été réunis sous la même souveraineté qu’au moment où la France a occupé le Sahara. Il était alors une terre sans maître et aucun lien historique n’existait entre l’Algérie et le Sahara» (Sixième séance du mercredi 31 mai 1961, consacrée au Sahara (1961, p.106).
C’est au regard de cette théorie du vide que nous avons voulu revisiter le site archéologique de Sedrata, pour y saisir les mécanismes subtils de sa déconstruction et son déplacement, au fur et à mesure, de l’orbite du réel vers celui du mythe et de la légende des cités englouties : l’«Atlantide» et la «Pompei» du Sahara.
C’est également pour rendre un hommage à une grande dame d’origine suisse, Marguerite Van Berchem qui, au plus fort de la domination coloniale, avait milité avec vigueur pour la patrimonialisation du site archéologique de Sedrata, à travers sa protection et l’intégration de son mobilier dans les collections muséographiques algériennes.
Comment la France coloniale a tenté, sans y parvenir, à en réduire et à réorienter la portée de la découverte, dans son obstination à ancrer le concept du «vide saharien», qui justifierait et légitimerait la «pénétration française» du Sahara, ce que ni les Puniques, ni les Romains, ni les Byzantins, ni les Turcs n’ont pu réaliser ?
Le site archéologique de Sedrata a été révélé, en 1860, par Eugène Daumas, un lieutenant-colonel, nommé à la tête de la direction des affaires arabes par le maréchal Bugeaud. Il parlera de «débris d’une grande ville abandonnée que l’on nomme Sedrata…» (Pouillon, 2008).
En 1862, le commandant Colomieu, qui conduisait la colonne militaire sur la ville d’Ouargla, avait fait un constat de désolation de celle-ci : «délabrement de la ville», «abandon de nombreux puits» et «misère des populations». Il attribua le déclin de cette ville, «jadis prospère», à «l’oisiveté» et «l’indolence» de ses habitants (Colomieu, 1863). Avant lui, en 1860, l’explorateur Henri Duveyrier reconnaissait le rôle joué par cette dernière, en s’appuyant surtout sur les écrits d’Ibn Khaldoun, en expliquant son déclin par le détournement de la voie commerciale Agadez-Ouargla au profit des routes plus au sud par Kano et Katsina et au nord par Ghât, Ghadamès et El Oued.
Il concluait ainsi : «Aujourd’hui, Ouarglâ est une ville morte, et nul ne la ressuscitera…», suggérant qu’on «pourra en faire une excellente halte pour les caravanes» (Duveyrier, 1864). Ce désintérêt et ce renoncement seront vite rattrapés par les idées saint-simoniennes de «fécondation du désert», en faisant sortir les oasis du sable, pour élargir le «cercle de l’humanité».
En arrière fond de cette idée «généreuse» c’est le paradigme du «rail» qui est mis en oeuvre. Le rail fera, en effet, de Ouargla une station phare de l’itinéraire transsaharien. La mission saharienne de Duveyrier s’inscrivait, en effet, dans les grands projets saint-simoniens. L’Algerie était un lieu d’essai de grandes œuvres industrielles, portées essentiellement par des banquiers au service des Rothschild.
Le site archéologique de Sedrata se trouvait à une dizaine de km au sud d’Ouargla. Sa découverte allait servir un nouveau mythe, celui de la «cité perdue», l’«Atlantide» et la «Pompéi» du désert. Un mythe qui sera enveloppé dans une construction dichotomique arabo-berbère : «Ce pays était riche et ses habitants vivaient en paix. Puis les Arabes sont venus et il a été transformé en désert… Les musulmans ont tout détruit au nom du Dieu clément et miséricordieux, de même qu’en Amérique tout fut détruit plus tard par les chrétiens au nom du Dieu de paix et de charité». Un «Eldorado préislamique détruit par le zèle religieux, mais que l’effort civilisateur de la Métropole, détentrice des lumières de la raison positive, pourra faire revivre» (Victor Largeau, 1879).
Partant de cette imagerie dichotomique «arabe-berbère», le champ fut ouvert à des investigations tous azimuts, sur «Isedraten», la cité engloutie dans le sable, entre Ouargla, au Nord et la Gara Krima au Sud. Une course aux manuscrits et un travail laborieux d’enquêtes (sources orales) furent entrepris. Dans sa description du site, Victor Largeau a pu distinguer un site d’occupation humaine, perché sur les garas, qu’il attribua au «peuple des garas», il remonterait aux temps préhistoriques, et un autre lieu d’occupation, au fond de la vallée, où se situent les ruines de Sedrata : «Ceddrata, ville berbère détruite lors de l’invasion des Arabes nomades» (Largeau, 1879). Une légende rapporte à trois cent vingt-cinq (325) le nombre de «villages» établis le long de la vallée de l’oued Mya.
En 1881, Harold Tarry, inspecteur des Finances, avait envisagé de développer la culture du palmier dans la vallée «que les traditions nous représentent comme ayant été d’une fertilité merveilleuse, et que le génie dévastateur des Arabes a converti en un désert aride et brûlant». Il entreprit une fouille du site de Sedrata dans l’espoir de retrouver les sources qui avaient irrigué jadis tout cet espace. Il exhuma une mosquée, un «palais», neuf maisons, des éléments décors, ainsi que des structures hydrauliques. Il ne put poursuivre ses travaux, l’autorisation lui ayant été refusée par les bureaux arabes, qui le feront rappeler à Alger, suite à des plaintes déposées par les populations «indigènes» pour leurs droits historiques sur ce lieu, considéré comme sacré.
En 1898, un jeune érudit, Paul Blanchet, est dépêché par l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres et la Société de Géographie, pour examiner les éventuelles ressemblances du site de Sedrata avec celui de la Qala des Banî $ammâd de M’sila. Il s’intéressa, tout particulièrement, aux édifices religieux, le «palais» et la mosquée étaient déjà fouillés par H. Tarry. Il ajouta aux découvertes une maison «ornée d’arceaux et de colonnes».
Décédé prématurément, il ne laissera à la postérité que quelques articles et notices. Selon van Berchem, l’essentiel de ses documents aurait été égaré (1951). Son mérite est d’avoir inscrit le site de Sedrata dans l’Agenda du monde académique. Dans le «Manuel d’art musulman», l’architecte Henri Saladin avait placé Sedrata au même niveau que «Madînat al-Zahrâ», capitale califale de Baghdad (Saladin, 1907).
En 1926, Georges Marçais, alors Directeur du Musée des Antiquités algériennes et de l’Art musulman d’Alger, depuis 1920, avait repris la description des décors des salles du «palais» de Sedrata. Il plaça cet art entre les périodes Aghlabide et Fatimide, autour du Xe siècle (Album de pierre, plâtre et bois sculpté). Le jeune P. Blanchet avait déjà annoncé les couleurs, en liant les décors de Sedrata à l’art byzantin d’Afrique du Nord, durant l’antiquité tardive. Il niera toute relation avec l’art de l’Orient musulman (Blanchet, 1898).
C’est dans les arts berbères du textile et du bois, puisés d’anciens registres chrétiens, que les racines et les origines de Sedrata ont été recherchées (Saladin, 1907 ; Marçais, 1909-1926). Marçais poussera encore plus loin la comparaison, en trouvant des similitudes avec l’Égypte copte, l’Ifriqiya aghlabide et l’Iraq abbasside. Un mélange d’influences qui n’autoriserait pas l’originalité.
Entre 1942 et 1945, Louis Leschi, alors Directeur des Antiquités et des Beaux-Arts, particulièrement intéressé par le site de Sedrata, dépêcha une mission de fouille, qu’il confiera à un architecte, Maurice Faucher, qui alla au-delà de l’étude des édifices religieux, pour s’étendre aux zones à fonctions diverses (carrières, cimetières, jardins, autres structures construites). Interrompus par «manque de moyens», ses travaux ne donnèrent lieu à aucune publication.
En 1946, un personnage assez singulier va associer son nom à l’histoire du site de Sedrata, c’est Marguerite Van Berchem, la fille du célèbre épigraphiste et historien suisse, Max van Berchem, fondateur de l’épigraphie arabe, connu par ses principales œuvres le Corpus Inscriptionum Arabicarum, le Voen Syrie et des articles publiés dans les deux tomes d’Opera Minora.
On l’appelait la «Dame de Sedrata» ou «l’icône et la pasionaria de Sedrata», M. van Berchem était décrite sous le portrait d’un érudit orientaliste, un penchant qui aurait déteint sur son approche académique. Son ouvrage de synthèse «Sedrata, un chapitre nouveau de l’histoire de l’art musulman. Missions d’étude et campagnes de fouilles au Sahara, 1950-1956» ne sera jamais publié. Georges Marçais l’avait refusé en 1958, le considérant «trop onéreux». De ce qui est connu des travaux de la «Dame de Sedrata» est tiré des seuls articles, notices et carnets dont des inédits, conservés dans les archives personnelles de M. van Berchem à la Fondation van Berchem.
Ce qui retint, en premier lieu, l’attention de M. van Berchem, à la vue des fragments de stucs de Sedrata, déposés au Musée Stéphane Gsell d’Alger, en 1946, c’est leur ressemblance avec ce qu’elle connaissait déjà des stucs de la cité médiévale de Samarra en Irak (van Berchem, 1946). Elle consulta, d’abord, les travaux de G. Marçais (1909) et ses conclusions sur les analogies des stucs de Sedrata avec les motifs des premiers monuments chrétiens d’Afrique du Nord et les ornements sculptés sur les objets de bois de Kabylie. Encouragée par Louis Leschi, elle effectua sa première campagne de fouilles entre novembre 1950 et mars 1951, en mobilisant de gros moyens, puis une seconde campagne entre novembre 1951 et février 1952. Bien que finançant en grande partie sa mission, elle eut un grand soutien de l’Armée et tout particulièrement le bénéfice de deux campagnes de photographies aériennes, qui lui permirent d’avoir une vue d’ensemble du site archéologique.
Un mécène, Pierre Averseng, viticulteur, industriel féru de la photographie aérienne, lui finança la réalisation des clichés verticaux, pris à bord d’un «aviophote». Les ingénieurs du Service de la colonisation et de l’hydraulique s’y intéressèrent pour y retrouver le système de canalisation fossilisé par les sables.
Sans préjuger des raisons véritables de la non publication de son ouvrage de synthèse (1950-1956), M. van Berchem était suisse, sur un terrain de colonisation française, fermé au regard extérieur. Elle en était consciente et avait sa propre idée sur la colonisation française : «un petit royaume de polichinelle», disait-elle, «dans ce grand monde arabe qui gronde et se réveille» (van Berchem, 1951). C’est dans cette prédisposition mentale qu’elle reprendra le sujet de Sedrata, en le déplaçant sur l’orbite du patrimoine culturel et de la muséalisation, au moment même où se dessinaient, dans les laboratoires colonistes, les premières esquisses d’une nationalisation du Sahara et de sa séparation de l’Algérie.
En effet, par le corpus des connaissances et des documents qu’elle a compilés, elle s’érigea en défenseur du droit historique des populations ibadites sur le site de Sedrata. Bien introduite au milieu des notables d’Ouargla et du Mzab, qui lui livrèrent des informations sur leur passé et la relation filiale avec Tiaret, au travers de textes manuscrits et de témoignages oraux, elle emprunta la voie médiatique pour porter au loin les échos de la découverte (conférences, expositions et publications). Elle se déploiera dans plusieurs capitales méditerranéennes, tout particulièrement Alger (Documents algériens), Londres (The Illustrated London News) et Genève (la Tribune de Genève).
En 1953, à l’occasion d’une exposition à Ghardaïa, elle obtint des populations mozabites, «une donation de 47.500 francs», comme frais de participation au gardiennage et à la protection des vestiges de Sedrata (van Berchem, 1953). Ce sera le premier acte d’origine indigène, de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine culturel.
Mesurant la portée politique de cet acte, le Gouvernement Général d’Algérie a procédé, le 24 septembre 1954, au classement des ruines de la ville antique de Sedrata parmi les monuments historiques, dans la formulation suivante : «Sont classés parmi les monuments historiques, les ruines de la ville antique de Sedrata et ses annexes, sises sur des terrains domaniaux des tribus des Mekhadma et des Béni-Thour de l’Annexe d’Ouargla, à proximité de l’oasis d’Ouargla, et s’étendant sur une superficie de 420 ha…» (Arrêté de classement, septembre 1954). L’entreprise de van Berchem est remarquable voire impressionnante par le volume des objets en stuc qu’elle avait extrait des fouilles, mis en caisse et transféré au musée Stéphane Gsell d’Alger. A la mort de Louis Leschi, en janvier 1954, les objets de Serdrata devinrent encombrants; ils furent, pour l’essentiel, transférés à la Villa Laloé, devenue plus tard le musée de l’Enfant.
En mars 1955, van Berchem avait écrit au Directeur de l’Intérieur et des Beaux-Arts, M. Louis Berton, une lettre dans laquelle elle lui fit part de l’état de santé des stucs de Sedrata, dont voici un extrait : «Avant de quitter l’Algérie, à la fin de mars 1954… j’avais confié au Musée Stéphane Gsell deux caisses et quatre cartons contenant ce qu’il était le plus important de mettre en lieu sûr, c’est-à-dire les fragments d’inscriptions et les caractères coufiques détachés, qui n’avaient pu être encore inventoriés ni déchiffrés… Ainsi qu’il en avait été convenu avec Monsieur Marçais, ces caisses devaient rester en dépôt au Musée jusqu’à mon retour à Alger. À mon arrivée, ici, en janvier dernier, j’eus le regret de constater qu’elles avaient disparu…
Le même fait s’est reproduit à nouveau cette année où les caisses emballées par les Latapie et qui devaient être transportées après le départ de ceux-ci au Musée Stéphane Gsell sont restées abandonnées dans cette même cour jusqu’à mon arrivée, c’est-à-dire qu’elles ont été pendant plus de huit mois exposées à la pluie… Il semble donc que j’eusse été en droit d’attendre qu’un sort meilleur soit réservé à mes découvertes, non seulement à cause des six années d’efforts immenses qu’elles m’ont coûté, mais plus encore parce qu’elles font partie d’un patrimoine national qui aurait dû être respecté.».
Plus forts étaient ses propos prononcés lors d’une conférence, publiée dans la Tribune de Genève du 09 décembre 1961 : «On ne peut que regretter que le fruit de ce travail acharné en tout 60 caisses de reliefs ornant les chambres des demeures ait disparu sans presque laisser de trace. Il est clair que dans l’Algérie actuelle, il y a trop de personnes qui ont intérêt à passer sous silence l’apport culturel des habitants qu’ils ont colonisés. Cette politique ridicule de l’autruche se solde une fois de plus par l’anéantissement pur et simple de richesses qui devraient appartenir au patrimoine de l’humanité.».
Il faut attendre l’indépendance de l’Algérie pour voir les «plâtres sculptés» de Sedrata, de la collection M. van Berchem, exposés dans les salles d’art islamique du Musée national des Antiquités. En 1967, des panneaux de plâtres sculptés de Sedrata étaient accrochés aux murs de la Villa Laloé, qui deviendra Musée de l’Enfance. Une partie de ces plâtres, transférés au Louvre, devaient rejoindre ce Musée. En 1967, un timbre est dédié aux découvertes de Van Berchem, intitulé «fouilles de Sedrata». Il est dessiné par le célèbre miniaturiste algérien Mohammed Racim. En 1995, une autre série a célèbré les décors de stuc de Sedrata.
Le site de Sedrata et les nombreuses significations qu’il a introduites, ébranla tout l’édifice conceptuel fondé sur le «vide saharien», en apportant les réponses historiques et patrimoniales d’un ancrage méridien, qui exprime fortement la filiation d’une Algérie-Sahara.
Rappeler l’importance de ce site et la trame géoéconomique médiévale, au-delà de sa dimension historique et patrimoniale, invite aujourd’hui à repenser la fonction d’interface et le mode réticulaire de structuration du territoire algérien, qui a été d’abord effacé par un beylicat turc, fondé sur la «rente» de la course maritime et le contrôle de la navigation en Méditerranée, ensuite déstructuré par la colonisation française, qui s’est établie sur le territoire beylical, en plaçant le Sahara dans un régime spécial, celui des «Territoires du Sud». Un réexamen du Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) devant interroger cette dimension réticulaire d’organisation du territoire pour déterminer les véritables centralités.
par Dr Mourad Betrouni
Le Quotidien d’Oran, 16/11/2021
#Algérie #Oran #Bvd_Emir_Abdelkader