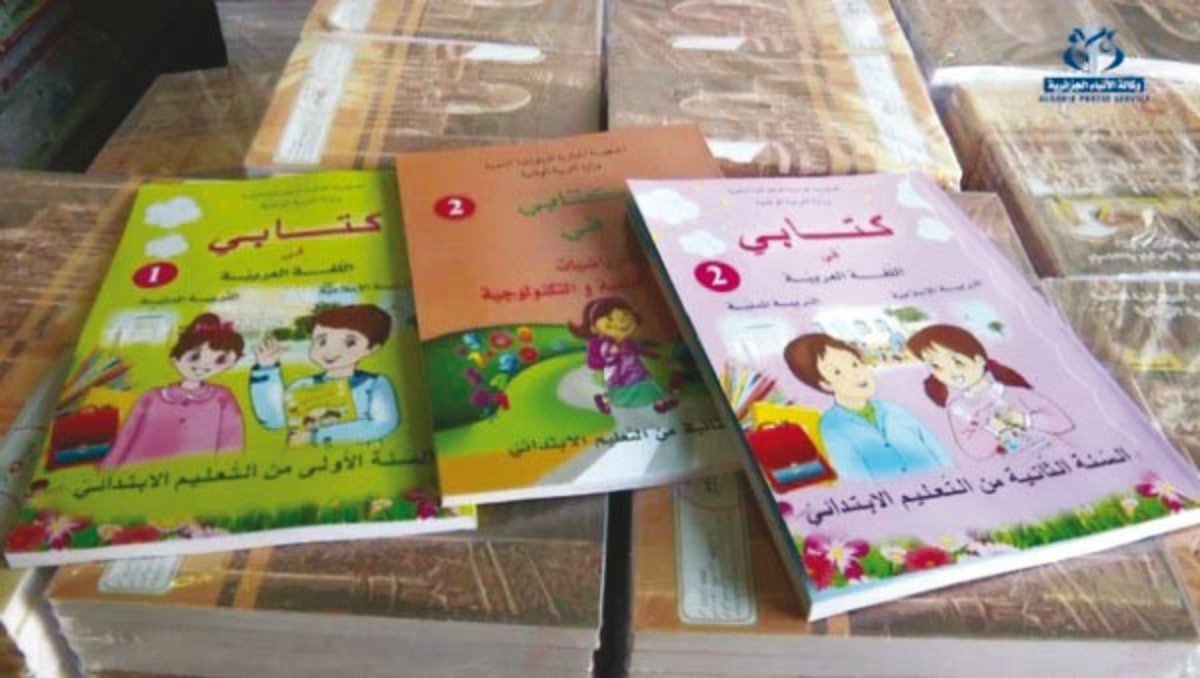Algérie, Maroc, armée, Sahel, Mali, Libye, Sahara Occidental, #Algérie, #Maroc,
La révision constitutionnelle de novembre 2020 établit les conditions d’une intervention extérieure de l’Armée nationale populaire, rompant avec une tradition de non-ingérence. Un changement doctrinal nécessaire pour Alger, qui traduit sa volonté de revenir au premier plan diplomatique
Le 24 août 2021, le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtane Lamamra annonçait la rupture des relations diplomatiques avec le royaume du Maroc.
Cet épisode n’est que le dernier en date d’un processus de redéploiement politique régional de l’Algérie, après plusieurs années d’effacement. Les derniers temps du règne d’un Abdelaziz Bouteflika malade et diminué avaient été synonymes d’une action diplomatique anémique pour un pays traditionnellement réputé pour son activisme international, notamment dans un rôle de médiateur éprouvé.
Ce retour au premier plan a été acté par la Constitution adoptée par référendum populaire le 1er novembre 2020, qui a opéré une rupture radicale avec le non-interventionnisme en vigueur jusqu’alors, un principe qui constituait un des piliers fondamentaux de la politique algérienne depuis son indépendance.
L’armée n’avait pas l’interdiction légale de franchir ses frontières mais les Constitutions de 1989 et 1996 insistaient sur une dimension territoriale du recours à la force.
L’Armée nationale populaire (ANP) s’est déjà engagée sur des théâtres extérieurs dans son histoire – notamment à l’occasion de la guerre des Sables contre le Maroc en 1963 ou des guerres israélo-arabes de 1967 et 1973 –, mais l’Algérie s’est, en règle générale, conformée à cette volonté de non-ingérence.
Désormais, le président Abdelmadjid Tebboune peut autoriser l’armée à participer à des missions hors des frontières du pays après l’approbation des deux tiers du Parlement, notamment dans le cadre des Nations unies, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes (articles 31 et 91 de la Constitution).
Certes, la constitutionnalisation des conditions d’intervention à l’étranger offre une « protection » pour l’armée, selon les déclarations d’un membre de l’état-major de l’ANP, mais elle officialise surtout un changement doctrinal qui vise à faire face aux défis régionaux et internes.
Instabilité en Tunisie et en Libye
Le pays fait face à un contexte sécuritaire dégradé sans précédent à ses frontières.
Dans les années 1990, la principale préoccupation dans ce domaine était interne, avec la lutte contre le terrorisme qui a en partie structuré la pensée sécuritaire étatique.
Aujourd’hui, l’Algérie est bordée d’un arc de crises touchant la quasi-intégralité de ses 7 000 kilomètres de frontières terrestres, qu’elle partage avec sept pays, si l’on inclut la République arabe sahraouie démocratique (RASD).
Comme l’explique Smail Djourhi, chercheur à l’université d’Alger 3, « cette situation inédite à travers l’histoire [de l’Algérie] suppose une adaptation de l’appareil militaro-sécuritaire et le dépassement des paradigmes de sécurité traditionnels adoptés depuis l’indépendance ».
À l’est, même la Tunisie, dont la révolution de 2011 fait pourtant figure d’exception pour son dénouement relativement pacifique, présente des facteurs d’instabilité. Aux crises politiques successives s’ajoutent une fragilité économique exacerbée par la crise du COVID-19 et la persistance de la menace terroriste.
Victime de plusieurs attaques meurtrières entre 2011 et 2016, la Tunisie a constitué le premier contingent de combattants étrangers dans les rangs du groupe État islamique (EI) en Syrie.
En Libye, une sortie de crise est esquissée avec la formation en mars 2021 d’un Gouvernement d’union nationalesous l’égide de l’ONU, mais l’ingérence de puissances étrangères et les affrontements entre milices maintiennent un niveau de risque élevé.
De plus, l’Algérie est en situation d’hostilité affichée avec l’un des principaux acteurs de la guerre civile libyenne, le maréchal Haftar, qui multiplie les provocations.
La guerre civile libyenne a, par ailleurs, été un des facteurs déstabilisateurs au Sahel, où l’afflux d’armes en provenance de l’arsenal de Mouammar Kadhafi a contribué à la formation de groupes armés.
La diplomatie algérienne a participé activement au règlement du conflit entre Bamako et les rebelles indépendantistes touarègues de la Coordination des mouvements de l’Azawad avec l’accord d’Alger de 2015, mais est depuis en retrait alors que l’insurrection, désormais menée par divers groupes extrémistes armés, se poursuit dans plusieurs pays de la zone.
Le Mali, le Tchad et la Mauritanie – voisins directs –, mais aussi le Burkina Faso, voire le Nigéria, ne semblent pas en mesure de lutter efficacement contre le terrorisme et d’enrayer la spirale de violence au sein même de leurs populations.
À l’ouest, les antagonismes entre Maroc et Algérie ne sont pas résolus, nourris notamment par la question sahraouie.
Les récentes évolutions, entre normalisation des relations du Maroc avec Israël en décembre 2020, révélations des pratiques d’espionnage marocaines à grande échelle grâce au logiciel israélien Pegasus, et accusations à l’encontre du Maroc pour son soutien supposé au Mouvement d’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé « terroriste » par les Algériens, ont fait monter la tension jusqu’à la rupture des relations diplomatiques.
Rééquilibrages politiques internes
Ainsi, cette révision constitutionnelle permet à l’Algérie d’opérer, selon Smail Djourhi, « la migration d’une doctrine réactive à une doctrine préemptive » et de faire une distinction « entre frontières géographiques et frontières sécuritaires qui autorise, si la situation l’exige, l’exécution d’opérations […] en dehors du territoire ».
En effet, ceinturée par des États défaillants ou hostiles, l’Algérie semble en partie contrainte par les événements d’adopter une nouvelle posture. Néanmoins, le contexte politique interne a pu également être favorable à cette prise de décision.
Abdelkrim Dekhakhena, chercheur à l’Université 8 Mai 1945 Guelma, justifie également ce changement de doctrine par les avantages que comporte la participation aux missions internationales de maintien de la paix : en matière de réputation, politique, influence et, surtout, sur le plan financier.
La rémunération offerte aux pays contributeurs de ces missions pourrait constituer pour l’Algérie une rentrée de devises bienvenue alors que les réserves de change s’amenuisent.
D’un point de vue plus politique, l’adoption d’une nouvelle Constitution devait marquer pour le pouvoir algérien la fin du processus enclenché par le hirak « béni », ainsi que le président Tebboune a décrit le mouvement déclenché en février 2019 en contestation du cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika et qui a amené à son renoncement.
Aux premiers temps du mouvement, le discours développé par les autorités lui rendait hommage : salutaires pour le pays, le départ voire l’emprisonnement de nombreux cadres de l’ère Bouteflika et l’élection présidentielle de décembre 2019 auraient dû, selon les gouvernants, suffire à satisfaire les exigences des protestataires.
Toutefois, les contestations demandant la fin du « système » n’ont pas cessé et sont depuis désavouées par le pouvoir.
Il peut donc paraître cohérent que le pouvoir politico-militaire se repositionne en s’investissant sur la politique extérieure, point fort traditionnel du pays, afin de donner le change face à une situation interne difficile.
Les accusations portées contre le Maroc pour son implication dans les incendies de Kabylie sont un exemple de l’utilisation de cette dialectique entre scènes nationale et internationale.
De plus, le hirak a constitué l’élément déclencheur d’une modification des rapports de force au sein des cercles du pouvoir, plus propices à une politique étrangère musclée.
Au cours de l’ère Bouteflika (1999-2019), le pouvoir a été en partie « retiré des mains de l’armée pour passer à celles des civils », comme l’explique le spécialiste des questions militaro-sécuritaires au Maghreb Flavien Bourrat. Sa mise à l’écart en mars 2019 a permis une purge des proches de l’ancien président, effectuée sous la supervision du chef d’état-major des armées, le général Gaïd Salah.
Le responsable militaire et le président Tebboune, élu en décembre 2019, avaient alors initié ce changement de politique régionale, ce dernier déclarant notamment vouloir « donner un nouvel élan au rôle de l’Algérie au niveau international […] en particulier sur les dossiers libyen et malien ».
Après la mort soudaine de Gaïd Salah d’une crise cardiaque en décembre 2019, son remplacement par le général-major Saïd Chengriha a intensifié cette reprise en main de l’armée.
Chengriha a participé à la guerre d’octobre 1973 contre Israël et dirigé la troisième région militaire de Béchar, l’une des plus sensibles pour sa position stratégique, face au Maroc et contiguë au Sahara occidental. Il soutient une position ferme dans ces dossiers.
Considéré comme un faucon en matière de politique étrangère, il dénonçait en août les complots visant l’Algérie « que l’armée saura contrecarrer ».
Il s’est imposé comme le nouvel homme fort du pays et sous son autorité, c’est cette fois-ci les responsables nommés par Gaïd Salah qui ont subi une vague de limogeages et d’arrestations. Les règlements de comptes claniques ne sont pas chose nouvelle en Algérie, mais les nouveaux équilibres internes ont indéniablement contribué au regain d’énergie diplomatique du pays.
Offensive diplomatique
L’évolution des (dés)équilibres régionaux appelaient à une adaptation de la politique étrangère et sécuritaire algérienne.
Les rapports de forces nationaux, ainsi que la manœuvrabilité sur la scène internationale procurée par les missions de maintien de la paix, ont pu également contribuer à cette rupture. Surtout, les effets s’en sont fait ressentir dans l’approche adoptée sur plusieurs dossiers diplomatiques.
En Tunisie, avec qui les Algériens entretiennent traditionnellement de bons rapports, l’Algérie se pose en « pays frère », et y assure son influence. Elle a envoyé du matériel médical, des doses de vaccins et des camions d’oxygène au plus fort de la vague épidémique de COVID-19 qui frappait le pays du jasmin en juin et juillet derniers, alors même que ses propres réserves ne lui ont pas permis de faire face au pic de contaminations qui l’a frappée par la suite.
Sur le plan politique, la diplomatie algérienne a fait preuve d’une grande réactivité au coup de force institutionnel du président tunisien le 25 juillet, le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra se rendant trois fois en Tunisie le mois suivant pour exprimer le soutien de l’Algérie à Kais Saied. Cette relation de plus en plus étroite se traduit également par l’arrestation et l’expulsion d’opposants politiques respectifs.
Concernant la Libye, l’Algérie, qui avait progressivement été marginalisée sur ce dossier pourtant capital, tente depuis le départ de Bouteflika de jouer un rôle plus actif et durcit le ton.
Lors de l’offensive de Haftar dans le nord-est libyen, Tebboune avait qualifié en janvier 2020 Tripoli « de ligne rouge à ne pas franchir ». En juin dernier, il a même révélé que l’Algérie avait envisagé une intervention militaire.
Si la situation a évolué avec la formation en mars 2021 d’un Gouvernement d’union nationale dirigé par Abdel Hamid Dbeibah, elle n’est pas encore apaisée : Haftar a même prétendu en juin 2021 s’être emparé d’un poste-frontière à la frontière algéro-libyenne.
La récente nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de Lamamra s’inscrit dans cette volonté de reprise en main de la question libyenne.
Ce diplomate chevronné a notamment brillé dans ces mêmes fonctions dans le passé (2013-2017) par son action dans le Fezzan libyen (limitrophe de l’Algérie), et aurait pu occuper les fonctions d’envoyé spécial de l’ONU pour la Libye si les États-Unis n’avaient pas bloqué sa nomination.
Preuve du retour diplomatique algérien, le pays a organisé le 31 août une réunion des ministres des Affaires étrangères de sept pays voisins de la Libye (Algérie, Tunisie, Égypte, Niger, Tchad, Soudan et République du Congo), qui ont appelé notamment « à la mise en application de l’accord quadripartite entre la Libye et les pays du voisinage pour la sécurisation des frontières communes ».
Le retour de Lamamra constitue également un signal positif pour les pays du Sahel, en proie aux insurrections d’extrémistes islamistes. Sa prise de poste coïncide à quelques jours près avec l’annonce par la France de la transformation prochaine de l’opération Barkhane au profit d’un dispositif resserré.
De plus, le Tchad, autre force militaire d’envergure, traverse une période d’incertitude après le décès au combat de son chef d’État Idriss Déby en avril, et a décidé du retrait de 600 militaires de la force du G5 Sahel.
Cette diminution de l’engagement de ces deux acteurs majeurs (la France et le Tchad) en matière de sécurité régionale pourrait amener l’Algérie à jouer un rôle plus actif dans la crise sahélienne, alors qu’elle conserve une forte influence dans le nord malien.
Le Mali, une solution « à 90 % algérienne »
Le président Tebboune a déclaré à ce sujet que la solution malienne était « à 90 % algérienne » et que son pays se tenait prêt à « aider Bamako ». L’Algérie a réactivé le CEMOC (Comité d’état-major militaire opérationnel conjoint regroupant l’Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger, longtemps resté coquille vide), qui s’est réuni en février 2021 à Bamako.
Le 10 août, c’est à Alger que s’est tenue une « conférence sur la sécurité au Sahel » sous l’égide du ministère des Affaires étrangères. Y ont été conviés des responsables politiques et sécuritaires des cinq pays subsahariens, des Nations unies et de l’Union africaine.
Lamamra s’est rendu peu après au Mali pour réaffirmer l’engagement algérien auprès des autorité de Bamako, annonçant que son pays pourrait financer la reconstitution de l’armée malienne.
Enfin, ce dynamisme diplomatique s’est exprimé de façon spectaculaire à l’annonce de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc.
Si les propos du Maroc à l’ONU exprimant le droit à l’autodétermination de la Kabylie ont été vécus comme un affront, les dernières victoires diplomatiques marocaines – réintégration de l’Union africaine en janvier 2017, reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental par les États-Unis – plaidaient déjà en Algérie pour une reprise de l’initiative.
Plus inquiétant, les deux pays semblent avoir fait leur choix face au dilemme de sécurité : entre 2016 et 2020, le Maroc et l’Algérie ont importé 70 % des armes présentes en Afrique (hors Égypte) selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), qui classe l’Algérie au sixième rang mondial des importateurs d’armes.
Cette rupture diplomatique intervient également quelques mois après la reprise des hostilités au Sahara occidental entre Front Polisario et le Maroc, une première depuis le cessez-le-feu de 1991.
L’Armée nationale populaire algérienne a par ailleurs conduit en janvier 2021 d’importants exercices militaires à sa frontière avec le Maroc, le chef d’état-major Chengriha évoquant à cette occasion la menace constituée par des « ennemis d’hier et d’aujourd’hui ». Coutumier du fait, il avait précédemment exhorté les soldats de l’ANP à se tenir prêts pour « la défense de nos frontières […] même contre un ennemi classique ».
Ce dynamisme diplomatique s’observe au-delà de son environnement immédiat, comme en témoigne l’initiative algérienne pour résoudre le litige autour du barrage éthiopien de la Renaissance.
Abdelmadjid Tebboune a également entrepris fin août un mouvement d’ampleur au sein du réseau diplomatique algérien, qui a donné lieu à la nomination de sept envoyés spéciaux consacrés à des axes stratégiques pour le pays.
Cette offensive diplomatique devrait s’inscrire dans la durée, les défis régionaux étant nombreux et compliqués. Toutefois, Alger doit prendre garde à conserver son image d’arbitre qui se projette au-dessus de la mêlée.
Ses capacités de médiation étaient réputées dans le monde entier, matérialisées par exemple par la résolution de la crise des otages de l’ambassade des États-Unis en Iran en 1979, et constituent un point fort à préserver.
Surtout, les autorités algériennes auront à trouver un équilibre entre l’énergie allouée à la gestion des dossiers diplomatiques et celle dédiée à la situation interne, tandis que la répression contre des journalistes ou des opposants se poursuit et que la crédibilité de l’État a sévèrement été mise en cause cet été par la gestion du pic épidémique de COVID-19 et des terribles incendies qui ont ravagé la Kabylie.
Alain Leroy
Middle East Eye, 29/09/2021