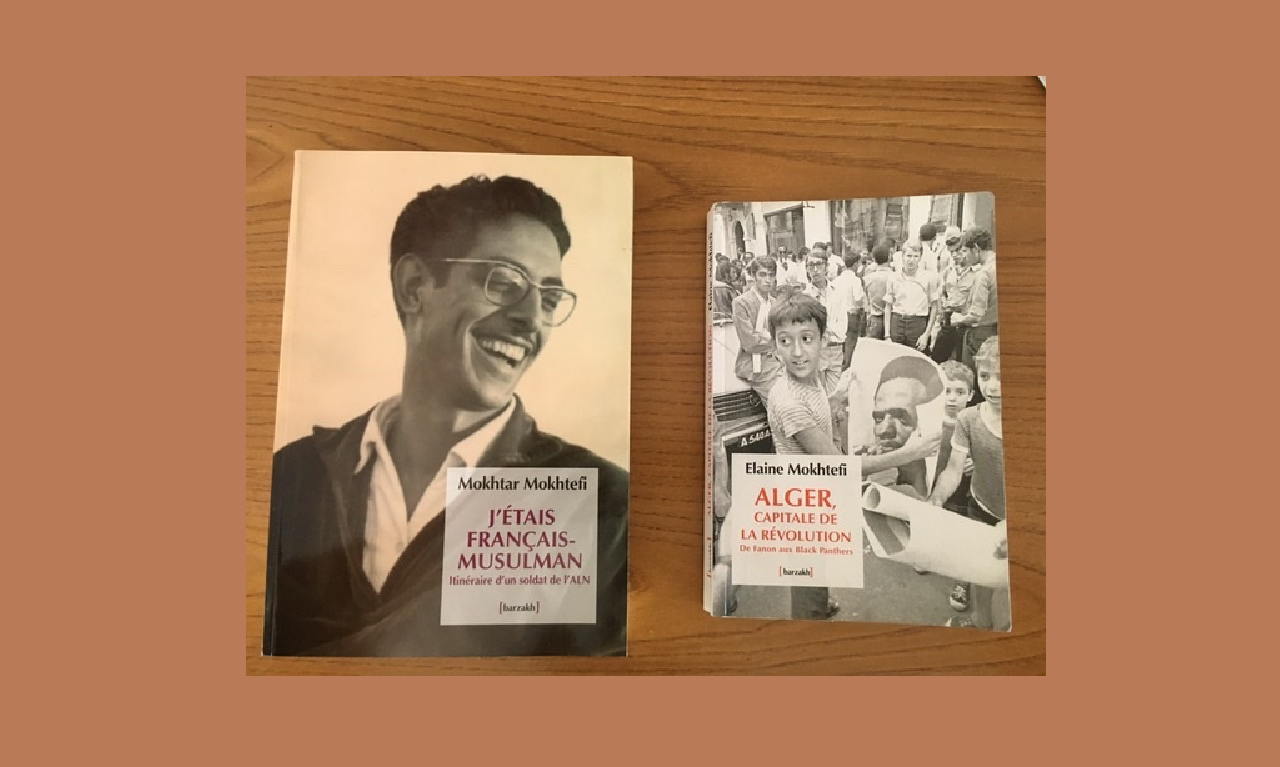Algérie, Hirak, covid 19, pandémie, #Algérie,
Propos recueillis par Sofian Philip Naceur/RLS
Entretien avec Prof. Dr. Rachid Ouaissa (Université de Marburg, MECAM Centre Tunis)
Dr Rachid Ouaissa est professeur au Centre d’études du Proche et du Moyen-Orient (CNMS) de l’Université de Marburg en Allemagne et, depuis 2020, directeur du Centre Merian d’études avancées pour le Maghreb (MECAM) à Tunis. Nous avons discuté avec lui de la situation politique, économique et sociale actuelle en Algérie, de l’échec de l’État à gérer la pandémie de Covid19, des échecs et du potentiel du mouvement de protestation Hirak (en arabe pour « mouvement »), du rôle de la Kabylie, et de la des difficultés sociales et économiques croissantes dans le pays qui devraient être considérées par le Hirak comme une opportunité de se réorganiser et de créer une vision plus tangible pour une Algérie plus juste socialement. L’entretien a été réalisé par Sofian Philip Naceur fin août 2021.
Le régime algérien a de plus en plus recours à des tactiques répressives contre l’opposition depuis la reprise des manifestations du Hirak en février 2021. Le régime tente de mettre un terme au mouvement de protestation une fois pour toutes. Actuellement, le pays connaît également une autre vague de coronavirus, de loin la pire depuis le début de la pandémie. De quelles options dispose le Hirak pour exercer à nouveau une pression sur le régime après la vague actuelle de Covid-19 ?
Ouaïssa : Ce n’est en effet pas clair et dépend également des traces que la crise corona laissera derrière elle. La vague corona actuelle est la plus grave que le pays ait connue jusqu’à aujourd’hui. L’échec de l’État à gérer la pandémie est évident. Les hôpitaux sont surchargés et il y a une pénurie généralisée d’oxygène. Les traces du système Bouteflika [l’ancien président algérien Abdelaziz Bouzeflika, en poste entre 1999 et 2019, ndlr] sont désormais encore plus visibles. Il est donc bien probable que le Hirak réagisse à la défaillance de l’État. Presque toutes les familles ont vu des proches mourir. Cela peut contribuer à un potentiel de protestation encore plus grand dans la société algérienne. Par conséquent, je m’attends à ce que le Hirak se concentre davantage sur les demandes économiques et socio-économiques à l’avenir. Dans le même temps, la situation financière de l’État devrait se redresser au moins dans une certaine mesure, comme une augmentation à moyen terme des prix du pétrole devrait se matérialiser. Cependant, les représailles de l’État peuvent également conduire à des intimidations réussies. Pour ces raisons également, le Hirak émergera de plus en plus au niveau régional plutôt que national. La région de Kabylie va certainement continuer à se révolter. Finalement, les gens continueront de descendre dans la rue dans les grandes villes également. Mais je ne crois pas que le Hirak saura réussir à se mobiliser à l’échelle nationale comme il l’a fait en 2019, du moins au début d’une nouvelle vague de protestation qui est encore à venir. La région de Kabylie va certainement continuer à se révolter. Finalement, les gens continueront de descendre dans la rue dans les grandes villes également. Mais je ne crois pas que le Hirak saura réussir à se mobiliser à l’échelle nationale comme il l’a fait en 2019, du moins au début d’une nouvelle vague de protestation qui est encore à venir. La région de Kabylie va certainement continuer à se révolter. Finalement, les gens continueront de descendre dans la rue dans les grandes villes également. Mais je ne crois pas que le Hirak saura réussir à se mobiliser à l’échelle nationale comme il l’a fait en 2019, du moins au début d’une nouvelle vague de protestation qui est encore à venir.
Plus récemment, la Kabylie était le dernier rempart du Hirak. Les manifestations se sont poursuivies sans relâche jusqu’au début de la vague actuelle de coronavirus. Cependant, nous avons également vu depuis 2019 que le régime essaie de diviser le Hirak selon les affiliations ethniques et de monter Arabes et Berbères les uns contre les autres. Alors que les manifestations ont été réprimées dans presque tout le pays au moyen d’une forte répression, seules les Kabylies continuent de manifester. Des personnes sont continuellement poursuivies pour avoir arboré le drapeau berbère. Le régime essaie-t-il d’utiliser des moyens sectaires pour diviser le pays et sa société et maintenir son pouvoir en exacerbant violemment le conflit en Kabylie ?
Ouaissa : Le régime recourt encore et encore aux mêmes moyens et suit des schémas notoires. Il tente de diviser par des moyens autoritaires. La Kabylie est présentée comme un cas exceptionnel, tandis que le Hirak s’appuie sur une sorte de conscience nationale – l’Algérie est vue dans son ensemble – et tente de se défendre contre cette division régionale. Je ne pense pas que le Hirak et le peuple algérien tombent dans le piège. Cependant, je considère le Hirak comme un échec politique. Néanmoins, le mouvement a fait en sorte que la confiance en soi du peuple s’est accrue. Il est clair pour tout le monde aujourd’hui que c’est le régime qui est le problème, pas la Kabylie.
Pourquoi pensez-vous que le Hirak a échoué ?
Ouaïssa : Si une nouvelle vague de protestations se matérialise après l’actuelle urgence corona, j’espère que le mouvement a appris de ses erreurs. Le Hirak a échoué parce qu’il a malheureusement laissé de côté toutes les questions idéologico-politiques sérieuses. La principale raison de son échec sont les islamistes. Le mouvement Rachad [un mouvement islamiste principalement actif dans les pays européens qui a émergé des ruines du Front islamique du salut, ndlr] a détruit le Hirak car, sous sa pression, toutes les questions importantes sur l’avenir de l’Algérie ont été laissées de côté. Le problème était toujours centré sur le régime, mais pas sur le système. La question du système en tant que tel n’a jamais été soulevée. Le problème n’est pas seulement l’élite, il est bien plus profond. Voulons-nous une Algérie où l’on change simplement les élites ou voulons-nous une Algérie où l’on remet aussi en cause et change le système éducatif et économique ? Les islamistes n’ont jamais remis en cause les structures néolibérales de l’économie algérienne. Ils n’ont jamais remis en cause le système éducatif en ruine, considéré comme fortement influencé par la religion. Et ils ont insisté pour que toute question susceptible de diviser le Hirak ne soit pas posée en premier. Le même schéma a déjà été appliqué en Algérie pendant la guerre d’indépendance entre 1954 et 1962 : notre ennemi est la France et ce n’est qu’après la victoire contre le régime colonial que nous discuterons dans quelle direction le pays doit s’orienter. Cela n’a pas fonctionné à l’époque et cela ne fonctionne pas maintenant. Nous devons poser et discuter de cette question clé maintenant.
Une question centrale, cependant, a été abordée de manière assez cohérente par le Hirak, à savoir le pouvoir de l’armée ou le rôle politique de l’armée. La revendication d’un État civil est même aujourd’hui l’une des revendications les plus importantes du mouvement.
Ouaissa : C’est exact. C’est une question clé et elle est considérée comme une priorité pour le Hirak. Mais les dirigeants laïcs du mouvement disent aussi : l’armée et la religion ne doivent jouer aucun rôle au sein de l’État. Cependant, alors que la question de l’armée a été largement débattue, le rôle de la religion dans une nouvelle Algérie ne l’a pas été. Mais cela ne fonctionne pas. De plus, il ne peut y avoir de véritable révolution si les acteurs économiques n’en sont pas convaincus. Les acteurs économiques ont peur. Ils craignent qu’après une véritable révolution, des règles soient encore pires que celles imposées par les militaires. Pour les acteurs économiques, c’est plus sûr avec les militaires au pouvoir car ils connaissent déjà très bien les règles.
Cependant, les questions économiques et sociales ont également été abordées par le Hirak. Il y a eu des déclarations répétées dans lesquelles les représentants du Hirak ont ouvertement appelé à la justice sociale – bien qu’il n’y ait généralement pas eu de vision présentée de la façon dont cela pourrait être réalisé. Le Hirak discutait aussi régulièrement de la dépendance de l’État vis-à-vis des rentes pétrolières. Le Hirak a donc certainement essayé de mettre l’accent sur les questions socio-économiques et économiques, et une partie du mouvement a tenté à plusieurs reprises de stimuler les débats correspondants. Mais jusqu’à présent, ces débats n’ont abouti qu’à une impasse.
Ouaïssa : Exactement. Cette discussion a été bloquée encore et encore. J’ai moi-même vécu des débats dans lesquels les droits des femmes étaient revendiqués et puis on disait que la question des droits des femmes était de nature idéologique et que les débats idéologiques devaient être ajournés pour le moment. Mais une telle approche ne convainc pas les gens, la vision du Hirak était trop vague. Quand on est sur le chemin d’une révolution, on veut déjà savoir où va le pays. Il faut présenter une vision plus concrète de l’avenir de l’Algérie, mais le Hirak ne pouvait pas offrir cela.
En raison de la couronne, les problèmes sociaux pourraient être placés au centre de la scène du Hirak. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? La situation socio-économique est actuellement extrêmement tendue, non seulement à cause de la vétusté du système de santé. Des protestations socio-économiques ont eu lieu à plusieurs reprises dans le sud de l’Algérie ces derniers temps, par exemple à Ouargla. Cela pourrait se traduire par de nouveaux afflux de partisans pour le Hirak. Cela pourrait-il également remettre en cause le caractère pacifique du mouvement puisque nous avons soudainement affaire à des gens dans les rues qui ont simplement faim et ne se joignent pas à une manifestation pour des raisons politiques ?
Ouaïssa :Le risque est là. Jusqu’à présent, cependant, le mouvement a échoué principalement parce qu’il s’agissait d’un amalgame de classes moyennes. Ces classes moyennes sont à la fois islamistes et laïques. Leurs visions sociales diffèrent, mais en matière de politique économique, ils ont des idées similaires. Les couches socio-économiquement marginalisées de la société ont reçu peu d’attention. Cependant, si ces couches de la société doivent rejoindre le Hirak en tant que nouveaux acteurs, un pacte doit être conclu entre elles et la classe moyenne. Les enjeux économiques et les aspects socio-économiques doivent être valorisés et devenir des enjeux clés. Il ne doit plus s’agir uniquement de changement de régime. Au lieu de cela, un débat sur un changement de système doit être porté au premier plan. Seule la coopération entre la classe moyenne idéologiquement divisée et les couches sociales à faible revenu peut transformer le Hirk en une véritable révolution.
Depuis plus d’un an, le Hirak est principalement associé à des ONG, des partis d’opposition et des personnalités publiques telles que d’éminents avocats et militants des droits de l’homme, mais pas avec les syndicats. En 2019, les syndicats indépendants marchaient toujours aux côtés de l’opposition partisane. Aujourd’hui, ils ne jouent plus aucun rôle. Pourquoi donc?
Ouaissa : Pour une vraie révolution, il faut impliquer les acteurs économiques, qu’ils soient avec de l’argent ou sans argent. Ceux qui ont de l’argent doivent être rassurés pour qu’ils investissent à nouveau. En même temps, il faut donner l’espoir à ceux qui n’ont pas de moyens – les démunis – que quelque chose changera pour eux plus tard et qu’ils tireront quelque chose de ce soulèvement. Ces deux acteurs – les employeurs et les salariés, majoritairement représentés par les syndicats – doivent être convaincus et activement impliqués dans le Hirak. Si l’État se rétablit financièrement à moyen terme en raison de la hausse des prix du pétrole, les employeurs et les employés pourraient également se calmer. Si un tel scénario se produit, le Hirak aura perdu de toute façon.
Même si l’État se redresse à moyen terme en raison de la hausse des prix du pétrole, le système économique continuera d’être soumis à d’énormes pressions. La baisse des réserves étrangères se poursuivra malgré tout, et ce n’est qu’une question de temps avant que le pays ne se rapproche de la faillite. Quelle serait une option pour une intervention de politique économique et sociale à court terme, et comment la dépendance de l’État à la rente pétrolière pourrait-elle être contrée à long terme ?
Ouaissa : Je pense que l’Algérie ne peut éviter de négocier avec le Fonds monétaire international (FMI). Le régime l’a déjà fait en 1994, en pleine guerre civile. La situation politique intérieure de l’époque était une bonne distraction et une couverture pour négocier avec le FMI dans les coulisses. Un tel scénario est à nouveau imminent. Sous la pression de la pandémie de corona et de la crise économique, des négociations pourraient reprendre avec le FMI, débouchant sur un nouveau programme de libéralisation. Ceci, à son tour, est susceptible de déclencher de nouvelles protestations à motivation socio-économique. Il faut espérer que cela n’entraîne pas une escalade violente.
Mais on sait aussi que les recettes du FMI sont toujours les mêmes. Et ils ne fonctionnent tout simplement pas. Je ne prétends pas qu’une économie fortement isolée comme celle de l’Algérie fonctionne – le modèle algérien a clairement échoué. Mais quelle alternative y aurait-il à un système économique isolé dans lequel la rente pétrolière est monopolisée par les élites et la stratégie de dérégulation du FMI, qui a échoué à plusieurs reprises ?
Ouaïssa :L’Algérie est l’un des très rares pays au monde à pouvoir réellement négocier de bons termes avec le FMI. L’Algérie n’est pas un pays pauvre. Le FMI ne peut pas imposer ici ses diktats habituels. À cet égard, je peux imaginer que l’État-providence puisse être réformé avec autant de rentes pétrolières et que la rente puisse être transférée et transformée en formes productives – étant donné que la volonté politique de le faire est là. Les loyers ne sont pas en soi un obstacle au développement. Les loyers peuvent également être transformés afin qu’ils soient utilisés comme un coup de pouce pour une économie productive. Ils pourraient être utilisés pour la consommation, de sorte que les entrepreneurs algériens n’aient plus à dépendre des généraux pour faire des affaires. Si les rentes devaient être distribuées comme moyen de consommation dans la société, par exemple sous forme de salaires, certains produits n’auraient plus à être importés,
Malheureusement, il est presque impossible d’utiliser et de rediriger la rente pétrolière de cette manière. Il n’y a pratiquement aucun exemple dans le monde où il a été possible de réformer les économies de rente en conséquence.
Ouaissa : Les modèles d’Asie de l’Est sont certainement des exemples de la façon dont les États ont réussi à valoriser et à utiliser le travail dans la société pour promouvoir une augmentation du pouvoir d’achat. La Chine en est un exemple. Un tel scénario est également possible en Algérie. Les entrepreneurs doivent être convaincus d’investir et de produire dans le pays et de ne plus importer. Pour cela, cependant, nous avons besoin d’un pouvoir d’achat dans la société. Les loyers pourraient être utilisés pour générer ce pouvoir d’achat. Mais la question est bien de savoir comment mettre en œuvre concrètement une telle politique.
Les déclarations de l’enquêté ne correspondent pas nécessairement à l’opinion du RLS.
Rosa Luxembourg Stiftung, août 2021