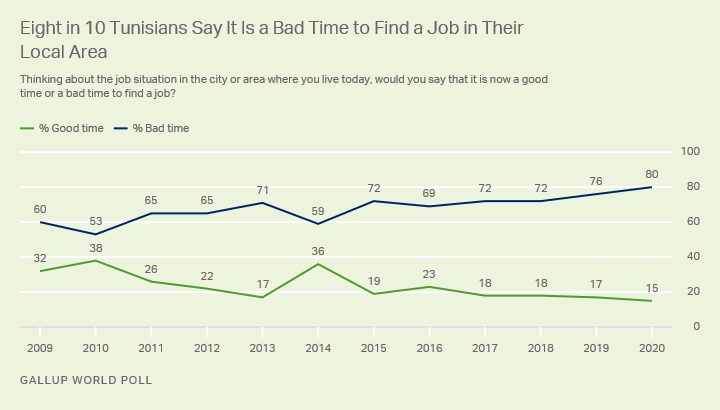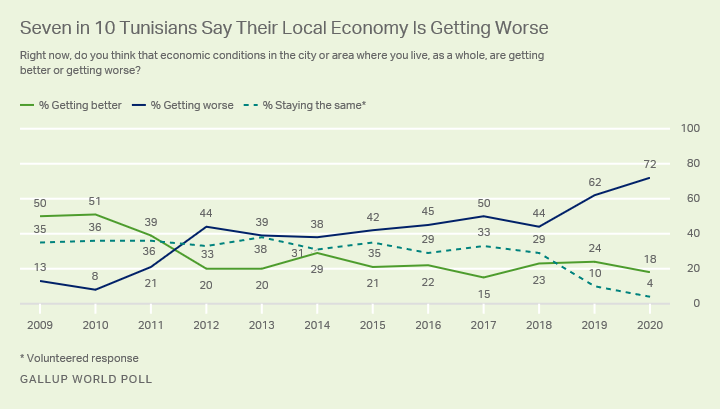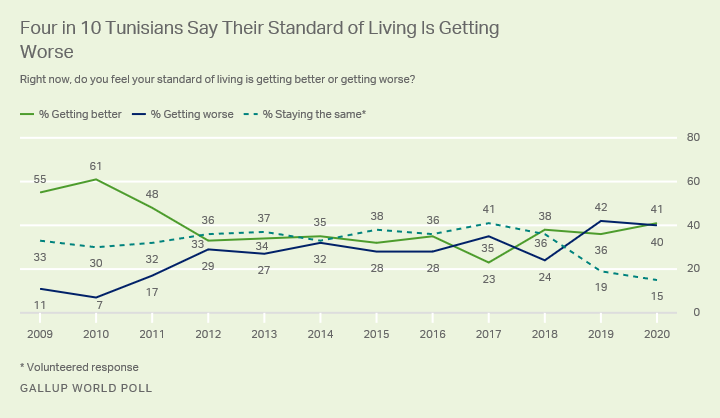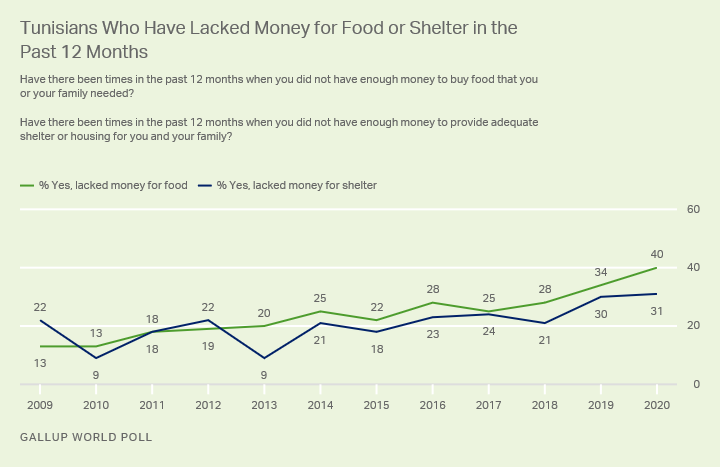Au cours des quatre dernières années, la plupart des violences terroristes islamiques se sont déplacées vers l’Afrique. À l’heure actuelle, les dix pays les plus touchés par les décès liés au terrorisme sont l’Afghanistan, l’Irak, le Nigeria, la Syrie, le Pakistan, la Somalie, l’Inde, le Yémen, les Philippines et le Congo. Certaines nations souffrent davantage de la violence non-islamique. C’est le cas de l’Inde, des Philippines, du Yémen et du Congo, qui connaissent tous le terrorisme islamique, mais qui ne représente qu’une minorité des décès liés au terrorisme. Le Nigéria le ferait aussi, sauf qu’une grande partie de ses décès terroristes non islamiques sont le fait de musulmans qui attaquent d’autres musulmans pour des raisons purement économiques. Malgré cela, en 2018, les décès liés au terrorisme dans le monde ont diminué de 15 % pour atteindre 15 952. En 2019, il y a eu 13 826 décès et la baisse s’est poursuivie en 2020. Cette baisse est, jusqu’à présent, une tendance sur cinq ans. Même la Syrie a connu moins de décès au cours des dernières années. L’Égypte a connu une baisse encore plus spectaculaire de 90 % en 2018 et cette baisse s’est poursuivie, mais les gros titres ne couvrent pas de telles tendances. Le vieil adage de l’actualité, « si ça saigne, ça mène » est plus vrai que jamais et au Nigéria, il y a des titres sanglants tous les jours à cause du terrorisme islamique ou de la violence tribale.
Depuis 2014, cinq nations (l’Irak, l’Afghanistan, le Nigeria, la Syrie et le Pakistan) ont représenté la plupart des décès liés au terrorisme. Cette liste a récemment changé, la Syrie et le Pakistan étant remplacés par la Somalie et le Mali (y compris les États sahéliens voisins). La principale source de décès liés au terrorisme islamique au cours de cette période est l’ISIL (État islamique en Irak et au Levant), une faction plus radicale d’Al-Qaïda qui est actuellement le praticien le plus radical du terrorisme islamique. Le terrorisme islamique reste, comme depuis les années 1990, la principale source de décès liés au terrorisme, représentant environ 90 % des décès. Le reste des décès liés au terrorisme sont dus à des conflits ethniques (souvent tribaux) en Afrique et en Asie. Le terrorisme purement politique ne représente qu’une fraction d’un pour cent de tous les décès liés au terrorisme et est dépassé par les décès liés au terrorisme infligés par des criminels de droit commun (souvent organisés).
C’est au Nigeria que l’on enregistre le plus de décès dus au terrorisme islamique. La principale raison en est qu’environ la moitié des Nigérians sont chrétiens, mais que la plupart d’entre eux vivent dans le sud, où se trouvent le pétrole et la plupart des économies développées. Les chrétiens sont mieux éduqués et réussissent mieux sur le plan économique, ce qui paraît injuste à de nombreux Nigérians musulmans. Après tout, les chrétiens sont des infidèles et des ennemis de l’islam. Boko Haram est plus direct et croit que tous les chrétiens doivent se convertir à l’islam. Ceux qui résistent doivent être tués ou réduits en esclavage. La plupart des musulmans nigérians ne sont pas d’accord avec l’attitude de Boko Haram à l’égard des chrétiens. Boko Haram considère que les musulmans qui ne sont pas d’accord avec eux sur les méfaits des chrétiens sont des ennemis de l’islam et sont passibles de mort s’ils ne changent pas d’attitude.
Si le terrorisme islamique reste un problème majeur au Nigeria, ce n’est pas le cas dans le reste du monde. Le terrorisme islamique ne domine plus l’actualité mondiale depuis que l’ISIL a été largement supprimé. Les décès liés au terrorisme islamique dans le monde ont chuté de plus de 50 % depuis 2014, année où l’on en comptait 35 000. Cette activité est surtout visible dans le GTI (Global Terrorism Index), qui recense toutes les formes de terrorisme. Cela place le Nigeria dans le top 10, car ses victimes de la violence de Boko Haram n’y suffiraient pas. Depuis un an environ, la plupart des décès liés au terrorisme au Nigeria sont dus à des guerres tribales, un problème qui existait bien avant l’arrivée de l’islam en Afrique subsaharienne, il y a environ mille ans. C’est à peu près à cette époque que l’Islam a connu une évolution religieuse au cours de laquelle la science et la technologie sont passées d’un domaine d’étude utile à un sujet interdit pour les musulmans dévots. C’était un effet secondaire d’une guerre civile qui a détruit le califat (empire islamique) à cause du nationalisme et des conflits sur l’identité des nouveaux califes (chefs du califat). Cette attitude a donné naissance à Boko Haram, qui se traduit par « L’éducation des infidèles est interdite ». La plupart des musulmans préféreraient une attitude plus positive à l’égard de la technologie, mais de telles attitudes vous feront tuer lors des flambées périodiques de terrorisme islamique qui ont eu lieu au cours du dernier millénaire. Au sein du monde islamique, des efforts sont déployés pour changer cette situation. C’est difficile car il y a eu une autorité centrale pour décider de ce qui est le « vrai Islam » et ce qui ne l’est pas. C’est une question importante pour les musulmans, car l’islam a été fondé en tant que religion servant également de forme de gouvernement. Aucune autre grande religion n’a intégré cela dans ses croyances fondamentales, telles que décrites dans le Coran (la bible musulmane). Cette guerre civile permanente est actuellement représentée par le conflit entre l’Iran, qui suit l’école chiite de l’islam et est actuellement dirigé par une dictature religieuse. Les chiites représentent environ dix pour cent de tous les musulmans, tandis que les sunnites de la ligne principale en représentent environ 80 %.
Les sunnites n’ont pas de chef reconnu et sont divisés en de nombreuses sous-sections. L’Arabie saoudite est considérée comme l’État sunnite le plus influent du fait qu’elle est arabe et dirigée par le clan des Saoud, qui a pris le contrôle des deux plus importants sanctuaires islamiques (La Mecque et Médine) en 1920, lorsque l’Empire turc ottoman a été démantelé par les alliés victorieux de la Première Guerre mondiale, principalement la Grande-Bretagne et la France. La majeure partie du monde arabe n’avait pas été indépendante pendant des siècles après que les Turcs eurent pris le contrôle de l’Empire romain d’Orient, un processus qui s’est achevé au 15e siècle et a réussi à survivre jusqu’au 20e siècle (1918). Les Turcs ont résolu le problème du calife/califat en reconnaissant le souverain ottoman (le sultan) comme calife et en éliminant tous les musulmans qui contestaient cette prétention. Le XXe siècle a également entraîné une dépendance mondiale à l’égard du pétrole, dont la majeure partie se trouve dans les régions à majorité musulmane. Soudain, les radicaux islamiques ont eu accès à plus d’argent que jamais auparavant. Les radicaux islamiques n’avaient aucune objection à accepter l’argent des infidèles pour leur pétrole, et ils ont fini par utiliser toute cette richesse pour attaquer les États infidèles, tout en cherchant à prendre le contrôle des zones à majorité musulmane. C’est pourquoi le terrorisme islamique a connu une flambée sans précédent à la fin du XXe siècle. Des groupes comme Boko Haram méprisaient toujours l’éducation infidèle, mais étaient désireux d’acheter tous les gadgets et les armes que la révolution scientifique et industrielle occidentale avait rendus possibles. La contribution musulmane à toutes ces nouvelles technologies était minuscule et l’est toujours, bien que de nombreux États à majorité musulmane fassent des efforts pour devenir plus compétitifs dans le domaine de la technologie.
Les États à majorité musulmane du Moyen-Orient et d’Asie ont été plus efficaces dans la mise en place de gouvernements capables de contrôler leurs terroristes islamiques. L’Afrique est à la traîne dans ce domaine, en partie parce que l’Afrique subsaharienne est la dernière région à avoir été exposée à la révolution scientifique et industrielle ainsi qu’au nationalisme. En outre, il existe de nombreux pays africains où les musulmans sont minoritaires et largement dirigés par des gouvernements corrompus et incompétents. Cela offre davantage de possibilités aux groupes terroristes islamiques de s’établir. Au début du 21e siècle, l’Afrique, malgré tous ses problèmes économiques, gouvernementaux et d’infrastructure, était l’endroit le plus facile pour les groupes terroristes islamiques de survivre et même de prospérer. Néanmoins, chaque pays africain victime du terrorisme islamique a constaté que le problème avait une saveur locale.
En Afrique du Nord-Est, en Somalie, la principale source de décès dus au terrorisme islamique est Al Shabaab, un groupe local affilié à Al Qaeda. La présence d’ISIL est minuscule et survit à peine dans le nord de la Somalie. Al Shabaab tente de s’étendre aux pays voisins comme le Kenya, l’Éthiopie et l’Ouganda, mais n’a guère de succès.
En Afrique centrale, le Mali, pays enclavé, est le centre d’une activité terroriste islamique croissante qui s’est étendue aux pays voisins, le Niger et le Burkina Faso qui, comme le Mali, est enclavé et compte 17 millions d’habitants (environ 20 % de plus que le Mali). Le Burkina Faso n’a pas non plus de minorité touareg/arabe gênante dans le nord. Le Burkina Faso étant situé au sud du Mali, il n’a pas non plus le nord semi-désertique du Mali. C’est là que vit la minorité touareg/arabe. Le Burkina Faso présente également une plus grande diversité religieuse, un quart de la population étant chrétienne et 60 % musulmane. De plus, la population musulmane se compose de plusieurs « écoles » différentes de l’Islam, dont certaines sont assez hostiles au terrorisme islamique sunnite tel que pratiqué par Al-Qaïda et ISIL. En revanche, le Niger et la Mauritanie sont presque entièrement musulmans et ont toujours été le foyer de certains conservateurs islamiques qui n’étaient satisfaits que si leurs voisins adoptaient également le conservatisme islamique.
L’ISIL ne dispose pas d’une autorité centrale efficace pour le moment, les hauts dirigeants étant toujours dispersés et en fuite après les récentes défaites dans l’est de la Syrie et l’ouest de l’Irak. Au Nigeria, Boko Haram est divisé en factions et l’une d’entre elles, l’ISWAP (Islamic State West Africa Province) est l’une des deux filiales d’ISIL en Afrique centrale. Il est souvent difficile, au début, de déterminer quelle faction de Boko Haram a commis une attaque. En fin de compte, l’une des factions s’en attribue le mérite. ISWAP est généralement plus rapide à le faire et dispose d’une opération médiatique beaucoup plus efficace que la plupart des groupes terroristes islamiques basés en Afrique. L’ISWAP constate également que l’utilisation des techniques d’ISIL présente un inconvénient. Davantage de nations occidentales sont disposées à aider le Nigeria ou du moins à coordonner le contre-terrorisme existant dans la région (de la Somalie au Mali et sur la côte atlantique). Il existe de petites factions d’ISIL dans le nord de la Somalie, le sud de la Libye et l’est de l’Algérie. Ces groupes étaient autrefois plus importants mais ont subi de lourdes pertes du fait des efforts de lutte contre le terrorisme au niveau local et/ou international.
Au Mali, la violence s’est déplacée depuis 2012 du nord au centre du pays, où 74 % des 1 500 morts de 2019 ont eu lieu. Les autres se trouvaient dans le nord-est, où ISIL est le plus actif. La situation au Mali central est pire qu’il n’y paraît car dans la province sahélienne adjacente du Burkina Faso, il y a eu 918 décès en 2019. Les deux provinces peuvent en accuser les groupes terroristes islamiques qui les utilisent pour leur opération de trafic de drogue/de personnes (au nord vers la côte méditerranéenne) qui est si lucrative qu’elle s’est étendue, au moins dans le centre et le nord du Mali, pour inclure l’extorsion et toutes sortes d’activités criminelles. Au centre de toute cette violence et de ces activités lucratives se trouvent les tribus Fulani, qui sont nombreuses (20 millions en tout) sur une bande de territoire qui s’étend du centre du Mali, au nord du Mali, puis au sud du Niger et au nord du Nigeria.
Les troupes françaises au Mali ont tué le chef d’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) au cours d’une opération menée par le Miod-2020. Il s’agissait d’un événement important car le Maghreb est le terme arabe désignant l’Afrique du Nord et c’est de là que venait AQMI. La plupart des violences terroristes islamiques en Afrique du Nord ont eu lieu dans les années 1990 et, en 2000, les groupes terroristes islamiques étaient en déclin. Ce déclin se poursuit aujourd’hui et a conduit de nombreux survivants d’Al-Qaïda à se diriger vers le sud où ils ont tenté de reconstituer leurs forces en recrutant des locaux. Cette démarche s’est heurtée à des problèmes, car la population majoritairement arabe d’Afrique du Nord ne s’est jamais bien entendue avec les populations non arabes vivant au sud du désert du Sahara. L’AQMI a introduit le concept de terrorisme islamique dans cette région, ce qui a conduit à la formation de groupes terroristes islamiques locaux qui ont opéré indépendamment de l’AQMI. En conséquence, le plus grand groupe terroriste islamique au Mali est le JNIM (Jamâ’ah Nusrah al Islâm wal Muslimîn, ou Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans). Il s’agit d’une coalition d’Al-Qaïda formée début 2017 pour consolider les nombreux groupes terroristes islamiques distincts au Mali. Il s’agissait en partie d’une réaction à la menace croissante d’ISIL, qui est hostile à tous ceux qui ne sont pas ISIL et qui attaquent ou recrutent parmi les membres du JNIM comme AQMI, Ansar Dine, FLM et plusieurs autres groupes plus petits. Une autre raison de la fusion était de faciliter la mise en commun des ressources, notamment des informations et des conseils pratiques, et la coordination avec les autres groupes terroristes islamiques de la région. Cela réduit les frictions et les querelles destructrices. Il est toujours difficile de faire fonctionner une coalition de ce type, surtout si l’on considère l’importance des différences ethniques.
Le FLM est Fulani (la plus grande contribution tribale locale) tandis que les autres groupes sont en grande partie touaregs et arabes, et certains comptent beaucoup d’étrangers. Notez que le JNIM n’a pas absorbé tous les groupes d’AQMI dans la région, mais seulement les groupes locaux qui étaient depuis longtemps identifiés à Al-Qaïda. Les revenus du trafic de drogue permettent à un grand nombre de ces factions de rester en activité et les terroristes islamiques savent que le commerce et le fanatisme religieux ne font pas bon ménage. Les groupes qui ne le font pas font faillite et se désintègrent.
Les membres des groupes terroristes islamiques ont évolué et les membres les plus radicaux du JNIM ont rejoint des groupes plus radicaux comme ISIL, qui est universellement détesté par les autres terroristes islamiques et les musulmans en général. Début 2020, des membres maliens d’ISIL ont publié une vidéo sur Internet dans laquelle le groupe prêtait allégeance à Abu Hamza al Qurayshi, le nouveau chef d’ISIL. En 2018, il y avait deux « provinces » d’ISIL en Afrique centrale. La plus petite était l’ISGS (État islamique dans le Grand Sahara), qui a fait son apparition en 2018. L’ISGS est actuellement actif au Mali, au Burkina Faso et au Niger. L’autre province ISIL, légèrement plus ancienne et plus grande, était l’ISWAP, qui est en fait une faction des terroristes islamiques nigérians de Boko Haram qui existait depuis 2004. Le personnel de l’ISWAP se trouve principalement dans le nord-est du Nigeria, ainsi qu’en plus petit nombre au Tchad, au Niger et dans le nord du Cameroun.
Il y a eu des frictions croissantes entre l’ISGS et le JNIM (et d’autres affiliés d’Al-Qaïda). Ce n’est pas inhabituel car, dans le monde entier, ISIL exige que tous les autres groupes terroristes islamiques reconnaissent la suprématie d’ISIL. Cela ne se produit plus que rarement. Dans les zones où ISIL et al-Qaïda opèrent tous deux, il y a généralement une trêve informelle ou, comme c’est le cas actuellement au Mali, une guerre ouverte. Les groupes ISIL sont généralement inférieurs en nombre mais survivent souvent parce qu’ils sont plus impitoyables et vicieux. Dans le nord du Mali, l’ISGS accuse également le JNIM de collaborer avec les forces de sécurité contre le groupe ISIL. Ce n’est pas inhabituel dans le monde entier, mais on ne sait pas si cela se produit réellement au Mali. Ce qui se passe, c’est que l’ISGS continue de recruter de nouveaux membres dans les factions d’Al-Qaïda. C’est ainsi qu’ISIL a été créé en 2013 et cette pratique se poursuit.
Alors que les terroristes islamiques sont la source de beaucoup de violence et de mort au Mali et dans les pays voisins, la principale source de mort violente reste les querelles tribales. Au Mali, la principale est celle qui oppose les Peuls et les Dogons et, jusqu’à présent, en 2020, cette querelle a tué plus de personnes que toute la violence terroriste islamique au Mali.
Strategy Page, 12 mars 2021
Tags : Terrorism, ISIS, Africa, Daesh, JNIM, Al Qaeda,