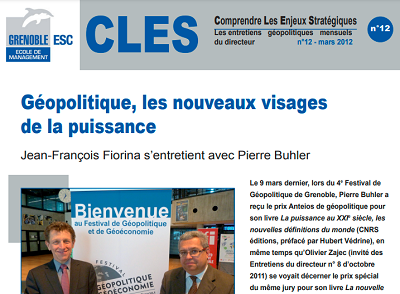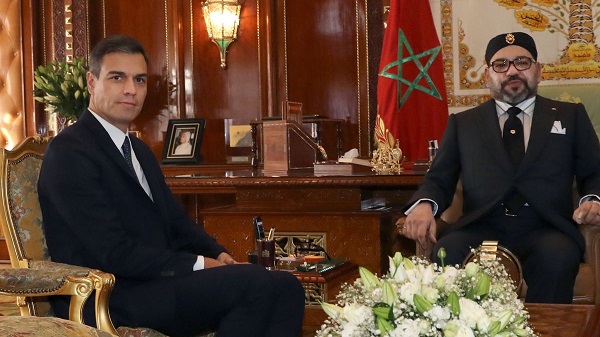Maroc, Espagne, Ceuta, Melilla, Sahara Occidental, Algérie, Federico Trillo,
Federico Trillo* : « Le Maroc n’est pas un pays démocratique. Tôt ou tard, le président Sánchez devra rendre compte de sa politique de compromission avec le ce régime à propos du Sahara occidental ».
L’ancien président du Congrès des députés, troisième plus haute autorité de l’État sous le gouvernement de José María Aznar, analyse pour le journal espagnol catholique en ligne El Debate** la politique étrangère, la défense nationale et les errances du gouvernement actuel en matière territoriale. Il dénonce avec virulence l’abandon par le chef du gouvernement espagnol, minoritaire, des principes fondateurs de la diplomatie de son pays vis-à-vis du Sahara occidental. Cette politique illégale d’abandon, sera, tôt ou tard sanctionnée.
Propos recueillis par Maria Jamardo
Le 11 juillet, cela fera 20 ans que l’invasion de l’îlot Perejil a eu lieu. Comment vous rappelez-vous cet incident ?
Federico Trillo : La crise du gouvernement de José María Aznar venait de se terminer. Je revenais d’une passation de pouvoirs avec le prince Felipe de l’époque et, vers 15 heures de l’après-midi, lorsque je suis arrivé au ministère de la Défense, le nouveau ministre de l’Intérieur, Ángel Acebes, m’a appelé pour me dire que la Guardia Civil avait détecté la présence de soldats marocains sur l’îlot et qu’ils avaient hissé le drapeau marocain et monté une tente. C’est la première nouvelle que j’ai eue. Il nous a fallu un certain temps pour le confirmer parce qu’à l’époque il était difficile de localiser les personnes à Ceuta, mais elles ont confirmé qu’il s’agissait d’une opération, parfaitement calculée et dirigée par le Maroc pour rompre le statu quo international de l’île comme res nullius – qui n’appartient à personne – et se l’approprier.
Propagande par voie de fait… Quelle était l’intention du Maroc avec cette invasion ?
Le roi Hassan II a toujours eu un grand mépris pour la région du nord du Maroc. En fait, il ne l’a jamais visitée. Son fils Mohammed VI, quant à lui, a voulu dès le départ marquer sa présence dans le nord, dans le Rif, pour montrer qu’il ne renonçait pas à la totalité de ses revendications territoriales. Il l’a fait en calculant qu’en Espagne, à l’époque, la crise gouvernementale était une crise négative, et non une crise de renforcement, comme elle l’était réellement. Et il a cru voir le bon moment pour diriger cette opération, qu’il a personnellement conçue et commandée.
Quelles étaient les relations avec le Maroc à l’époque ? Qu’est-ce qui a changé depuis ?
À l’époque, les relations avec le Maroc étaient bonnes et fluides. J’avais moi-même rendu visite à Mohammed VI au nom du Royaume d’Espagne pour lui présenter mes condoléances après la mort de son père, et il m’avait dit qu’il considérait le roi Juan Carlos Ier comme une référence pour la démocratisation de son pays. Cependant, il est important de réaliser que le Maroc n’est pas un état de droit, ce que le gouvernement socialiste actuel ignore. En surface, il veut se présenter comme démocratique mais, au fond, c’est la volonté du monarque et de son entourage qui est déterminante : ils disent une chose et en font une autre. C’est ce qui s’est passé à l’époque. Il est donc impossible d’avoir des relations avec le Maroc dans lesquelles on oublie la deuxième partie de l’équation, à savoir que, malgré les efforts de démocratisation, il existe une composante autocratique très élevée.
La démission du gouvernement de Pedro Sánchez au sujet du Sahara a-t-elle signifié un abandon de la souveraineté de notre État au Maroc ?
L’Espagne ne peut être comparée à un tel régime et, par conséquent, tôt ou tard, le président Sánchez devra rendre compte de ce qui s’est passé, ce qui a été fait derrière les canaux diplomatiques, en renonçant aux principes et aux résolutions des Nations unies et à la responsabilité de l’Espagne en tant que puissance colonisatrice. De plus, le Conseil des ministres a été contourné, le Parlement qui a voté contre cette position a été bafoué, et la présence du chef de l’État dans les relations internationales a été omise, remplacée par celle du président Sánchez. En échange de quoi ? J’ose espérer que la semaine prochaine, Sánchez clarifiera tout cela lors du débat sur l’état de la nation.
– L’expansionnisme marocain en procès. Comme l’atteste cette carte du « Grand Maroc », revendiqué par l’Istiqlal dès 1956. Non seulement ce parti ultra nationaliste revendiquait le Sahara occidental, mais également la totalité de la Mauritanie, une partie de l’Algérie et du Mali….
Sánchez a assuré qu’il n’y avait aucun doute sur l’appartenance de Ceuta et Melilla au territoire espagnol. Compte tenu des précédents, le Maroc insistera-t-il sur son intention historique de les annexer ?
La parole de Pedro Sánchez, dans ce cas, ne vaut rien. Dans les relations internationales, les engagements entre deux États sont formalisés par écrit, avec solennité et ratification. Et ici, nous ne savons pas s’il existe un document écrit, mais ce qu’il n’y a certainement pas eu, c’est la publicité, ni la solennité. Ce que Sánchez peut dire ne vaut rien, mais ce que Sánchez peut montrer, et je ne suis pas convaincu. La nuit même du lancement de l’opération Romeo Sierra, contre la prise de Perejil, dont nous fêtons aujourd’hui les 20 ans, le gouvernement a reçu un appel de Mohamed Benaissa, le ministre marocain des affaires étrangères, pour nous dire qu’ils savaient, par les Américains, que nous préparions quelque chose et que nous devions nous désister parce qu’ils quitteraient Perejil si nous quittions aussi le rocher de Vélez de la Gomera, les Chafarinas et Al Hoceima.
Ils assimilaient un territoire nullius aux territoires sous souveraineté espagnole et le Maroc révélait déjà sa véritable mentalité de revendication territoriale sur tout, depuis le détroit de Gibraltar jusqu’à Ceuta et Melilla. Nous ne pouvions pas et ne voulons pas abandonner ces territoires de souveraineté espagnole, mais c’est la mentalité du roi du Maroc, et je ne crois pas qu’elle ait changé du tout au tout à la suite de l’abandon du Sahara, ou de tout autre geste de Sánchez. Quiconque croit le contraire, je suis désolé de le dire, est naïf.
Le Maroc utilise l’immigration clandestine comme moyen de pression. Y aura-t-il désormais un changement de la part du Maroc, comme l’a assuré le gouvernement ?
Cette histoire sans fin a connu récemment trois chapitres regrettables : celui d’il y a un an à Ceuta, qui a été provoqué et dirigé par le Maroc, celui d’il y a quelques mois, et le récent incident malheureux avec les morts que l’on sait. Dans ce dernier cas, il semble que le Maroc ait voulu montrer ses muscles et l’ait fait avec un crime contre l’humanité contre le droit des nations. Donc, ce n’est pas bon non plus. Il faut rappeler que ces immigrés subsahariens se trouvaient au Maroc parce qu’il ne les avait pas autorisés à traverser son territoire, il les avait sur place et les utilisait donc comme chair à canon. Inacceptable. Absolument inacceptable.
En ce qui concerne l’Europe et après le sommet de l’OTAN, que nous avons accueilli, il n’y a eu aucun changement concernant Ceuta et Melilla, mais seulement des références au flanc sud ?
L’OTAN voulait se rétablir à Madrid en tant qu’alliance géopolitique, englobant les démocraties d’Europe occidentale et les deux plus importantes d’Amérique du Nord. Il est vrai qu’elle languissait et que la récente réunion était une relance, j’insiste, de nature politique. Attendons pour voir s’il s’agit également d’une relance du point de vue militaire, car l’engagement de 2 % du PIB est demandé depuis que je suis ministre de la défense et n’a jamais été respecté. Il est vrai que les Américains ont maintenant menacé de partir et que la guerre en Ukraine a montré que, sans eux, l’Europe n’a pas de défense du tout. Mais il me semble que des engagements plus forts n’ont pas été pris, comme, par exemple, le renforcement de la défense européenne avec la programmation d’équipements et d’objectifs qui rendraient crédible une réalité jusqu’ici inexistante et qui ne va guère plus loin que les déclarations – sans doute bien intentionnées, mais toujours rhétoriques – de Josep Borrell.
– Le Makhzen ne recule devant rien pour faire chanter l’Europe avec sa politique migratoire. Il n’a pas hésité à perpétuer un crime contre l’humanité devant l’enclave de Ceuta en laissant les immigrés escalader les barrières avant de les massacrer. Dans ce dernier cas, le Maroc a voulu montrer ses muscles en perpétrant un crime contre l’humanité, contre le droit des nations. Il faut rappeler que ces immigrés subsahariens se trouvaient au Maroc parce qu’il ne les avait pas autorisés à traverser son territoire, il les avait sur place et les utilisait donc comme chair à canon.
Rien n’a changé en ce qui concerne Ceuta et Melilla. J’ai eu l’occasion, en tant que juriste, d’être le rapporteur de l’avis du Conseil d’État sur l’entrée de l’Espagne dans l’OTAN en 1982 et je suis tout à fait clair, et j’étais tout à fait clair à l’époque, que Ceuta et Melilla n’étaient pas couverts par la clause Foederis du traité de Washington parce qu’ils étaient en dehors de la zone. Pour le gouvernement espagnol, qui était pressé, à juste titre, de rejoindre l’Alliance, l’engagement politique du secrétaire général de l’époque, Joseph Luns, selon lequel tant qu’il y aurait des forces espagnoles sur le territoire de Ceuta et Melilla, l’affaire fonctionnerait en cas d’agression. Maintenant, la même chose a été répétée, mais la vérité est l’inverse. Il existe un engagement politique mais pas d’engagement juridique formel.
L’invasion russe en Ukraine a changé de nombreux paradigmes. Comment voyez-vous l’évolution de ce conflit ? Sommes-nous confrontés à une nouvelle guerre froide entre deux nouveaux blocs ?
La guerre en Ukraine a démontré le renforcement du régime autoritaire de Vladimir Poutine à Moscou. Les arguments utilisés ont plus de deux ou trois siècles et ils ne sont pas combattus avec la propagande exclusive des pays européens et les bonnes intentions des armes ou de l’aide humanitaire. Poutine ne va pas abandonner facilement la petite Russie et si l’Europe a un rôle à jouer, et l’OTAN aussi, ils devront le faire par d’autres moyens que ceux qu’ils ont utilisés jusqu’à présent.
Beaucoup de temps a été perdu en rhétorique européenne vide et piétiste qui ne signifie rien pour la guerre en Ukraine.
Je dirai également que la guerre en Ukraine n’est pas une renaissance de la guerre froide car, avec la chute du mur de Berlin, bien d’autres choses sont tombées : d’un ordre polaire, nous sommes passés à un ordre multipolaire ; d’une stratégie de dissuasion nucléaire, nous sommes passés à une absence de stratégie et à une multiplicité de puissances nucléaires ; et, alors qu’il y avait auparavant deux grandes puissances, nous devons ajouter la première grande puissance de la Chine et d’autres puissances émergentes. Par conséquent, l’ordre mondial tout entier doit être repensé, notamment sur le plan institutionnel, car le Conseil de sécurité des Nations unies s’est révélé absolument inutile.
J’ai donc compris que vous êtes en faveur d’une augmentation des dépenses de défense ?
C’est essentiel. Si l’Europe veut être l’Europe, si elle veut être quelque chose, si elle veut être une unité politique, elle doit avoir une politique étrangère commune. Et aucune politique étrangère n’est possible s’il n’y a pas de politique de sécurité et de défense derrière elle. Et il n’y a pas de politique de sécurité et de défense si elle ne prévoit pas des investissements à la mesure des pays qui représentent les principaux risques et menaces.
Y compris une future armée européenne ?
Sans aucun doute.
Sánchez est arrivé à Moncloa en parlant des dépenses de défense comme étant dispensables et en maintenant qu’il aura besoin du Parti Populaire pour sauver l’augmentation parce que ses partenaires ne le soutiennent pas…
Tant que Sanchez est à Moncloa, il n’y aura pas de changement. Il a été comparé à un magicien qui déplace les pièces de telle manière que vous ne savez jamais ce qui va se passer. Et c’est ce qui va se passer ici aussi. Il est maintenant prévu qu’un crédit soit approuvé pour porter les dépenses de défense à 2 % du PIB. Pour y parvenir, tout d’abord, nous devons être conscients qu’il s’agit de dépenses pluriannuelles, de sorte que nous devons concevoir des programmes qui, d’ailleurs, devraient être conjoints, du moins les plus importants, avec d’autres pays européens, dans lesquels nous avons déjà une certaine expérience de coproduction. Mais il faut ensuite les soutenir en termes de budget. Si on me demande mon avis, je crois que le Parti populaire ne peut pas jouer ce jeu, car s’il veut vraiment contribuer, et il le veut certainement, à la défense de l’Espagne et à la défense européenne, il doit exiger du gouvernement un engagement parlementaire ferme, intouchable, d’augmenter les dépenses qui ont été engagées verbalement à l’OTAN pour les dix prochaines années.
Vous parlez de procédures parlementaires, d’engagements à moyen et long terme d’un gouvernement qui a fait déclarer deux états d’alarme anticonstitutionnels…
J’ai soulevé l’inconstitutionnalité des deux décrets annulés par la Cour constitutionnelle auprès du président du Parti populaire de l’époque mais, malheureusement, je n’ai pas été écouté. Il est vrai que j’ai quitté la politique mais pas le droit. La violation de la Constitution était si atroce que deux personnalités, Pedro Cruz Villalón, professeur de droit constitutionnel et ancien président du Tribunal constitutionnel, sur proposition du Parti socialiste, et le meilleur expert espagnol de l’état d’anomalies, c’est-à-dire l’alarme, l’exception et le siège, l’ont dit. Et Manolo Aragón, également ancien vice-président du Tribunal des garanties, professeur de droit et proposé par le Parti socialiste.
Les juges ont demandé au Congrès et au Sénat d’insister sur le renouvellement du CGPJ, comment voyez-vous la paralysie, quelle est la solution appropriée ?
Il me semble que la situation actuelle est la preuve de l’échec retentissant du système, comme l’a déjà fait la Cour constitutionnelle dans la phrase dans laquelle elle a validé le système actuel. Il a dit que c’était constitutionnel, mais en quelque sorte, il a dit mais moins. La chose correcte est que le Conseil fait partie du Conseil. Élu parmi et par les juges et les magistrats. Cela a toujours été ma thèse logique. Malheureusement, je ne l’ai jamais vu se réaliser et je pense que le Parti populaire a raison de plaider pour un retour à ce système et de ne pas entrer dans des négociations de trilogue en tout cas.
Le gouvernement propose maintenant d’annuler la réforme qui empêchait le Conseil de nommer et de contrôler la Cour constitutionnelle, cela invalide-t-il la séparation des pouvoirs ?
Pas seulement ça. C’est un exemple plus grave de l’utilisation perverse de la loi et du mépris de la loi, dont Sánchez a une vision instrumentale, car cela l’arrange. C’est la vieille thèse marxiste remise au goût du jour, aujourd’hui ravivée par cette dernière manifestation de la coalition gouvernementale, pour discréditer le pouvoir judiciaire et l’État de droit.
Aussi avec les grâces ?
Cela devra être décidé par la Cour suprême et c’est à nous de la respecter, mais il me semble que les grâces accordées aux séparatistes, qui sont les partenaires de la coalition de Pedro Sánchez, n’étaient pas appropriées. Le gouvernement s’est laissé aller au discours indépendantiste pour les justifier car il dépend politiquement d’eux pour se maintenir à Moncloa. Ceci étant, il est insupportable, dans la situation dans laquelle se trouve l’Espagne, de prolonger la législature.
Laissez-moi vous dire à l’avance qu’il s’agit d’une autre manipulation de l’histoire, comme la mémoire démocratique. Et le fait est que le discours politique est aujourd’hui complètement manipulé. La seule histoire, la seule vraie histoire de ce qui s’est passé en 2019 en Catalogne est là et nous l’avons vécue. Il n’y a pas besoin de révision. C’est ce qui s’est passé. Ce sont des criminels purs et durs, condamnés par la Cour suprême. Bien sûr, comme Sánchez n’a pas d’alternative à eux et aux autres criminels du Pays basque, il pourra s’en accommoder. Je crois, et je l’ai déjà dit, que Sánchez est un homme qui réinvente chaque jour un mensonge pour rester au pouvoir, ce qui est son seul objectif et il est prêt à tout.
Le dernier en date des récits de victimisation du séparatisme dont nous parlons est le scandale d’espionnage du gouvernement…
Un autre mensonge et un autre travail bâclé. Le CNI agit sur les ordres du gouvernement. Je suis légitimement fier d’avoir été celui qui a conçu la structure juridique du Centre national de renseignement – jusqu’au nom, dérivé de l’ancien CESID, dont j’avais combattu les défauts dans l’opposition – la loi de fonctionnement, la loi et l’autorisation de certaines de ses activités au titre des droits fondamentaux sous l’égide de la Cour suprême et de la Commission pour rendre compte des fonds réservés et des secrets officiels. Par conséquent, je peux dire que tout ce qui a été dit est un gros mensonge. Les partisans de l’indépendance ont fait l’objet d’une enquête du CNI parce que c’était leur obligation, avec l’autorisation préalable de la Cour suprême. Et le gouvernement était au courant, car la CNI ne fait rien dont le gouvernement ne soit pas au courant, puisque c’est lui qui fixe ses objectifs annuels et qui reçoit ses rapports. Ce qui se passe, c’est qu’il est très confortable pour Sánchez de s’asseoir pour négocier en sachant quelles astuces l’autre partie a dans sa poche.
Et la deuxième partie, le truc de Pegasus ? Je n’y crois pas. Que l’Espagne, qui est l’un des pays les plus avancés de l’Europe de l’OTAN, ait vu la présidence du gouvernement et ses ministres écoutés par un pays tiers, ce qui n’aurait pas été détecté par les services de renseignement et par l’intelligence internationale qui se réunit tous les deux ou trois mois à Berne. C’est faux, tout simplement faux. Et la preuve en est que l’on n’a jamais entendu parler d’une telle histoire, inventée un jour par un certain Félix Bolaños.
El Debate
*El Debate en ligne est l’héritier du journal du même nom, qui est devenu l’un des grands journaux espagnols du premier tiers du XXe siècle sous la direction d’Ángel Herrera Oria. Le journal se présente comme le défenseur des « valeurs de l’humanisme chrétien, en plaçant au centre la liberté et la dignité de la personne et le droit à la vie. » Il « soutient l’unité de l’Espagne et son ordre constitutionnel démocratique ainsi que la langue et la culture espagnoles. »
**Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde (Cartagena, 1952) est titulaire d’une licence en droit de l’université de Salamanque et d’un doctorat en droit de l’université Complutense de Madrid. Il s’est engagé dans la marine en tant que premier de sa classe en 1974, où il a été affecté au bureau du procureur de la zone maritime méditerranéenne et, plus tard, à la direction des constructions navales militaires. En 1979, il intègre l’équipe juridique du Conseil d’État par voie de concours sans restriction. Il a pris sa retraite de commandant en 1989 pour entrer en politique, rejoignant les rangs du Partido Popular. Il devient président du Congrès des députés et ministre de la défense dans la première législature de José María Aznar.
Source: Afrique-Asie, 16/07/2022
#Maroc #Espagne #Algérie #Ceuta #Melilla #Sahara_Occidental #Federico_Trillo