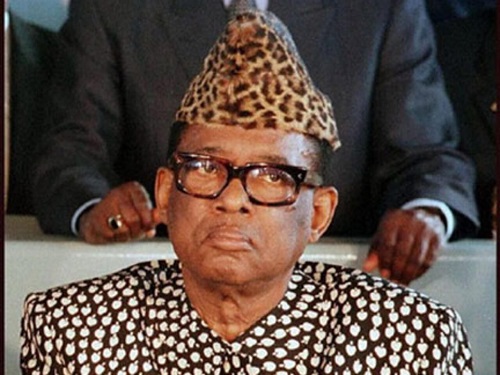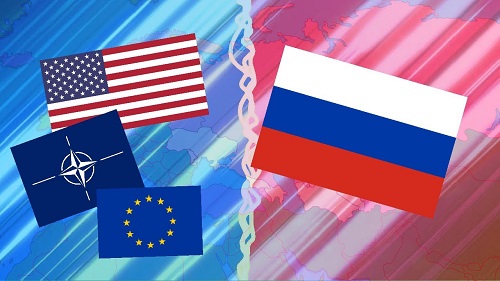Banque Mondiale, FMI, crise alimentaire, Russie, Ukraine, agriculture,
par Eric Toussaint, Omar Aziki
Contrairement à une idée qui s’est largement répandue en 2022, la crise alimentaire mondiale a commencé avant l’invasion russe de l’Ukraine et l’augmentation du prix des céréales provoquées par la spéculation. A l’échelle planétaire, entre 2014 et 2021, le nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire grave a augmenté de plus de 350 millions, passant de 565 millions à 924 millions. L’augmentation a été particulièrement forte entre 2019 et 2021, elle a concerné un peu plus de 200 millions de personnes. En 2021, quelque 2,3 milliards de personnes (29,3 pour cent de la population mondiale) étaient en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave [1]. En 2022, tous les indicateurs sont au rouge et le Conseil de sécurité des Nations unies a même été réuni le 17 mai 2022 pour débattre de comment faire face à la crise alimentaire qui pourrait provoquer des révoltes populaires.
Comment expliquer qu’on soit toujours confronté à la faim au 21e siècle ?
C’est le résultat du modèle de l’agrobusiness qui cherche non pas à nourrir les populations mais à réaliser des surprofits. C’est beaucoup plus flagrant dans les pays du Sud global où les programmes d’ajustement structurel du FMI et la Banque mondiale ont encouragé une agriculture intensive d’exportation selon les critères de concurrence et de rentabilité sur le marché mondial et ont marginalisé le secteur de la production vivrière et l’agriculture paysanne qui fournit pourtant 70% de la production de nourriture au niveau mondial [2]. Les aliments sont transformés en marchandises soumises à la spéculation sur le marché mondial où une poignée de grandes multinationales fixent les prix.
Ces grandes entreprises de l’agrobusiness bénéficient de subventions publiques, accaparent de plus en plus de terres pour l’extension de la production d’agrocarburants et les ressources en eau pour des cultures hyper consommatrices, détruisent les semences paysannes au profit des hybrides et des OGM, généralisent l’utilisation des engrais chimiques et des pesticides.
Ce modèle de production augmente considérablement la vulnérabilité des cultures face aux chocs externes et contribue énormément au changement climatique et aux sécheresses qui affectent l’agriculture pluviale et tarissent les nappes phréatiques. Il est directement lié au système capitaliste mondial et à sa crise multiforme dont la crise alimentaire est une des manifestations.
Quelle est l’ampleur de la crise sur le plan humanitaire ?
En Afrique, environ 60% de la population sont touchés par l’insécurité alimentaire modérée et 20 % par l’insécurité alimentaire graveUn être humain sur 10 souffre en permanence de la faim. Selon un critère plus large qui est élaboré par la FAO et d’autres organismes onusiens, 30 % de la population mondiale souffrent de manière modérée de l’insécurité alimentaire. Si on se concentre sur le continent africain, toujours selon la FAO, environ 60% de la population est touchée par l’insécurité alimentaire modérée et 20 % par l’insécurité alimentaire grave, ces chiffres risquant d’augmenter fortement avec l’instabilité climatique.
En 2020, « on estime que 45 millions d’enfants de moins de 5 ans souffraient d’émaciation, la forme la plus mortelle de malnutrition, qui peut multiplier par 12 le risque de décès chez les enfants. En outre, 149 millions d’enfants de moins de 5 ans présentaient un retard de croissance et de développement en raison d’un manque chronique de nutriments essentiels dans leur alimentation [3] ». 45% des décès d’enfants de moins de 5 ans sont dus à la malnutrition, cela représente 3,1 millions d’enfants.
« En 2021, l’écart entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l’insécurité alimentaire s’est encore accentué : 31,9 pour cent des femmes dans le monde étaient en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave, contre 27,6 pour cent des hommes – un écart de plus de 4 points de pourcentage, contre 3 points de pourcentage en 2020 [4] ».
Selon un communiqué de l’Unicef du 23 juin 2022 : « Dans 15 pays actuellement touchés par une crise, près de 8 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans risquent de décéder des suites d’une émaciation sévère s’ils ne reçoivent pas des aliments thérapeutiques et des soins immédiats (…). Depuis le début de l’année, la crise alimentaire mondiale n’a cessé de s’amplifier, l’émaciation sévère touchant 260 000 enfants supplémentaires (soit un toutes les 60 secondes) dans les 15 principaux pays concernés, notamment dans la Corne de l’Afrique et le centre du Sahel. » Unicef ajoute : « En parallèle, le prix des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi visant à traiter l’émaciation sévère a augmenté de 16 % ces dernières semaines en raison d’une envolée du coût des matières premières, privant jusqu’à 600 000 enfants supplémentaires de ce traitement d’importance vitale et mettant ainsi leur vie en danger. »
Structurellement, une majorité des personnes victimes de la faim appartient paradoxalement à la population rurale. Ce sont en majorité des familles de producteurs agricoles qui ne possèdent pas de propriétés ou pas assez de terres, ni de moyens pour les mettre en valeur et qui doivent vendre sur le marché le plus de produits agricoles notamment pour rembourser leurs dettes en privant leur famille d’une nourriture suffisante. Il y a bien sûr également les populations urbaines les plus appauvries.
Quelques définitions fournies par l’Organisation mondiale de la santé et l’Unicef :
Insécurité alimentaire modérée : niveau de gravité de l’insécurité alimentaire se caractérisant par le fait que les personnes concernées ne sont pas certaines de pouvoir se procurer à manger et ont été contraintes, à un moment ou à un autre durant l’année, de réduire la qualité et/ou la quantité des aliments consommés, en raison d’un manque d’argent ou d’autres ressources. L’insécurité alimentaire modérée renvoie donc à un manque de régularité dans l’accès à la nourriture, qui diminue la qualité de l’alimentation et perturbe les habitudes alimentaires normales. Elle est déterminée à partir de l’échelle de l’insécurité alimentaire vécue.
Insécurité alimentaire grave : niveau de gravité de l’insécurité alimentaire se caractérisant par le fait que, à un moment dans l’année, les personnes concernées ont épuisé leurs réserves alimentaires, ont connu la faim et, au degré le plus avancé, sont restées un ou plusieurs jours sans manger. Il est déterminé à partir de l’échelle de l’insécurité alimentaire vécue.
Sous-alimentation : situation dans laquelle la consommation alimentaire habituelle d’un individu est insuffisante pour fournir l’apport énergétique alimentaire nécessaire à une vie normale, active et saine. La prévalence de la sous-alimentation est utilisée pour mesurer la faim.
Émaciation : L’émaciation constitue une forme mortelle de malnutrition qui amaigrit et affaiblit les enfants et les expose à un risque accru de décès, ainsi que de problèmes de croissance, de développement et d’apprentissage. En 2022, plus de 45 millions d’enfants de moins de 5 ans en souffrent.
Émaciation sévère : Caractérisée par une maigreur extrême de l’enfant par rapport à sa taille en raison d’un affaiblissement du système immunitaire, l’émaciation sévère est la forme de malnutrition la plus immédiate, la plus visible et la plus mortelle. En 2022, plus de 13 millions d’enfants de moins de 5 ans en sont victimes.
Cité par le quotidien Le Monde, Émile Frison, membre du panel international d’experts sur les systèmes alimentaires durables (IPES-food), déclare : « il ne faut pas qu’on se trompe en se disant que c’est uniquement à cause du Covid et de la guerre en Ukraine qu’on assiste à une crise alimentaire, et que, si ces problèmes sont surmontés, les choses vont s’arranger ». Mathilde Gérard, journaliste au Monde ajoute : « Ces deux événements internationaux majeurs ont en réalité exacerbé des difficultés structurelles qui les précèdent » (Source : Mathilde Gérard, « Sous-alimentation : près d’une personne sur dix souffre de la faim dans le monde, un chiffre en forte hausse depuis deux ans », Le Monde, 6 juillet 2022)
La crise alimentaire mondiale n’est pas provoquée par une réduction de la production de céréales ou d’autres aliments
La crise alimentaire mondiale n’est pas provoquée par une pénurie mondiale de production d’aliments. En effet, la production alimentaire mondiale augmente plus rapidement que la croissance démographique depuis plus d’un demi-siècle. En 2021, la récolte de céréales a dépassé un record historique.
Mais il est important de souligner qu’une partie croissante des aliments produits ne sert pas à l’alimentation humaine. Les gouvernements du Nord encouragent la production d’agrocarburants, appelés à tort biocarburants afin de créer une réaction positive de l’opinion publique. Dans un article d’avril 2022, Jean-François Collin, haut fonctionnaire et ex-conseiller au ministère de l’agriculture met en évidence « l’augmentation considérable des usages industriels de la production céréalière mondiale (…), notamment la production d’éthanol : 30 % de l’augmentation de la production mondiale des cinquante dernières années ont été consacrés au développement des usages industriels des céréales. Cela concerne principalement le maïs mais également le blé. (…) Environ 200 millions de tonnes de maïs américains sont transformées chaque année en éthanol incorporé dans le carburant des véhicules automobiles. 10 % des céréales produites dans le monde servent aujourd’hui de carburant. On pourrait ajouter les surfaces consacrées à d’autres plantes qui ne sont pas des céréales, comme le colza, le soja ou l’huile de palme avec lesquels on produit du diester également utilisé comme carburant. Ce sont autant de surfaces qui ne sont pas consacrées à la production de blé ou de riz susceptible d’alimenter directement des humains. »
Il est également important de souligner que plus d’un tiers de la production mondiale de céréales, 35% selon J-F Collin, est destiné à l’alimentation des animaux d’élevage.
Une poignée de sociétés transnationales contrôlent largement le marché des céréales, formant un oligopole, et augmentent en permanence leurs profits et leur fortune sur le dos des populations. Au niveau planétaire, quatre sociétés, dont trois sont étasuniennes et une est française, contrôlent 70% du marché international des céréales. Elles jouent un rôle fondamental dans la fixation des prix et de l’approvisionnement. Il s’agit de Archer Daniels Midland, De Bunge, Cargill et Louis Dreyfus, souvent désignés par le sigle ABCD.
Prenons le cas de Cargill, voici ce qu’en dit Oxfam international dans un rapport récent : « Cargill est un géant mondial de l’agroalimentaire et l’une des plus grandes sociétés privées du monde. En 2017, elle a été répertoriée parmi les quatre entreprises qui contrôlent ensemble plus de 70 % du marché mondial des produits de base agricoles. Elle est détenue à 87 % par la onzième famille la plus riche du monde. La richesse cumulée des membres de cette famille figurant sur la liste des milliardaires de Forbes est de 42,9 milliards de dollars – et leur fortune s’est accrue de 14,4 milliards depuis 2020, augmentant de près de 20 millions de dollars par jour pendant la pandémie. Cette augmentation est due à la hausse des prix des denrées alimentaires, en particulier des céréales. Par ailleurs, quatre autres membres de la grande famille Cargill ont récemment rejoint la liste des 500 personnes les plus riches du monde. En 2021, la société a enregistré des recettes nettes de 5 milliards de dollars et réalisé les plus gros bénéfices de son histoire. L’année précédente, elle a versé des dividendes de 1,13 milliard de dollars, dont la plupart étaient destinés aux membres de la famille. La société devrait à nouveau obtenir des bénéfices record en 2022, venant grossir encore la fortune déjà colossale de la famille. »
Oxfam ajoute : « Selon Bloomberg, Cargill n’est pas la seule entreprise à réaliser des bénéfices importants en tirant parti des pénuries alimentaires et de la volatilité des marchés. L’un des concurrents de l’entreprise, la société de commerce agricole Louis Dreyfus Co., a déclaré en mars avoir réalisé 82 % de plus de bénéfices l’année dernière, en grande partie grâce aux fluctuations du prix des céréales et aux fortes marges sur les graines oléagineuses » (Source : Oxfam, « Quand la souffrance rapporte gros. Face à l’explosion de la fortune des milliardaires et alors que le coût de la vie grimpe en flèche, il est urgent de taxer les plus riches », publié le 23 mai 2022)
Ce contrôle sur le commerce des aliments a ainsi permis à ces entreprises de l’agroindustrie, mais aussi aux grandes chaines commerciales telles que Wallmart ou Carrefour, d’imposer des hausses de prix en 2021 de l’ordre de 30% [5].
Autres causes fondamentales de la crise alimentaire, les politiques néolibérales d’ouverture des marchés que nous analysons plus loin. En effet, celles-ci ont rendu les pays du Sud global de plus en plus dépendants de leurs importations de céréales (voir plus loin la critique des différentes politiques appliquées par les pays du Sud sous pression des institutions comme la BM et le FMI mais aussi de leurs propres classes dominantes). En cas de choc extérieur entrainant une augmentation des prix sur le marché mondial et/ou une difficulté d’approvisionnement, les pays du Sud global, qui ne produisent pas de céréales en suffisance, sont directement touchés.
Parmi les facteurs récents qui ont aggravé la crise alimentaire, il y a l’énorme spéculation qui a eu lieu sur les marchés des céréales dès le lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les prix du blé et du maïs ont augmenté de près de 50% en une quinzaine de jours alors qu’il n’y avait à ce moment-là aucune destruction de la production et aucun problème d’approvisionnement. Il s’agissait de spéculation pure de la part des grandes sociétés privées qui achètent des stocks de céréales (y compris des récoltes futures) dans les bourses de céréales dont la principale se trouve à Chicago. Le prix du riz a également augmenté, mais plus modérément.
Immédiatement, les grandes sociétés de commercialisation, les grandes surfaces, ont augmenté le prix des aliments et cela sans justification.
Au moment où ces lignes sont écrites à la fin août 2022, au cours des trois derniers mois, le prix du blé à la bourse de Chicago a baissé de 32% et le prix du maïs a baissé de 22%, mais cela ne s’est pas répercuté par une baisse des prix au détail.
Les prix au détail pour les consommateurs/trices des classes populaires ont fortement augmenté et il est peu probable qu’ils baisseront, les gouvernants n’appliquant pas de politique de contrôle ou de fixation des prix. Les grandes entreprises privées sont en effet libres de les fixer selon leur bon vouloir.
La crise alimentaire n’a pas débuté avec l’invasion de l’Ukraine
A l’échelle planétaire, en réalité la situation se dégrade depuis 2014.
Alors qu’on avait connu une crise alimentaire très grave en 2007-2008 (voir notre explication de la crise de 2007-2008) amenant à plus de 800 millions le nombre de personne souffrant de la faim, la situation s’était améliorée entre 2009 et 2013 pour se dégrader à nouveau à partir de 2014 (voir les tableaux 1 et 2).
Tableau 1 : Évolution du nombre de personnes ayant vécu une situation d’insécurité alimentaire grave (en millions)
A l’échelle planétaire, entre 2014 et 2021, le nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire grave a augmenté de plus de 350 millions, passant de 565 millions à 924 millions
Tableau 2 : Nombre de personnes ayant vécu une situation d’insécurité modérée en 2015, 2019 et 2020 (en millions)
Est-il possible d’éradiquer la faim ?
Éradiquer la faim, c’est tout à fait possible. Les solutions fondamentales pour atteindre cet objectif vital, passent par un projet de souveraineté alimentaire alternatif au modèle de l’agrobusiness intensif. La souveraineté alimentaire est le droit de chaque pays de maintenir et développer sa propre capacité à produire son alimentation de base. Elle suppose la protection des ressources naturelles, notamment la terre, les eaux et les semences. Elle place les producteurs/trices, distributeurs/trices et consommateurs/trices des aliments au cœur des systèmes et politiques alimentaires en lieu et place des exigences des marchés et des transnationales. Elle vise donc à nourrir la population à partir de l’effort des producteurs/trices au niveau local, tout en limitant les importations et les exportations.
Pour avancer vers la souveraineté alimentaire, il faut mettre l’agroécologie au cœur des décisions politiques des gouvernements. L’agroécologie est une alternative au modèle néolibéral productiviste. Elle garantit les droits collectifs de la paysannerie, protège la biodiversité, renforce les systèmes alimentaires locaux, et valorise le travail des femmes qui est littéralement vital.
Cela permettra de disposer d’une alimentation de qualité : sans OGM, sans pesticides, sans herbicides, sans engrais chimiques. Mais pour atteindre cet objectif-là, il faut que plus de 3 milliards de paysans puissent accéder à la terre en quantité suffisante et la travailler pour leur compte au lieu d’enrichir les grands propriétaires, les transnationales de l’agrobusiness, les commerçants et les prêteurs. Il faut aussi qu’ils disposent, grâce à l’aide publique, des moyens pour cultiver la terre (sans l’épuiser).
Pour ce faire, il faut une réforme agraire, réforme qui manque toujours cruellement, que ce soit au Brésil, en Bolivie, au Paraguay, au Pérou, en Asie ou dans certains pays d’Afrique. Une telle réforme agraire doit organiser la redistribution des terres en interdisant les grandes propriétés terriennes privées et en fournissant un soutien public au travail des agriculteurs. Elle doit s’opposer aux politiques agraires mises en œuvre par la Banque mondiale, par des fondations comme la Fondation Bill Gates et des multinationales qui favorisent de grandes opérations d’accaparement de terres.
Elle doit préserver les forêts existantes et encourager le reboisement, stopper la privatisation et la marchandisation des ressources hydriques, éviter la monoculture à l’origine de dégradations des sols…
Il est important de souligner que le FMI et surtout la Banque mondiale ont d’énormes responsabilités dans la crise alimentaire car ce sont notamment ces institutions qui ont poussé les États à se connecter de plus en plus aux marchés internationaux en accroissant leur dépendance, à supprimer les aides aux petits producteurs et à offrir une place de choix aux transnationales de l’agrobusiness. Le FMI et la Bm ont recommandé aux gouvernements du Sud de supprimer les silos à grains qui servaient à alimenter le marché intérieur en cas d’insuffisance de l’offre et/ou d’explosion des prix. La Banque mondiale et le FMI ont poussé les gouvernements du Sud à supprimer les organismes de crédit public aux paysans et ont poussé ceux-ci dans les griffes des prêteurs privés (souvent de grands commerçants) ou des banques privées qui pratiquent des taux usuriers. Cela a provoqué l’endettement massif des petits paysans, que ce soit en Inde, au Mexique, en Égypte ou dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne. Selon les enquêtes officielles, le surendettement des paysans qui touche les paysans indiens est la cause principale du suicide de plus de 400 000 paysans en Inde au cours des 25 dernières années. C’est un pays où précisément la Banque mondiale s’est employée avec succès à convaincre les autorités de supprimer les agences publiques de crédit aux agriculteurs. Et ce n’est pas tout : au cours des 50 dernières années, la Banque mondiale et le FMI ont aussi poussé les pays tropicaux et autres pays du sud global à réduire leur production de blé, de riz ou de maïs pour les remplacer par des cultures d’exportation (cacao, café, thé, bananes, arachide, fleurs, coton…). Enfin, pour parachever leur travail en faveur des grandes sociétés de l’agrobusiness et des grands pays exportateurs de céréales (en commençant par les États-Unis, le Canada et l’Europe), ils ont poussé les gouvernements à ouvrir toutes grandes les frontières aux importations de nourriture qui bénéficient de subventions massives de la part des gouvernements du Nord, ce qui a provoqué la faillite de nombreux producteurs/trices du Sud et une très forte réduction de la production vivrière locale.
En résumé, il est nécessaire de mettre en œuvre la souveraineté alimentaire, promouvoir l’agroécologie et appliquer la réforme agraire. Il faut abandonner la production des agro-carburants industriels et bannir les subventions publiques à ceux qui les produisent. Il faut également recréer au Sud des stocks publics de réserves d’aliments (en particulier de grains : riz, blé, maïs…), (re)créer des organismes publics de crédit aux agriculteurs/trices et rétablir une régulation des prix des aliments. Il faut garantir que les populations à bas revenu puissent bénéficier de bas prix pour des aliments de qualité. Il faut supprimer la TVA sur les aliments de base. L’État doit garantir aux petits producteurs/trices agricoles des prix de vente suffisamment élevés afin de leur permettre d’améliorer nettement leurs conditions de vie. L’État doit également développer les services publics dans les milieux ruraux (santé, éducation, communications, culture, « banques » de semences…). Les pouvoirs publics sont parfaitement à même de garantir à la fois des prix subventionnés aux consommateurs d’aliments et des prix de vente suffisamment élevés pour les petits producteurs agricoles afin qu’ils disposent de revenus suffisants.
Ce combat contre la faim n’est-il pas partie prenante d’un combat bien plus vaste ?
On ne peut prétendre sérieusement lutter contre la faim sans s’attaquer aux causes fondamentales de la situation actuelle. La dette est l’une d’entre elles, et les effets d’annonce sur ce thème, fréquents ces dernières années comme lors des sommets du G7 ou du G20, masquent mal que ce problème demeure entier. La crise globale qui touche le monde aujourd’hui aggrave la situation des pays en développement face au coût de l’endettement et de nouvelles crises de la dette au Sud sont en préparation. Ce qui se passe en 2022 au Sri Lanka ou en Argentine en sont des exemples criants. Or cette dette a conduit les peuples du Sud, souvent pourvus en richesses humaines et naturelles considérables, à un appauvrissement massif. Le système dette est un pillage organisé auquel il est urgent de mettre fin.
En effet, le mécanisme infernal de la dette publique illégitime est un obstacle essentiel à la satisfaction des besoins humains fondamentaux, parmi lesquels l’accès à une alimentation décente. Sans aucun doute, la satisfaction des besoins humains fondamentaux doit primer sur toute autre considération, géopolitique ou financière. Sur un plan moral, les droits des créanciers, rentiers ou spéculateurs ne font pas le poids par rapport aux droits fondamentaux de huit milliards de citoyens, piétinés par ce mécanisme implacable que représente la dette.
Il est immoral de demander aux peuples des pays appauvris par une crise globale dont ils ne sont nullement responsables de consacrer une grande partie de leurs ressources au remboursement de créanciers aisés (qu’ils soient du Nord ou du Sud) plutôt qu’à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. L’immoralité de la dette découle également du fait qu’elle a très souvent été contractée par des régimes non démocratiques qui n’ont pas utilisé les sommes reçues dans l’intérêt de leurs populations et ont souvent organisé des détournements massifs d’argent, avec l’accord tacite ou actif des États du Nord, des créanciers privés du Nord, de la Banque mondiale et du FMI. Les créanciers des pays les plus industrialisés ont prêté en connaissance de cause à des régimes souvent corrompus. Ils ne sont pas en droit d’exiger des peuples qu’ils remboursent ces dettes immorales et illégitimes.
En somme, la dette est un des principaux mécanismes par lesquels une nouvelle forme de colonisation s’opère au détriment des peuples. Elle vient s’ajouter à des atteintes historiques portées également par les pays riches : esclavage, extermination de populations indigènes, joug colonial, pillage des matières premières, de la biodiversité, du savoir-faire des paysans (par le brevetage au profit des transnationales de l’agrobusiness du Nord des produits agricoles du Sud comme le riz basmati indien) et des biens culturels, fuite des cerveaux, etc. Il est plus que temps de remplacer la logique de domination par une logique de redistribution de richesses dans un souci de justice.
Le G7, le FMI, la Banque mondiale et le Club de Paris imposent leur propre vérité, leur propre justice, dont ils sont à la fois juge et partie. Depuis la crise de 2007-2009, le G20 a pris le relais du G7 et a contribué à remettre le FMI discrédité et délégitimé au centre du jeu politique et économique en particulier à l’égard du Sud Global. Il faut mettre fin à cette injustice qui profite aux oppresseurs, qu’ils soient du Nord ou du Sud.
Le CADTM soutient avec enthousiasme les propositions et les revendications avancées par le mouvement paysan international La Via Campesina pour faire face à la crise alimentaire actuelle et aller vers la souveraineté alimentaire. Nous les reproduisons intégralement.
« Face à ce contexte dramatique, La Via Campesina exprime des exigences et des propositions fortes pour faire face à la crise, tant à court qu’à long terme.
Nous exigeons une action immédiate pour :
La fin de la spéculation sur les denrées alimentaires et la suspension de la cotation des denrées alimentaires en bourse. Les contrats à terme sur les matières premières agricoles devraient être interdits immédiatement. Le prix des denrées alimentaires faisant l’objet d’un commerce international doit être lié aux coûts de production et respecter les principes du commerce équitable, tant pour les producteurs, productrices que pour les consommateurs, consommatrices ;
La fin de l’OMC dans le contrôle du commerce alimentaire, ainsi que les accords de libre-échange. En particulier, les règles de l’OMC qui empêchent les pays de développer des réserves alimentaires publiques et la régulation des prix et des marchés doivent être immédiatement suspendues, afin que les pays puissent développer les politiques publiques nécessaires pour soutenir les petits producteurs et les petites productrices dans ce contexte difficile ;
Une réunion d’urgence du Comité de la sécurité alimentaire et la création d’un nouvel organisme international chargé de mener des négociations transparentes sur les accords de produits de base entre les pays exportateurs et importateurs, afin que les pays devenus dépendants des importations de denrées alimentaires puissent avoir accès à des aliments à des prix abordables ;
L’interdiction d’utiliser des produits agricoles pour produire des agrocarburants ou de l’énergie. La nourriture doit être une priorité absolue par rapport au carburant.
Un moratoire mondial sur le remboursement de la dette publique par les pays les plus vulnérables. Dans le contexte actuel, faire pression sur certains pays très vulnérables pour qu’ils remboursent leur dette est tout à fait irresponsable et conduit à une crise alimentaire. Nous demandons la fin des pressions exercées par le FMI pour démanteler les politiques publiques nationales et les services publics. Nous demandons l’annulation de la dette publique extérieure illégitime dans les pays en développement.
Nous demandons des changements radicaux dans les politiques internationales, régionales et nationales afin de reconstruire la souveraineté alimentaire à travers :
Un changement radical de l’ordre commercial international. L’OMC doit être démantelée. Un nouveau cadre international pour le commerce et l’agriculture, basé sur la souveraineté alimentaire, doit ouvrir la voie au renforcement des agricultures paysannes locales et nationales et garantir une base stable pour la production alimentaire relocalisée et le soutien des marchés locaux et nationaux dirigés par les paysans et paysannes. Le système commercial international doit être équitable et basé sur la coopération et la solidarité plutôt que sur la concurrence et la spéculation ;
La mise en œuvre d’une réforme agraire populaire et globale, pour mettre fin à l’accaparement de l’eau, des semences et des terres par les sociétés transnationales, et pour garantir aux petits producteurs et petites productrices des droits équitables sur les ressources productives. Nous protestons contre la privatisation et l’accaparement des écosystèmes et des ressources naturelles par des intérêts privés sous le prétexte de protéger la nature, par le biais des marchés du carbone ou d’autres programmes de compensation de la biodiversité, sans considération pour les personnes qui vivent dans les territoires et prennent soin des ressources depuis des générations ;
Un changement radical vers l’agroécologie, afin de produire une alimentation saine en quantité et en qualité pour l’ensemble de la population. Nous devons garder à l’esprit que la crise climatique et environnementale est notre grand défi dans le contexte actuel et que nous devons relever le défi de produire suffisamment de nourriture de qualité tout en ravivant la biodiversité et en réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre.
Une régulation efficace du marché des intrants (crédit, engrais, pesticides, semences, carburant…) pour soutenir la capacité des paysans et paysannes à produire des aliments, mais aussi pour assurer une transition équitable et bien planifiée vers des pratiques agricoles plus agroécologiques ;
Une gouvernance alimentaire basée sur les intérêts des peuples et non sur des entreprises transnationales. Aux niveaux mondial, régional, national et local, il faut mettre un terme à la mainmise des multinationales sur la gouvernance alimentaire et placer les intérêts des populations au centre. Les petits producteurs et les petites productrices doivent être reconnus comme ayant un rôle clé à jouer dans tous les organes de gouvernance alimentaire ;
La transformation de la déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et paysannes en un instrument juridiquement contraignant pour la défense des populations rurales.
Le développement des capacités de stockage public dans chaque pays. La stratégie de constitution de réserves alimentaires doit être mise en œuvre à la fois au niveau national et par la création et le soutien public de réserves alimentaires au niveau communautaire avec des aliments produits localement à partir de pratiques agricoles agro-écologiques ;
Un moratoire mondial sur les technologies dangereuses qui menacent l’humanité, comme la géo-ingénierie, les OGM ou la viande cellulaire. La promotion de techniques peu coûteuses qui augmentent l’autonomie des paysans et paysannes et les semences paysannes.
Le développement de politiques publiques pour assurer de nouvelles relations entre ceux et celles qui produisent les aliments et ceux et celles qui les consomment, ceux et celles qui vivent dans les zones rurales et ceux et celles qui vivent dans les zones urbaines, en garantissant des prix équitables définis sur la base du coût de production, permettant un revenu décent pour tous ceux et celles qui produisent dans les campagnes et un accès équitable à une alimentation saine pour les consommateurs et consommatrices ;
La promotion de nouvelles relations de genre basées sur l’égalité et le respect, tant pour les personnes vivant à la campagne que pour la classe ouvrière urbaine. La violence à l’égard des femmes doit cesser maintenant.
Les auteurs remercient Pablo Laixhay et Brigitte Ponet pour leur relecture.
Nous vous recommandons la lecture de ce communiqué de presse du CADTM -> 2022 : Mettons fin à la crise alimentaire
—————–
Notes
[1] FAO : L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Édition 2022. https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0639en
[2] La FAO déclare elle-même que les « agriculteurs familiaux (…) produisent plus de 70% de la nourriture dans le monde et plus de 80% en valeur dans les pays en développement » Voir la fin de la déclaration suivante https://www.fao.org/news/story/fr/item/1175255/icode/
[3] Communiqué de presse de l’Organisation mondiale de la Santé, 6 juillet 2022, https://www.who.int/fr/news/item/06-07-2022-un-report–global-hunger-numbers-rose-to-as-many-as-828-million-in-2021
[4] Communiqué de presse de l’Organisation mondiale de la Santé, 6 juillet 2022.
[5] Oxfam, « QUAND LA SOUFFRANCE RAPPORTE GROS, Face à l’explosion de la fortune des milliardaires et alors que le coût de la vie grimpe en flèche, il est urgent de taxer les plus riches », publié le 23 mai 2022 https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2022/05/Final-Davos-Media-Brief-12.5.22_FR-final.pdf , p. 6.
CADTM, 5 septembre 2022
#FM #BM