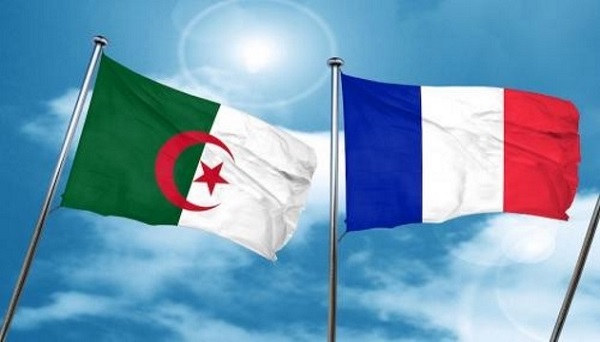Etiquettes : Sénégal, Osmane Sonko, Macky Sall,
Au moins 15 personnes ont perdu la vie et plus de 500 ont été arrêtées au cours de quatre jours de manifestations violentes au Sénégal. Les manifestations ont commencé jeudi 1er juin 2023, lorsque le chef de l’opposition Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison pour « séduction d’un mineur » par un tribunal de Dakar.
Lorsque la nouvelle du verdict s’est répandue jeudi, les jeunes partisans d’Ousmane Sonko sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère. Ils ont été accueillis par des balles réelles et des gaz lacrymogènes.
Alors que les autorités sénégalaises ont confirmé 15 morts et plus de 500 manifestants arrêtés, les organisations de défense des droits humains affirment qu’il y a plusieurs autres morts et des centaines de blessés dans les hôpitaux du pays, dont de nombreux mineurs. Des enfants ont été placés en garde à vue par la police et violemment battus, preuves en étant plusieurs vidéos. Des photos et des vidéos sur les médias sociaux montrent des « nervis », des hommes armés en civil soupçonnés d’être des mercenaires sur la liste de paie du parti gouvernemental, faisant des rondes dans des Toyota Pick-ups blanches appartenant au gouvernement, tirant sur des manifestants.
LIRE AUSSI : Sénégal : Communiqué du « Mouvement Y en a marre »
Affrontements violents
Les universités, les écoles et les magasins ont été fermés lorsque les manifestations se sont transformées en affrontements violents. Les médias sociaux et une chaîne privée, Walf TV, ont été fermés par le gouvernement afin de « les empêcher de diffuser des messages subversifs, incitant à la violence et à la haine ». Le dimanche 4 juin, alors que l’opposition appelait à une manifestation massive, Internet a été complètement fermé.
Nous avons parlé à plusieurs jeunes au Sénégal qui étaient dans une situation de crise après les nombreuses scènes de violence dont ils avaient été témoins. Ils nous ont dit qu’à l’exception de la capitale Dakar, des villes comme Thiès, Kaolack, Bargny, St Louis dans le nord et Ziguinchor dans la province méridionale de Casamance – la ville natale de Sonko – avaient été secouées par les manifestations. Les médias sociaux ont été inondés de photos de jeunes qui viennent d’être tués, ensanglantés, grièvement blessés par balles, même d’enfants utilisés comme boucliers par des soldats ou violemment battus alors qu’ils étaient détenus par la police et des hommes en civil.
Aucune des personnes à qui nous avons parlé n’a voulu révéler son nom ou son emplacement. Leur crainte de représailles violentes est évidente depuis l’annonce de l’arrestation d’Aliou Sané, coordinateur du mouvement Y’en a Marre (Nous en avons assez) le 29 mai, puis de Bentaleb Sow et Tapha Diop du mouvement FRAPP le 31 mai, de Moustapha Diop de FRAPP le 1er juin, puis de Pape Abdoulaye Touré, étudiant et jeune opposant de premier plan avec une forte présence sur les réseaux sociaux au Sénégal. Des photos de Pape Abdoulaye Touré ont fait le tour des réseaux sociaux, le montrant roué de coups et menotté après avoir été placé en garde à vue.
LIRE AUSSI : Sénégal : Macky Sall arrête des centaines de personnes dans un contexte politique tendu
« Les prisonniers doivent être libérés »
Amnesty International a demandé au gouvernement sénégalais de mettre fin aux arrestations arbitraires et de libérer sans condition toutes les personnes détenues en raison de leurs activités politiques. La communauté internationale, y compris le pays voisin Gambie, la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), l’Union africaine, la France et les États-Unis, ont fait des déclarations appelant le gouvernement sénégalais à mettre fin à la violence et à laisser chacun être libre d’exprimer son point de vue.
L’opposition politique a qualifié la procédure judiciaire contre Sonko, qui dure depuis deux ans, de « montage frauduleux ». Ils affirment que le gouvernement a fait pression sur le système judiciaire pour condamner Sonko afin qu’il ne puisse pas participer aux élections de 2024. Sonko était le troisième candidat le plus populaire aux dernières élections, avec 16% des voix, et de nombreux jeunes partisans. Mais depuis que des accusations de viol l’ont amené devant les tribunaux en 2021, bien qu’il ait maintenant été libéré des accusations initiales, le nouveau tournant dans l’affaire pourrait l’empêcher d’être candidat aux élections de 2024.
Sonko n’était pas présent en personne au tribunal jeudi car il est maintenu en résidence surveillée. L’ordre de détention n’a pas encore été confirmé. Selon l’avocat de Sonko, il est toujours possible de faire appel de la sentence, mais Sonko doit d’abord aller en prison.
Le Sénégal, un pays d’Afrique de l’Ouest qui, pendant de nombreuses années, s’est enorgueilli d’être l’un des pays les plus pacifiques d’Afrique, a une longue tradition de non-violence et de liberté d’expression. Mais au cours des dernières années, à l’approche de 2021, lorsque de nombreux jeunes ont perdu la vie lors des manifestations contre l’arrestation d’Ousmane Sonko, le climat politique a radicalement changé. Un nombre croissant de journalistes et de militants des droits de l’Homme ont été exposés à des menaces de la part du gouvernement et, en 2022, le classement du pays dans le classement mondial de la liberté de la presse géré par RSF, Reporters sans frontières, est passé de la 49e à la 73e place sur 180 pays. Cette année, dans le Classement mondial de la liberté de la presse 2023, le Sénégal a encore chuté à la 104e place, juste au-dessus du Qatar, avec la motivation que « l’augmentation des menaces verbales, physiques et judiciaires contre les journalistes alimente les inquiétudes quant à un déclin de la liberté de la presse ».
LIRE AUSSI : Sénégal : Macky Sall espionné par ses maîtres de l’Elysée
Un journaliste d’investigation emprisonné
En novembre 2022, le journaliste Pape Ali Niang, rédacteur en chef du portail d’information Dakar Matin, a été arrêté pour « atteinte à la sécurité nationale » et « diffusion de fausses nouvelles », pour avoir dénoncé, entre autres, la corruption révélée par un réseau mondial de journalistes d’investigation, l’OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project.
L’OCCRP a déterré plusieurs histoires sur la corruption au Sénégal et dispose des documents pour les prouver. Les affaires qui ont été couvertes par l’OCCRP sont les transactions dans les réserves pétrolières offshore du Sénégal, l’histoire d’un ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères soupçonné d’avoir participé à deux stratagèmes de corruption de plusieurs millions, puis l’un des scandales les plus illustres – un contrat d’armement de 77 millions de dollars signé en 2022 par le ministre des Affaires environnementales avec un marchand d’armes non gouvernemental précédemment accusé d’avoir écrémé le gouvernement dans son Niger natal. L’accord comprenait des milliers d’armes d’assaut.
Les troubles politiques ont également eu un impact direct sur le pays voisin, la Gambie, qui dépend fortement des importations d’électricité en provenance du Sénégal. Les pannes résultant des manifestations au Sénégal ont provoqué des perturbations économiques et entravé considérablement la vie quotidienne dans le pays voisin depuis 2021. La Gambie a demandé l’aide de la CEDEAO pour arbitrer la situation.
LIRE AUSSI : Sénégal : Ex-Premier ministre détenu après avoir critiqué le président
Au cours des manifestations des quatre derniers jours, les manifestants ont exigé la démission de Macky Sall, l’actuel président du Sénégal. S’il décide de se présenter aux élections de 2024, sa candidature serait contraire à la constitution selon l’opposition, ce qui est une autre raison des manifestations.
Macky Sall n’a pas encore confirmé s’il sera candidat aux élections de 2024.
#Sénégal #MackySall #OsmaneSonko