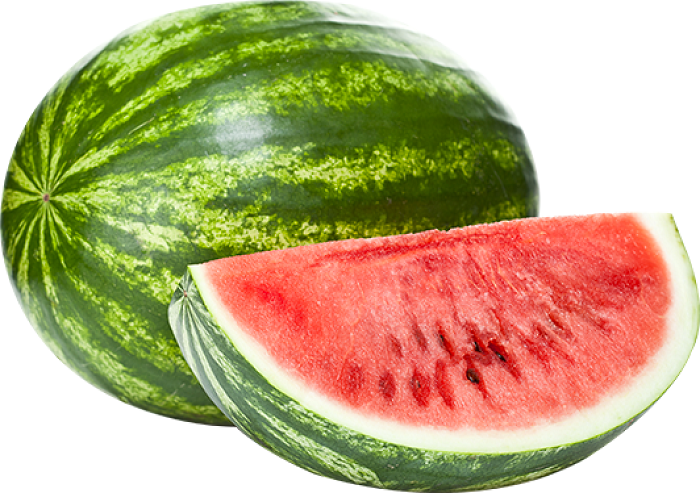Etiquettes : ONU, MINURSO, Sahara Occidental, Maroc, Alexander Ivanko, mariage,
Par Colum Lynch // 09 mai 2023
Au début de l’été 2022, le secrétaire général des Nations unies António Guterres a abordé un sujet délicat avec la mission russe à New York : Le chef de l’opération de paix de l’ONU au Sahara occidental, un ressortissant russe nommé Alexander Ivanko, était impliqué dans une relation romantique avec une femme marocaine locale et prévoyait de l’épouser.
Cette relation était devenue un problème politique. Elle a été citée dans des reportages sur le territoire contesté, où le Maroc est engagé depuis des décennies dans une campagne militaire visant à annexer l’ancienne colonie espagnole. Le Front Polisario, un mouvement d’indépendance armé, s’est officiellement plaint que cette relation renforçait les craintes d’un parti pris pro-marocain de la part des Nations unies. L’ONU tenait à éviter un mariage.
Pour certains membres du personnel de l’ONU, ce qui est le plus troublant dans cet échange, ce ne sont pas les fréquentations de leur patron, bien que de telles relations soient généralement mal vues, mais le fait que le chef de l’ONU ait jugé nécessaire de solliciter l’intervention de la Russie pour résoudre ce qui aurait dû être un problème purement administratif impliquant un fonctionnaire international.
La démarche auprès de Moscou a, selon eux, envoyé un signal clair que M. Ivanko est l’équivalent diplomatique d’un « homme fait », politiquement intouchable sans l’assentiment du gouvernement russe.
Cet échange de haut niveau a renforcé une perception largement inavouée de la vie au sein de l’ensemble du personnel de l’ONU, à savoir que ceux qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire, principalement ceux qui sont soutenus par des gouvernements puissants, sont souvent à l’abri de toute responsabilité en ce qui concerne le non-respect des normes qui régissent le reste de la communauté de l’ONU. Cette réalité, selon les fonctionnaires, a dissuadé le siège de l’ONU de s’attaquer à une série de crises administratives plus graves au sein de la mission au Sahara occidental, notamment des allégations de mauvaise conduite, de conflits d’intérêts, de consommation excessive d’alcool et de fêtes et, dans un cas, l’agression physique présumée d’une fonctionnaire par son supérieur hiérarchique masculin.
« L’ensemble de la mission est au courant et cela rend tout le monde frustré et démotivé », a déclaré un employé de l’ONU au Sahara occidental à Devex dans l’un des nombreux échanges de courriels. « Il n’y a pas de règles et il n’y a pas de justice, et certaines personnes peuvent faire ou dire n’importe quoi, et rien ne se passera. Tout le monde au siège de l’ONU à New York sait ce qui se passe, a déclaré le fonctionnaire, « mais personne ne lèvera le petit doigt » parce que le chef de la mission est un ressortissant russe.
D’autres fonctionnaires de l’ONU soutiennent qu’il est injuste de rejeter toute la responsabilité sur M. Ivanko, le premier ressortissant russe à diriger une opération de paix de l’ONU. Ils affirment que bon nombre des défaillances de la mission – y compris les failles dans la discipline, les guerres de territoire bureaucratiques toxiques et l’application irrégulière des règles – se sont enracinées au fil de décennies d’habitudes et de négligence de la part du siège de l’ONU. Au moins 55% du personnel de la mission est en poste depuis plus de 10 ans, selon un audit interne de l’ONU datant de 2021.
« Les membres de cette mission sont là depuis tant d’années, et tant de mauvais comportements sont devenus endémiques. Il est facile de faire tomber la personne la plus haut placée du perchoir », a déclaré un haut fonctionnaire de l’ONU dans la mission, officiellement connue sous le nom de Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental, ou MINURSO, à propos de M. Ivanko. « On ne peut pas lui imputer tous les mauvais comportements.
Cet article est basé sur des entretiens avec plus de 20 fonctionnaires de l’ONU, anciens et actuels, et s’appuie sur des audits internes, des plaintes formelles, des courriels, des textes et d’autres correspondances internes. La plupart d’entre eux ont parlé à Devex sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer sur des questions internes sensibles et par crainte de représailles professionnelles.
Crise de moral
La situation au Sahara occidental s’inscrit dans le cadre d’une crise de moral plus large au sein du vaste réseau d’agences d’aide, d’opérations de paix et d’institutions financières de l’ONU. Ces dernières années, des enquêtes internes menées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, le Programme alimentaire mondial et le Centre du commerce international ont révélé un profond mécontentement parmi les employés de base face à ce qu’ils ressentent comme une impunité pour les dirigeants qui abusent de leur pouvoir ou refusent des opportunités aux femmes, aux minorités ou aux employés qui n’ont pas de puissants bienfaiteurs.
« Le moral est au plus bas », selon une plainte anonyme d’un employé du Centre du commerce international de l’ONU dans le cadre d’une enquête menée par le syndicat du personnel à Genève. « De nombreux membres du personnel démissionnent car le chaos s’installe dans plusieurs départements de l’organisation.
« Il n’y a pas de règles ni de justice, et certaines personnes peuvent faire ou dire n’importe quoi, et rien ne se passera.
Employé des Nations Unies au Sahara Occidental
Il est difficile de généraliser sur la base d’une poignée d’enquêtes dans une organisation qui comprend des dizaines d’agences employant plus de 40 000 civils, environ 90 000 soldats de la paix et un grand nombre de contractants. Mais nombre de plaintes et de griefs ont un point commun : le sentiment omniprésent que les cadres supérieurs sont rarement tenus de rendre des comptes.
Une enquête annuelle sur les opinions du personnel commandée par le secrétariat du siège de l’ONU a révélé que près d’un quart des 17 184 répondants – quelque 4 023 travailleurs – ont déclaré avoir été victimes de discrimination sur la base de l’origine nationale, du sexe, du contexte culturel, de la couleur et de l’origine ethnique.
« La discrimination apparaît également comme un facteur critique dans les données », selon l’enquête de 2021, obtenue par Devex. « La plupart des membres du personnel qui ont signalé des incidents n’ont pas été satisfaits de l’issue, ce qui peut nuire à la confiance en une bonne gestion des situations futures.
L’enquête s’efforce de donner une tournure positive à ces données troublantes, en notant que « la bonne nouvelle est que la majorité des personnes interrogées n’ont pas subi de discrimination sur leur lieu de travail ». Mais elle reconnaît que « pour ceux qui en ont fait l’expérience, les conséquences négatives sont nombreuses et significatives ».
« Les personnes interrogées qui ont déclaré avoir subi une discrimination fondée sur le sexe sont principalement des femmes », indique l’enquête. « Toutefois, la fréquence la plus élevée de discrimination fondée sur le genre a été signalée par les personnes interrogées qui s’identifient comme des femmes transgenres.
Malgré ces résultats, la grande majorité des employés de l’ONU qui ont répondu au questionnaire voient d’un bon œil la direction prise par l’organisation, et 90 % d’entre eux se disent fiers de leur travail. Mais seulement 54 % d’entre eux se sont déclarés satisfaits de leur carrière au sein de l’organisation.
« Il y a de sérieux problèmes de moral, de transparence, de responsabilité, de diversité, d’égalité des sexes, de harcèlement, d’intimidation, etc. », a déclaré Amy Pope, qui a récemment pris un congé sans solde en tant que haut fonctionnaire de l’Organisation internationale pour les migrations afin de faire campagne pour le poste le plus élevé de l’organisation.
« Nous devons veiller à ce que nos politiques et pratiques d’embauche, de promotion et de recrutement soient ouvertes et transparentes, afin qu’il n’y ait pas de perception selon laquelle si vous êtes l’ami de quelqu’un, vous serez placé dans une position d’influence ou de pouvoir ».
Le système de castes de l’ONU
En vertu de la charte des Nations unies, les employés sont nommés sur la base de leur mérite, dans un souci de diversité géographique, et il leur est expressément interdit de recevoir des instructions de leur gouvernement national.
Mais en réalité, les postes sont attribués aux fonctionnaires des gouvernements les plus puissants de l’organisation. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU – la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis – ont le monopole des postes ministériels les plus élevés, qui concernent les affaires politiques, l’aide humanitaire, le maintien de la paix, le développement économique et la lutte contre le terrorisme.
C’est généralement la Maison Blanche qui décide qui dirigera les agences essentielles de l’ONU telles que le Programme alimentaire mondial et l’UNICEF, tournant en dérision le processus de recrutement de l’ONU, qui consiste à dresser une liste restreinte de candidats et à organiser des entretiens avec ces derniers, dont la plupart n’ont guère d’espoir de l’emporter sur une personne nommée pour des raisons politiques.
D’autres États membres se livrent une concurrence féroce pour que leurs ressortissants soient nommés à d’autres postes de haut niveau. Susana Malcorra, ancienne ministre argentine des affaires étrangères et chef du personnel de l’ONU, a déclaré un jour que les nominations à des postes de haut niveau étaient une « question soulevée par chacun des États membres ».
Il y a plusieurs mois, un haut fonctionnaire de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) a déclaré à une assemblée de fonctionnaires coréens que le bureau avait contourné ses propres règles pour nommer deux Coréens de sexe masculin à des postes critiques qui nécessitaient l’examen de candidatures féminines, selon une vidéo qui a été divulguée à Devex.
Le fonctionnaire, Adnan Aliani, directeur de la Division de la stratégie et de la gestion des programmes de la CESAP, a déclaré que la secrétaire exécutive de l’agence, Armida Salsiah Alisjahbana, avait dû « utiliser une grande partie de son propre capital politique » auprès de M. Guterres pour embaucher un candidat coréen à un poste de directeur.
« Lorsque la Corée a proposé cette nomination, il semblait presque impossible de la faire passer car nous avons cette règle de la parité hommes-femmes », a déclaré Mme Aliani.
De même, l’agence a dû « faire des pieds et des mains et utiliser son capital politique » pour obtenir la nomination d’un autre homme coréen à un poste professionnel de haut niveau, passant ainsi outre à la politique de parité des sexes de l’ONU, a déclaré M. Aliani. « Toutes les demandes formulées par le gouvernement coréen ont été satisfaites », a-t-il déclaré.
Dans une réponse écrite à Devex, M. Aliani a confirmé la véracité de l’enregistrement mais a déclaré qu’il s’était mal exprimé. « Je regrette l’impact que mes déclarations ont eu sur toutes les personnes concernées », a-t-il écrit, soulignant qu’il n’avait pas été impliqué dans le processus d’embauche.
Il a ajouté que l’équipe de direction de son agence « prend des mesures pour s’assurer que les faits exacts du processus de recrutement sont partagés ».
Il n’y a rien de nouveau à ce que d’anciens ambassadeurs des Nations unies et d’autres fonctionnaires soient nommés à des postes de haut niveau au sein de l’ONU.
Le personnel administratif du secrétariat de l’ONU – secrétaires et employés de bureau – n’a pas le droit d’être promu à des postes professionnels plus élevés, ce qui le prive d’une possibilité d’avancement essentielle. Les limites imposées à la rotation et à la mobilité du personnel ont condamné de nombreux employés de l’ONU à rester au même lieu d’affectation pendant des années, voire des décennies. Les efforts constants pour réformer les politiques de ressources humaines se sont heurtés à l’opposition des États membres.
Mais sous la présidence de M. Guterres, les personnes nommées pour des raisons politiques ont eu une longueur d’avance, même à des postes de niveau inférieur, selon plusieurs fonctionnaires de l’ONU. Par exemple, il a intensifié la pratique consistant à embaucher des fonctionnaires étrangers, prêtés par leurs capitales, pour gérer les affaires de son bureau exécutif, ont déclaré ces fonctionnaires à Devex.
Dans le même temps, il a marginalisé certains professionnels, écartant même le Département des affaires politiques et du maintien de la paix de l’ONU (DPPA) de missions politiques telles que les négociations pour l’initiative sur les céréales de la mer Noire, selon ces fonctionnaires.
« Il pense qu’il n’a pas besoin du DPPA puisqu’il sait tout », a déclaré un fonctionnaire de l’ONU.
Le principal porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, n’a pas répondu directement à la suggestion selon laquelle M. Guterres a mis sur la touche son bureau des affaires politiques, mais il a déclaré dans un courriel : « Le secrétaire général est très concentré sur la résolution des problèmes urgents du monde et continuera à le faire en utilisant tous les outils à sa disposition tout en respectant la charte [de l’ONU]. Il continue à s’efforcer de sélectionner une équipe diversifiée de professionnels pour remplir le mandat de l’ONU dans le plein respect de ses valeurs. »
Des Izvestia à Laayoune
Ancien journaliste du quotidien russe Izvestia, en poste en Afghanistan et aux États-Unis, Alexander Ivanko n’est pas un apparatchik russe.
Il a passé la majeure partie de sa vie professionnelle au service des Nations unies, en tant que porte-parole en Bosnie pendant la guerre des années 1990 et en tant que chef du département de la communication des Nations unies au Kosovo. Il a acquis une réputation d’acteur indépendant, exaspérant Moscou par ses critiques incessantes de la Serbie et des Serbes de Bosnie.
Selon ses collègues, la guerre en Ukraine a pesé lourdement sur M. Ivanko, qui a des parents ukrainiens et russes.
Dans un message posté sur Facebook quelques jours après l’invasion russe, M. Ivanko a écrit : « J’ai été très, très triste ces trois derniers jours. Deuxièmement, je ne pensais pas que je dirais cela un jour, mais Dieu merci, mon père Sergei Ivanko, Ukrainien et ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, n’a pas vécu pour voir cela ».
Pourtant, la Russie, qui s’est traditionnellement rangée du côté de l’Algérie, partisane du Polisario, le mouvement indépendantiste anti-marocain, a soutenu M. Ivanko, qui a été chef du personnel de l’ONU au Sahara occidental pendant plus de dix ans, pour le poste le plus élevé de la région.
Il a également défendu son comportement lors des discussions avec Guterres, notant que l’ONU était au courant de sa relation avec une femme marocaine avant de le nommer au poste principal, selon deux sources de l’ONU, soulignant que d’autres hauts fonctionnaires de l’ONU sont tombés amoureux sur le terrain sans conséquence.
Les deux sources ont affirmé que M. Guterres avait expressément demandé aux Russes de décourager M. Ivanko d’épouser sa fiancée.
Dujarric a démenti cette version, mais a confirmé que le Sahara occidental avait été discuté avec Moscou. « Je peux vous dire qu’en effet le Secrétaire général a parlé avec des diplomates russes sur plusieurs questions liées à la MINURSO », a déclaré Dujarric. « A aucun moment le Secrétaire général n’a demandé aux Russes d’intervenir dans la vie privée de M. Ivanko.
« Il y a de sérieux problèmes de moral, de transparence, de responsabilité, de diversité, d’égalité des sexes, de harcèlement, d’intimidation, etc. – Amy Pope, candidate américaine à la direction de l’Organisation internationale pour les migrations
Cet épisode est survenu à un moment délicat dans les relations de M. Guterres avec la Russie. Il s’est engagé dans un effort diplomatique de grande envergure pour maintenir le soutien de la Russie à un accord historique sur les céréales de la mer Noire, qui permet à l’Ukraine d’exporter des millions de tonnes de céréales et d’alléger la pression sur les prix mondiaux des denrées alimentaires.
Mais il s’est montré réticent à affronter la Russie sur des questions sans rapport avec le sujet, repoussant la demande des États-Unis et de l’Europe d’enquêter sur les ventes de drones iraniens à Moscou, selon un diplomate occidental de haut rang. En outre, sa prétendue démarche personnelle pour résoudre l’affaire Ivanko a fait comprendre à son personnel que la Russie devait être traitée avec une attention particulière.
Finalement, un compromis semble avoir été trouvé. M. Ivanko, qui a commencé à fréquenter sa fiancée lorsqu’elle travaillait dans son bureau, a reporté ses projets de mariage jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite de l’ONU, et les hauts fonctionnaires de l’ONU ont accepté de garder pour eux leurs préoccupations concernant la vie privée de M. Ivanko, selon une source de l’ONU informée de l’affaire.
M. Ivanko a refusé de commenter ses projets. « Ecoutez, ma vie privée est personnelle et même si je sais que parfois les gens aiment faire des ragots à ce sujet, je ne suis pas l’un d’entre eux », a-t-il déclaré à Devex dans un courriel.
M. Dujarric a également refusé de commenter l’affaire : « En règle générale, les Nations Unies ne divulguent pas au public les informations personnelles confidentielles des membres du personnel », a-t-il déclaré à Devex par courriel. Un porte-parole de la mission russe auprès de l’ONU n’a pas répondu à une demande de commentaire. Un haut fonctionnaire de l’ONU a fait remarquer que la fiancée d’Ivanko avait quitté son emploi à l’ONU pour éviter toute suggestion d’irrégularité dès que les deux hommes ont commencé à se fréquenter.
La maison des fêtes
La mission de l’ONU au Sahara occidental a été créée en 1991 pour surveiller le cessez-le-feu entre les forces marocaines et les combattants indépendantistes du Polisario et ouvrir la voie à un référendum sur l’autodétermination. Mais le vote n’a jamais eu lieu, et il n’y a guère d’espoir qu’il aboutisse à plus qu’une autonomie limitée sous l’autorité marocaine.
Avant de quitter ses fonctions, l’administration Trump a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur la région, réduisant ainsi les perspectives d’un Sahara occidental indépendant. La mission de l’ONU, qui compte plus de 460 personnes, dont plus de 240 policiers et soldats, surveille une impasse politique qui n’a pas de date butoir.
La mission a également fait l’objet d’un examen minutieux en raison de sa culture de la fête dans une région musulmane très conservatrice.
Tous les jeudis, l’ONU organise un happy hour dans son enceinte, l’un des rares endroits où l’on sert de l’alcool. Le chef des ressources humaines, Thomas Wilson III, fait également office de DJ informel de la mission, organisant régulièrement des fêtes dans sa maison, l’une des plus grandes de la région, avec des néons violets clignotants sur une piste de danse, des bars et des guitares électriques suspendues au plafond. Trois fonctionnaires de l’ONU affirment que les autorités locales ont enregistré de nombreuses plaintes.
« Sa maison est connue comme la maison de la fête », a déclaré un responsable de la mission récemment retraité, qui a requis l’anonymat par crainte de se voir refuser de futurs contrats de l’ONU pour s’être exprimé publiquement.
« Cela se présente très mal, c’est un territoire musulman », a déclaré une employée musulmane, qui a refusé de s’exprimer par crainte de représailles.
« Pour les autres musulmans, et en particulier pour les femmes musulmanes comme moi, c’est très difficile à voir et c’est très embarrassant », a ajouté la fonctionnaire.
D’autres fonctionnaires de l’ONU ont défendu les fêtes, notant que le Sahara occidental n’a pratiquement pas d’installations récréatives pour se défouler, ni d’accès public aux boissons alcoolisées.
« Nous sommes dans le désert », a déclaré un fonctionnaire.
« La MINURSO peut être un lieu de travail isolant pour le personnel international. Il n’y a pas grand-chose à faire, et parfois le moral en prend un coup », a écrit M. Ivanko dans ses remarques envoyées par courriel. « C’est pourquoi nous faisons un effort supplémentaire pour essayer de créer un sentiment d’appartenance à la communauté par le biais d’événements de bien-être du personnel tels que des voyages sponsorisés, des foires alimentaires, des célébrations de la fête nationale, la mise à disposition d’un espace commun pour regarder les grands événements sportifs, des réunions sociales, etc.
Alex Ivanko a également acquis la réputation d’un buveur invétéré, qui fait la fête jusque tard dans la nuit et se présente rarement au bureau avant midi.
« Alex est un Russe typique », a déclaré le responsable de la gestion de la mission à la retraite, qui se souvient avoir partagé des verres avec Ivanko. Mais le fonctionnaire a insisté sur le fait que « l’alcool n’a jamais entravé sa capacité à faire son travail » et que M. Ivanko avait modéré ses habitudes de consommation depuis qu’il avait accédé au poste le plus élevé.
Il s’est toutefois dit surpris de la promotion d’Ivanko, qui a gravi deux échelons de salaire, ce qui aurait été impensable sans le soutien de Moscou.
« La relation avec la Marocaine n’a pas aidé », a-t-il ajouté. « Elle n’a certainement pas contribué à la situation politique de la mission, car il est évident que le Polisario, ou le Front Polisario, comme on l’appelle, ne veut pas lui parler.
« Le fait qu’Alex soit russe n’est pas un problème », a déclaré un fonctionnaire de l’ONU à la MINURSO. « Il est accessible, il a une véritable politique de la porte ouverte. C’est une personne décente qui essaie d’aider chaque fois qu’elle le peut et qui que ce soit.
« Alex est imparfait, comme nous le sommes tous, mais je peux vous dire une chose : chaque jour qu’il passe sur ce dossier, il essaie de réparer ce qui est cassé et chaque jour, il essaie de faire une putain de différence », a ajouté un haut fonctionnaire de l’ONU actuellement en poste à la MINURSO.
Ivanko, quant à lui, a refusé de commenter sa consommation d’alcool.
Impunité
Selon certains critiques actuels et anciens de l’ONU, M. Ivanko n’a pas été en mesure de résoudre les conflits internes de la mission ou de demander des comptes à ses principaux lieutenants pour les lacunes en matière de gestion et les fautes professionnelles présumées. Le siège de l’ONU, quant à lui, n’a pas réussi à stabiliser une mission en proie à des troubles internes, rejetant de fait de nombreuses plaintes du personnel, selon plusieurs fonctionnaires actuels et anciens de l’ONU.
Wilson, le chef des ressources humaines de la mission au Sahara occidental, a été au centre du drame bureaucratique, la cible de critiques dans un audit de 2021 par le bureau de contrôle interne de l’ONU qui a constaté qu’il a recruté du personnel à des postes sans consulter les gestionnaires de recrutement concernés, contrairement aux directives de recrutement de l’ONU.
Le recrutement du personnel de l’ONU a toujours été une affaire longue et fastidieuse, nécessitant l’approbation des États membres de l’ONU, un processus qui pouvait retarder une nomination de plus d’un an. Dans un souci d’efficacité, les membres de l’ONU ont décidé en 2019 d’accorder au chef de la mission le pouvoir de « reclasser » les emplois, c’est-à-dire de prélever de l’argent sur un poste vacant dans un département pour financer un autre poste plus important ailleurs dans la mission. Selon plusieurs fonctionnaires actuels et anciens de l’ONU, cet arrangement a donné du pouvoir à M. Wilson, qui a pris l’initiative de reclasser les postes de la mission, mettant ainsi à l’écart les chefs de département.
M. Wilson fait l’objet de plaintes officielles selon lesquelles il aurait abusé de son pouvoir en plaçant des favoris à des postes clés. M. Wilson a rétorqué qu’il était la cible de représailles de la part de collègues qui ont cherché à influencer le processus de recrutement de manière inappropriée.
Au cours de l’été 2020, M. Wilson s’est heurté à sa supérieure directe, Stanislava Daskalova, après qu’elle a critiqué sa gestion d’un cas de placement comme étant « inappropriée », selon un courriel de leur échange, qui a été examiné par Devex.
M. Wilson a répliqué en laissant entendre que le traitement qu’elle lui avait réservé était motivé par sa race.
« Je peux accepter n’importe quoi, mais je n’accepterai jamais de mon vivant, aussi longtemps que je travaillerai pour l’ONU, le DISRESPECT constant, les INSULTES de Stanislava, avec une tentative délibérée de sa part de projeter sa supériorité sur les personnes de couleur », a écrit M. Wilson à Mme Daskalova et à son patron, Veneranda Mukandoli-Jefferson, dans un courriel daté du 8 juillet 2020 et consulté par Devex.
Cet échange, écrit Daskalova dans l’un des courriels, n’était pas la première fois qu’elle se heurtait à Wilson, rappelant qu’elle avait « souligné les faiblesses de son travail et de celui des RH à de nombreuses reprises ».
Wilson a fait d’elle une « cible de son intimidation constante et de ses tactiques de peur – il a longtemps utilisé la menace d’une plainte contre moi comme un moyen de me dissuader d’exercer mes fonctions », a-t-elle écrit dans un courriel du 9 juillet. Avant de venir au Sahara Occidental, elle a ajouté qu’elle n’aurait jamais « cru qu’un superviseur pouvait être abusé par le personnel supervisé ».
Le représentant spécial du secrétaire général de l’époque, Colin Stewart, s’est rangé du côté de Mme Daskalova, déclarant qu’il était d’accord avec elle pour dire que « le fond du problème est que Wilson résiste à tout examen sérieux de son travail ».
Tous les membres du personnel, y compris le représentant spécial lui-même, « doivent conseiller leurs supérieurs hiérarchiques du mieux qu’ils peuvent, mais ils doivent ensuite appliquer pleinement et consciencieusement la décision du supérieur hiérarchique une fois qu’elle a été prise », a déclaré M. Stewart à M. Wilson dans un courriel daté du 9 juillet 2020. « Les décisions managériales ne font pas l’objet d’un consensus.
« Le racisme ou les accusations non étayées de racisme sont deux lignes rouges à ne pas franchir au sein de l’ONU », a averti M. Stewart. « Si vous ou un autre membre du personnel accusez un autre membre du personnel de racisme sans preuve crédible, vous ferez l’objet d’une enquête formelle. »
Mme Daskalova a décliné toute demande de commentaire, renvoyant Devex au service de presse de l’ONU. M. Wilson a également refusé de commenter l’échange. M. Stewart n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires par courriel.
Selon des fonctionnaires actuels et anciens de l’ONU, M. Ivanko a fait preuve d’une plus grande sympathie à l’égard de la conduite de M. Wilson.
En mai dernier, Wilson et le patron de Daskalova, Mukandoli-Jefferson, ont déposé une plainte officielle auprès d’Ivanko, accusant Wilson d’avoir embauché une femme sous-qualifiée pour un poste dans son bureau. Selon Mme Mukandoli-Jefferson, une candidate plus qualifiée avait été indûment retirée de la liste des candidats. Elle a demandé que le processus de recrutement fasse l’objet d’une enquête.
« Mon souci est encore une fois la transparence et l’équité envers chaque candidat », a écrit Mme Mukandoli-Jefferson. « Je n’ai rien contre le candidat. Il y a de la mauvaise foi dès le début en ne mentionnant pas que l’un des candidats figurait sur la liste existante.
M. Wilson a refusé de commenter l’affaire.
Mais un document exposant sa défense affirmait que Mukandoli-Jefferson exerçait des représailles parce qu’il l’avait déjà accusée de mauvaise conduite. Le document, qui contient des informations internes sensibles, a été envoyé anonymement à Devex. Nous n’avons pas été en mesure d’identifier l’expéditeur.
« Toutes les allégations sont frivoles et vengeresses », a déclaré Mme Wilson selon le journal. « Elles ont été formulées par malveillance, en représailles à l’affaire d’abus de pouvoir déposée contre le CMS (Chief of Mission Support).
Mme Mukandoli-Jefferson a nié avoir exercé des représailles. « Je réfute catégoriquement ces allégations. Il n’y a rien. Ce ne sont que des fabrications pour se couvrir », a-t-elle déclaré à Devex.
La plainte de Mme Mukandoli-Jefferson a été transmise à l’unité d’enquête interne de l’ONU à New York, le Bureau de contrôle interne (OIOS), qui a renvoyé l’affaire à la direction de la mission, selon un document interne examiné par Devex.
Le document note que le conflit de longue date entre Wilson et Mukandoli-Jefferson « a un impact préjudiciable sur la mission et encourage la mission à rechercher des mécanismes alternatifs de résolution des conflits ». Il n’a trouvé « aucune preuve de mauvaise conduite justifiant une enquête du BSCI », mais a suggéré que la mission pourrait rouvrir la recherche d’emploi pour le poste.
Ben Swanson, secrétaire général adjoint de l’ONU au BSCI, a déclaré à Devex que son bureau avait constaté une augmentation spectaculaire des plaintes pour mauvaise conduite – de 580 en 2016 à 1 313 en 2021, un chiffre qui, selon lui, approchera les 1 750 en 2023. Depuis le 1er janvier 2020, il a reçu 48 plaintes de la mission au Sahara occidental.
« Une proportion importante des plaintes et des plaintes croisées qui s’ensuivent sont liées à des différends interpersonnels impliquant les mêmes individus », a écrit Swanson dans un courriel adressé à Devex.
« Ce niveau accru de demande signifie que nous devons continuer à nous concentrer sur les enquêtes sur les fautes graves telles que l’exploitation et les abus sexuels, le harcèlement sexuel, les représailles, le racisme, la fraude et la corruption », a-t-il écrit. L’agence de M. Swanson ne dispose pas des ressources nécessaires pour « traiter des questions qui peuvent être traitées de manière plus appropriée par une certaine forme d’intervention de la direction ».
M. Swanson a refusé de parler de personnes ou de cas particuliers, invoquant la nature confidentielle des enquêtes internes de l’ONU. Mais plusieurs sources ont indiqué à Devex que l’unité d’investigation avait lancé une enquête ces dernières années sur une vaste affaire de fraude à l’assurance impliquant du personnel national, ce qui a entraîné le licenciement, fin 2021, de plus de 20 membres du personnel national de la mission.
Un audit interne réalisé en 2021 par le département de Swanson a interrogé 178 membres du personnel au Sahara occidental et a conclu que moins de la moitié d’entre eux – environ 40 % – pensaient que la direction de la mission encourageait un comportement éthique. L’audit – mené entre novembre 2019 et janvier 2020, lorsque Ivanko était chef de cabinet de la mission – a également cité les préoccupations du personnel concernant l’abus d’autorité, le moral bas et la mauvaise communication de la part des gestionnaires.
Certains membres du personnel de l’ONU affirment qu’Ivanko n’a jamais donné suite aux recommandations visant à régler les différends entre les membres du personnel, bien qu’il ait transmis une plainte distincte récente contre Wilson au bureau de contrôle interne à New York. Eddy Khawaja, le chef de la sécurité de la mission de l’ONU au Sahara occidental, a accusé M. Wilson d’avoir abusé de son autorité en forçant l’unité de sécurité à embaucher le candidat qu’il préférait, sapant ainsi l’autorité du département de la sécurité à embaucher du personnel, selon une plainte formelle examinée par Devex.
M. Wilson a de nouveau rejeté cette plainte en la qualifiant d’acte de représailles, citant un différend antérieur entre les deux hommes après que M. Wilson eut retiré 20 jours de congés annuels à M. Khawaja au motif qu’il n’avait pas demandé de congés de maladie de manière appropriée pendant la pandémie, selon l’e-mail de défense de M. Wilson. Le différend a culminé lors d’une réunion très tendue, au cours de laquelle Khawaja a crié et injurié Wilson, selon un document interne de l’ONU.
M. Ivanko a refusé d’aborder les détails des plaintes, mais il a minimisé l’importance de certains conflits internes à la mission.
« La MINURSO est une petite mission et il est parfois vrai que les relations interpersonnelles peuvent être tendues, et ce qui pourrait être un petit grief ou un désaccord mineur est amplifié et devient un problème majeur », a déclaré M. Ivanko. « C’est regrettable, mais c’est la réalité de la vie dans une petite opération dans un petit endroit.
Des fonctionnaires de l’ONU ont déclaré que M. Wilson s’était heurté à d’autres membres du personnel, mais que M. Ivanko avait refusé de prendre des mesures. « Alex refuse de croire que Thomas puisse faire quoi que ce soit de mal », a déclaré un fonctionnaire de la MINURSO. « Cela signifie que Thomas jouit de l’impunité.
Une agression présumée
L’affaire la plus troublante de la mission au Sahara occidental est sans doute l’affirmation d’une femme soldat de la paix selon laquelle l’ONU l’a obligée à revenir sur une allégation d’agression par son supérieur masculin, selon plusieurs fonctionnaires actuels et anciens de l’ONU. La victime présumée, un officier français, a entamé une relation amoureuse consensuelle avec son agresseur présumé, un officier égyptien, en septembre dernier.
Quelques mois plus tard, la relation s’est détériorée car l’Egyptien était de plus en plus jaloux de ses relations avec ses collègues masculins et désapprouvait de plus en plus sa tenue vestimentaire, qu’il considérait comme provocante, selon deux sources de l’ONU, anciennes et actuelles, au courant de l’incident. En janvier, l’Égyptien aurait éclaté de colère et l’aurait saisie à la gorge, selon quatre sources actuelles et anciennes de l’ONU.
Il n’y a pas eu de témoins et Devex n’a pas été en mesure de vérifier cette allégation de manière indépendante. L’officier égyptien a nié avoir abusé d’elle physiquement, selon un ancien fonctionnaire de l’ONU. Mais la femme a rapporté l’incident de manière informelle à au moins deux autres soldats de la paix, et l’affaire a été portée à l’attention du commandant adjoint de la force, Faustina Boakyewaa Anokye, qui lui a dit qu’elle avait deux options : Elle pouvait déposer une plainte officielle ou tenter de parvenir à un accord par voie de médiation. Mme Anokye n’a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique.
Finalement, la femme a décidé de ne pas déposer de plainte formelle, car les deux hommes devaient terminer leur service au Sahara occidental au cours de la première semaine de février, et ils ont trouvé un compromis pour résoudre le problème. Il n’exercerait pas de représailles contre elle ou ses collègues et n’aurait aucun contact avec elle, et elle ne poursuivrait pas l’affaire, selon plusieurs sources actuelles et anciennes de l’ONU.
Mais deux jours avant leur départ du Sahara occidental, l’officier égyptien a insisté sur le fait que ce n’était pas suffisant, et que son gouvernement estimait que l’accord informel ne permettait pas de laver son nom de manière adéquate, selon un courriel envoyé le 17 février par la Française à Ivanko et à d’autres hauts fonctionnaires de l’ONU.
L’Égypte est le sixième pays fournisseur de soldats de la paix pour les missions de l’ONU, avec plus de 2 800 casques bleus déployés à la fin de l’année 2022.
La femme a écrit dans le courriel du 17 février qu’elle avait été contrainte par la suite, sous la pression et le chantage, de retirer officiellement sa plainte et de nier toutes ses allégations d’abus. La dernière plainte a déclenché une enquête formelle de la part du service de contrôle interne des Nations unies. Cette enquête est en cours.
Elle a écrit qu’elle avait reçu un appel le 1er février du chef de l’unité de conduite et de discipline de l’ONU, Olubuckola « Buky » Awoyemi, pour discuter de sa plainte.
Lorsqu’elle est arrivée à son bureau, elle a été confrontée à son agresseur présumé, qui l’a menacée de porter plainte contre elle et de la transmettre au gouvernement français, qui a une politique stricte interdisant les relations sexuelles avec des membres d’autres armées.
« En panique, écrit la femme, j’écrirais tout ce qu’il souhaite pour calmer son pays, qu’il pourrait écrire un brouillon pour moi mais que je le suppliais de ne rien tenter contre moi. »
« Bouki m’a alors conseillé d’écrire ce courrier pour retirer ma plainte afin que chacun de nous puisse retourner en paix dans ses pays respectifs et que nos carrières ne soient pas entachées par cette histoire. »
A la fin de l’entretien, l’officier égyptien « m’a dit que je devrais avoir honte de ce que je fais, qu’il me souhaitait une vie honnête et un retour en France dans les meilleures conditions et en toute sécurité. »
« Je voudrais profiter de cette occasion pour dénoncer la procédure et les actions du bureau ‘Conduite et Discipline’ », écrit-elle. « Je dénonce également un système qui protège les hommes et abuse des femmes alors qu’on nous parle quotidiennement des « droits des femmes ».
L’officier français a refusé de commenter l’affaire et l’Égyptien n’a pas répondu à une demande de commentaire sur son téléphone portable. Un haut fonctionnaire de l’ONU a quant à lui défendu Mme Awoyemi en déclarant : « C’est une excellente avocate, très compétente dans ce qu’elle fait. Elle soutient toujours les femmes ».
#SaharaOccidental #MINURSO #Alexander_Ivanko #Maroc #ONU #Casques_bleus