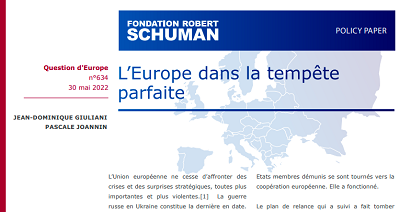Algérie, Europe, Gaz, Russie, Ukraine, Etats-Unis, Chine,
Dans les relations internationales n’existant pas de sentiments, quelles sont les relations commerciales entre l’Algérie et l’Espagne et les perspectives de l’approvisionnement en gaz par l’Algérie de l’Europe ?
L’Algérie, étant reconnu par la communauté internationale comme un acteur clef de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine, dans ses relations s’en tient à la légalité internationale ayant adopté une position de neutralité dans le conflit en Ukraine lors du récent vote à l’ONU, tissant d’excellentes relations avec la Russie, la Chine les USA , la majorité des pays européens et d‘autres pays en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et au Moyen orient , défendant avant tout sa souveraineté qui n’ pas de prix.
Aussi , les supputations récentes de certains responsables espagnols, avis qui ne fait pas l’unanimité en Espagne, que les tensions actuelles seraient dictées par Moscou à l’Algérie, ne tiennent pas la route du fait du renforcement récent des relations économiques avec l’Italie, la France, l’Allemagne et les USA tout en gardant des relations stratégiques avec la Russie. Espérons que le dialogue productif l’emporte sur les passions. Comme l’ont souligné le président de la république et récemment l’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, elle honorera ses engagements internationaux pour l‘approvisionnement en hydrocarbures quel que soit le pays, dans le cadre strict du respect des contrats. La révision des prix est contenu dans les clauses, en principe toutes les deux années, en rappelant que par le passé, ce sont deux pays l’Italie et l’Espagne qui avaient demandé la révision des prix à la baisse, lorsque le cours étaient bas. Aujourd4hui en toute souveraineté, le cours étant la hausse l’Algérie est en droit de demander une révision des prix à la hausse
1.-Quelles sont les relations économiques de l’Algérie avec le reste du monde ?
En dépit des relations politiques mouvementées depuis de longues décennies, l’Europe demeure le premier partenaire de l’Algérie, mais les échanges restent loin d’un optimum possible, comme en témoigne la structure du commerce extérieur du pays. En 2019,, la France était le 1er client de l’Algérie (14 % du total), devant l’Italie (13 %) et l’Espagne (11 %). La Chine était en 2019 le 1er fournisseur de l’Algérie (avec une part de marché de 18 %), suivie par la France (10 %) et l’Italie (8 %). Sur la liste des pays fournisseurs de l’Algérie, la France occupe la première place parmi les pays de l’UE avec 10 %, suivie de l’Italie (7 %), de l’Allemagne (6,5 %) et de l’Espagne (6,2 %) contre 17 % pour la Chine. En matière d’exportations, l’Italie est le premier client de l’Algérie avec un taux de 14,5 % suivie de la France (13,7 %) et l’Espagne (10 %) contre 9 % pour la Turquie et 5 % pour la Chine. Selon les statistiques douanières bilan 2020,sur 34,39 milliards d’importation de biens et 23,80 milliards de dollars d’exportation, les principaux partenaires sont la Chine avec 16,81% suivi de l’Italie, de la France, l’Allemagne et l’Espagne avec respectivement 10,60ù, 7,05% , 6,48% et 6,22%.
Pour les principaux clients nous avons l’Italie avec 14,47% suivi de la France, l’Espagne, la Turquie et la Chine avec respectivement 13,69%, 9,84%, 8,91% et 4,89% Ainsi, les tendances du commerce extérieur , montrent que l’Europe demeure le premier partenaire avec peu d’évolution entre 2021/2022. Selon les données douanières pour 2020 nous avons la ventilation suivante par grandes zones : l’Europe 48,45% d’importation et 56,76% d’exportation avec une baisse de 17,70% par rapport à 2019 du fait de l’épidémie du coronavirus et de la baisse en volume physique des exportations d’hydrocarbures, ; l’Afrique importation 3,27% et exportation 6,58% ; Amérique 15,55% importation et 8,41% d’exportation ; Asie et Océanie 32,73% d’importation et 28,71% d’exportation , pour ce dernier cas la dominance de la Chine avec 35,50% des importations principal fournisseur suivi de la Turquie 18,04% et de l’Inde 6,76%. Pour la zone de libre échange entre l’Algérie et le monde arabe GZALE , les échanges sont dérisoires , environ 1,20 milliard de dollars en 2020 contre 1,33 en 2019 soit une baisse de 9,61%. En 2022, le monde est caractérisé par l’interdépendance des économies Il faut éviter pour analyser les impacts, le mythe d’une analyse statique de la balance commerciale mais raisonner toujours en dynamique. Prenons deux exemples : l’épidémie du coronavirus a fait découvrir aux européens notamment qu’ils dépendaient de certains produits de la Chine du fait de leur désindustrialisation.
Récemment avec es tensions en Ukraine ils ont découvert leur forte dépendance de lla Russie pour l’Energie, dépassant les 40% pour leur approvisionnement et le reste du monde dont l’Afrique de la dépendance alimentaire, la Russie et l’Ukraine représentant environ 30% des exportations mondiales. Certes le PIB russe est extrêmement faible, ayant une économie peu diversifiée mais contrôlant des matières premières stratégiques, un PIB proche de celui de l’Espagne 1775 milliards de dollars en 2021 contre 1483 en 2020. L’Énergie outre la consommation de ménages entrent dans toutes les chaînes de production, la hausse des prix alimentant l’inflation mondiale et idem pour les biens alimentaires. Car la production est production de marchandises par des marchandises. Les pays développés contrôlant à leur tour les segments à forte valeur ajoutée répercutent cette hausse des prix sur les pays producteurs d’hydrocarbures (biens équipements, matières premières et biens de consommation) d’où ce qu’ils gagnent d’un côté, ils le perdent de l’autre côté devant dresser la balance devises pour calculer le solde net.
2.-Relations commerciales Algérie /Espagne en 2021
Selon les données internationales nous avons la situation suivante des principaux indicateurs économiques de l’Algérie et de l’Espagne. Pour l’Espagne le PIB (produit intérieur brut à prix courant ( donc devant tenir compte des fluctuations monétaires euro/dollar étant plus juste de raisonner à prix constants ) de 1426 milliards de dollars en 2021 contre 1280 en 2020. Les exportations de biens ( non compris les services) ont totalisé 307 milliards de dollars en 2020 et les importations 324 contre en 2021 325 milliards de dollars pour les exportations et 354 milliards de dollars pour les importations. Pour l’Algérie le PIB est évalué à 147 milliards de dollars en 2020 et 163 en 2022.
Du fait de l’épidémie du coronavirus qui a affecté surtout les exportations d’hydrocarbures représentant avec les dérivées environ 97/98% des entrées en devises, les exportations ont été de 23,9 milliards de dollars et les importations de biens non compris les services de 33,8 milliards de dollars en 2020. Pour 2021, les exportations avoisinent les 37/38 milliards de dollars dont 34,5 provenant des hydrocarbures, Sonatrach incluant environ 2, 5 milliards de dollars de dérivées comptabilisées dans la rubrique hors hydrocarbures. Pour 2022, comme je l’ai mis en relief dans une interview au quotidien français le Monde.fr Paris, début juin 2021, et récemment le 11 juin 2022 lors du Forum initié par le quotidien gouvernemental Ech Chaab sur les défis de la transition économique, les recettes prévues seraient entre 58/59 milliards de dollars.
Pour le commerce entre l’Espagne et l’Algérie, nous avons les résultats suivants : En 2020, l’Algérie a importé pour 2,1 milliards de dollars d’Espagne contre 2,9 milliards en 2019, soit une baisse de près de 21%. Dans le même temps, les exportations algériennes vers l’Espagne ont chuté de 40%, passant de près de 4 milliards de dollars en 2019 à 2,3 milliards de dollars en 2020, selon les chiffres des Douanes algériennes. Pour 2021, nous avons une valeur d’environ 7 milliards de dollars, les exportations Algérie Espagne sont d’environ 4,9, principalement les hydrocarbures, et les importations d’ Espagne de 2,1 milliards de dollars. Les exportations espagnoles vers l’Algérie comprennent le fer et l’acier, les machines, les produits de papier, le carburant et les plastiques, tandis que les exportations de services comprennent la construction, les affaires bancaires et les assurances.
Les entreprises énergétiques espagnoles Naturgy, Repsol et Cepsa ont des contrats avec la compagnie gazière publique algérienne Sonatrach. Selon les statistiques de l’organisme public espagnol Strategic Reserves of Petroleum Products Corporation (Cores), sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, L’Algérie demeure le premier fournisseur de l’Espagne en gaz, avec 41,4% des importations espagnoles entre le 1er janvier 2021 et fin janvier 2022, Les Etats-Unis, qui tentent une plus grande percée en Europe, notamment à la faveur de la crise avec la Russie, sont le deuxième fournisseur de gaz de l’Espagne, loin derrière l’Algérie, avec une part de 16,9% du total des importations espagnoles la Russie est le quatrième fournisseur, avec 8,7% suivie par le Qatar (6,3%) et le reste du monde 8,8%.
3.-L’Algérie acteur stratégique de l’approvisionnement en énergie de l’Europe
Les réserves algériennes sont d’environ 2500 milliards de mètres cubes gazeux et 10 milliards de barils de pétrole ( source conseil des ministres 2019). Sans compter la part du GNL représentant 33% des exportations, pour les canalisations, part 67%, nous avons le Transmed via l’Italie, la plus grande canalisation d’une capacité de 33,5 milliards de mètres cubes gazeux via la Tunisie, avec en 2021 une exportation d’environ de 22 milliards de mètres cubes gazeux, existant une possibilité, au maximum, il ne faut pas être utopique ayant assisté à un désinvestissement dans le secteur, donc sous réserve de l’accroissement de la production interne d’un supplément à court terme, au maximum de 3⁄4 milliards de mètres cubes gazeux, de 10 à 11 à moyen terme.
Nous avons le Medgaz directement vers l’Espagne à partir de Beni Saf au départ d’une capacité de 8 milliards de mètres cubes gazeux qui après extension depuis février 2022 la capacité ayant été portée à 10 milliards de mètres cubes gazeux et le GME via le Maroc dont l’Algérie a décidé d’abandonner, le contrat s’étant achevé le 31 octobre 2022, d’une capacité de 13,5 de milliards de mètres cubes gazeux. Mais, il faut être réaliste, Sonatrach est confrontée à plusieurs contraintes notamment la forte consommation intérieure, en 2021 presque l’équivalent des exportations , qui risque horizon 2025/2030 de dépasser les exportations actuelles, dossier lié à la politique des subventions sans ciblage, dossier sensible qui demande un système d’information en temps réel et la maîtrise de la sphère informelle qui contrôle, selon les propos du président de la République entre 6000/10.000 milliards de dinars, soit entre 33 et 47% du PIB. Sous réserve de sept conditions, l’Algérie horizon 2025/2027, pourrait pouvant doubler les capacités d’exportations de gaz environ 80 milliards de mètres cubes gazeux avec une part entre 20/25% de l’approvisionnement de l’Europe : La première condition concerne l’amélioration de l’efficacité énergétique et une nouvelle politique des prix renvoyant au dossier de subventions La deuxième condition est relative à l’investissement à l’amont pour de nouvelles découvertes d’hydrocarbures traditionnels, tant en Algérie que dans d’autres contrées du monde, mais pouvant découvrir des gisements non rentables financièrement un des conseils réent des ministres a annoncé 40 milliards de dollars d’investissement sur les 5 prochaines années dont 8 pour 2022; et le partenariat avec l’étranger étant liée aux décrets d’application de la nouvelle loi des hydrocarbures notamment son volet fiscal
La troisième condition, est liée au développement des énergies renouvelables (actuellement dérisoire moins de 1% de la consommation globale) devant combiner le thermique et le photovoltaïque le coût de production mondial a diminué de plus de 50% et il le sera plus à l’avenir où, avec plus de 3000 heures d’ensoleillement par an, l’Algérie a tout ce qu’il faut pour développer l’utilisation de l’énergie solaire La quatrième condition, selon la déclaration de plusieurs ministres de l’Énergie entre 2013/2020, l’Algérie compte construire sa première centrale nucléaire en 2025 à des fins pacifiques, pour faire face à une demande d’électricité galopante. La cinquième condition, est le développement du pétrole/gaz de schiste, selon les études américaines, l’Algérie possédant le troisième réservoir mondial, d’environ 19 500 milliards de mètres cubes gazeux, mais qui nécessite, outre un consensus social interne, de lourds investissements, la maîtrise des nouvelles technologies qui protègent l’environnement et des partenariats avec des firmes de renom. La sixième condition, consiste en la redynamisation du projet GALSI, Gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie, qui devait être mis en service en 2012 d’une capacité de 8 milliards de mètres cubes gazeux La septième condition est l’accélération de la réalisation du gazoduc Nigeria-Europe via l’Algérie d’une capacité de plus de 33 milliards de mètres cubes gazeux, un cout selon les études européennes d’environ 20 milliards de dollars et nécessitant l’accord de l’Europe principal client. Cependant, l’avenir appartenant à l’hydrogène comme énergie du futur 2030/2040.
En résumé, pour l’Europe, l’Algérie est un partenaire clef, et pour l’Algérie, l’Europe est un partenaire stratégique dans le domaine économique et même sécuritaire afin dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant afin de faire du bassin méditerranéen un lac de paix et de prospérité partagé. En n’oubliant jamais que dans les relations internationales n’existent pas de sentiments mais que des intérêts, chaque pays défendant ses intérêts propres. Car face aux nouveaux enjeux, l’épidémie du coronavirus, le réchauffement climatique avec la maîtrise de l’eau principal input de la sécurité alimentaire et la crise ukrainienne préfigurent d’importantes mutations mondiales dans les relations internationales, militaires, sécuritaires, politiques, culturelles et économiques.
Professeur des universités, expert international docteur d’ Etat, 1974, Abderrahmane MEBTOUL ademmebtoul@admin
#Algérie #Europe #Gas #Ukraine #Russie