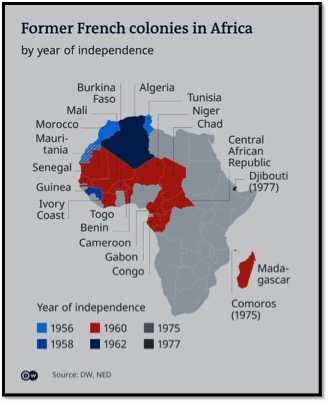Maroc, Algérie, Maghreb, Sahara Occidental, colonialisme, France, Espagne, Protectorat,
« L’Express » reçoit un courrier abondant concernant nos prise de position sur le Maroc; des amis cherchent à en connaître plus, des trolls polluent nos boites à courrier par des insanités, des parties hostiles nous écrivent pour nous couvrir de lazzis et de quolibets; cependant, il y a également des connaisseurs avisés de la région maghrébo-sahélienne qui viennent, avec révérence, demander des éclairages, des arguments sur tel ou tel sujet, et exiger plus de rigueur dans la critique ; et – Dieu nous en est témoin, c’est ce que nous nous appliquons à faire avec nos lecteurs: jamais d’insultes, jamais de propagande de bas étage, mais toujours le cap maintenu sur les faits, la relation d’événements historiques, fiables et vérifiables, les informations sur des liens tenus cachés, les compromissions et les scandales divulgués par les médias internationaux ou soigneusement mis sous le boisseau, les actions politiques, médiatiques ou militaires relevant du domaine public, etc. Le dossier donc s’adresse à cette catégorie, principalement, celle qui cherche avant tout à savoir.
Si l’Algérie fixe aujourd’hui sa longue-vue sur cet encombrant voisin de l’ouest, c’est parce qu’il en a fait trop, et depuis fort longtemps, et pas uniquement à l’Algérie. Les grands titres des médias du monde entier ont à un moment ou un autre publié des articles compromettants sur le Maroc: tentatives de faire pression sur des émissaires onusiens, « achat » de journalistes européens (français et espagnols surtout, mais aussi italiens et britanniques), noyautage des institutions internationales, infiltration, espionnage, écoutes, et on en passe, et des meilleures.
De toute évidence, ce serait lui donner trop de puissance que d’attribuer au Maroc toute cette panoplie de faits spectaculaires et répréhensibles, mais nous parlons surtout de tentatives, car tout le monde n’est pas corruptible, et beaucoup de responsables marocains, connus ou agents de l’ombre, se sont cassés les dents sur la probité, l’honnêteté et la rectitude.
Dans ce dossier, dont certaines bribes ont été publiées en partie par notre journal, nous mettrons le zoom sur un voisin turbulent et imprévisible. Nous prendrons la dynastie saadienne comme commencement de notre histoire, parce que cette dynastie a donné naissance à la dynastie alaouite actuelle, comme elle a été la véritable fondatrice de la politique étrangère marocaine, au détail près, comme nous allons le voir, ce qui signifie que les mécanismes de la politique marocaine obéissent à une certaine doctrine, qu’il serait utile de cerner pour mieux en comprendre les modes opératoires, les prétextes et les compromissions actuelles.
La victimologie rentière a été l’infusion judaïque livrée à boire aux Marocains depuis 1492. A cette date, des milliers de Juifs ont été chassé-en même temps que les musulmans – de la Péninsule ibérique. Prenant appui sur les mythes fondateurs d’Israël, peuple élu de Dieu – ils le furent réellement, avant de mériter le châtiment divin suprême et devenir un peuple honni, banni et misérable pour les sacrilèges commis-, les Juifs ont de tout temps évoqué les oppressions subies pour retrouver une place privilégiée auprès des nations. Fort d’une communauté juive riche et puissante, qui a pris place au sein de la société marocaine et au cœur du système politique marocain, le Makhzen (entendre dans son acception langagière la plus simple) adoptera souvent cette victimologie pour trouver écho auprès des puissances du moment. C’est l’image qui persiste à ce jour avec des structures apparaissant comme intangibles dans ses relations houleuses avec l’Algérie. Tout l’achat d’armement de guerre auprès des Etats Unis et de la Grande-Bretagne a procédé de la sorte: « On est très faible par rapport au voisin algérien, et il faut nous doter d’un armement puissant pour maintenir les fragiles équilibres militaires en Afrique du nord ». Tel a été le supplique de Rabat auprès des capitales occidentales durant les vingt dernières années.
Des agressions d’Ahmed El Mansour au Maghreb central et au Sahel aux investissements de la BMCE en Afrique, des alliances avec les Espagnols contre les Turcs d’Alger à la normalisation avec Israël, toujours contre Alger, des lobbys juifs au cœur de la cour ouatasside au Mossad prenant place au centre de la décision du gouvernement Aziz Akhannouch, peu de choses semblent avoir changées depuis cinq siècles.
Laissons de côté l’Algérie, le Sahara occidental, les animosités du moment et l’actualité, et faisons un retour en arrière. La dynastie saadienne nous est particulièrement intéressante, en ce sens qu’elle présentait déjà toute la logistique marocaine de 2022: vœu d’occidentalisation, expansionnisme, agressions envers le voisinage, sous-traitance de la guerre, mercenariat, alliances contre-nature avec des puissances contre la Régence d’Alger. Pour en saisir les lignes directrices, nous allons louer la machine à remonter le temps; alors tenez-vous bien : le voyage risque d’être « bouleversant ».
Alors qu’Espagnols et Portugais grignotent peu à peu la côte marocaine, notamment le débouché atlantique de la route transsaharienne, Agadir et les ports voisins, les Marocains se tournent vers le sud et l’ouest pour coloniser de nouvelles terres, trouver des sources de financement à la crise chronique et faire diversion pour tromper le peuple en lui proposant de nouveaux débouchés et de nouvelles aventures. La région du Touât, où Tamantit (dans l’actuel Adrar algérien) représentait la capitale et le carrefour des routes caravanières de la poudre de l’or du Melli (Mali), et pont entre le Maroc et le Soudan (actuel Mali), sera la première victime de cette crise commerciale et monétaire marocaine.
Les relations entre l’Algérie et le Maroc ont toujours connu des tensions diplomatiques plus ou moins intenses, quand on pouvait la guerre ouverte et les alliances contraires. C’est le propre de l’histoire des deux pays depuis au moins les cinq derniers siècles.
Si on prend la peine de lire le livre du Dr. Amar Benkherouf, intitulé « les Relations politiques entre l’Algérie et le Maroc au XVIe siècle », on reste effaré tant les similitudes avec ce qui se passe aujourd’hui. Le lecteur de l’Express aurait été plus édifié si cet article avait pu s’appuyer sur un entretien avec l’auteur; hélas, l’auteur était souffrant lorsque nous lui avions proposé l’entretien et ne trouvait pas assez de forces chez lui pour répondre à bon nombre de questions qui auraient éclairé notre dossier d’un jour nouveau.
Makhzen, Palais royal et ses contingences
Quand on parle du Maroc, on entend l’administration du Makhzen le Palais royal et ses contingences politiques, et non pas, évidemment, le petit peuple, qui est resté souvent en retrait, souvent même hostile aux politiques officielles menées contre les pays du voisinage, notamment le Mali et l’Algérie.
Cette parenthèse fermée, revenons-en aux faits. Le Maroc, au XVIe siècle, c’est la dynastie naissante (et envahissante) des sultans saadiens. Ils venaient d’hériter d’une brillante civilisation, celle des Mérinides. Ils côtoyaient et concurrençaient les Zianides, maîtres de Tlemcen et du Maghreb central (actuelle Algérie) et les Hafsides, en Tunisie.
Comme aujourd’hui, les juifs avaient droit de cité dans la politique interne du Maroc. Maîtres de la monnaie, de l’information, de l’économie, de la diplomatie et du commerce international, ils ne laissaient aux souverains saadiens que le soin de passer du bon temps…à la guerre ou au palais.
Assez puissant dans le milieu du XVIe siècle, sous le règne d’Al Mansour es-Saadi, au point de résister aux tentatives à se mettre sous l’autorité de la Porte-Sublime ottomane, le Maroc fit plusieurs incursion au Maghreb central, pour soumettre Tlemcen, faire des razzias à Ouargla et le Touat, passages caravaniers et villes prospères du Sahara, avant d’aller détruire la brillante civilisation fondée au Mali par les touaregs de Tombouctou et dirigés par les souverains Askia. Belliqueux et agressif, le Maroc a été également un destructeur d’empires.
A travers l’étude des chroniques maliennes et marocaines, embrassant l’histoire des souverains saâdiens, le commerce de la poudre d’or et des esclaves, l’imprégnation religieuse, les transferts de populations et la fameuse conquête d’Ahmed El Mansour, il est évident que le fait de retracer cette histoire complexe et mouvementée est d’une utilité décisive.
La conquête du Soudan songhaï par Ahmed El Mansour est l’un des plus hauts faits de l’histoire officielle du Maroc. Pourtant, c’est sans doute à partir de la chute de Gao que les liens entre le Sahel et le Maroc ont commencé à se distendre. L’époque moderne ne pouvait pas plus mal commencer pour l’ouest du continent africain. Depuis 1438, les tribus berbères Masoufa, les Maqchara et les Targa ravagent les décombres de l’empire de Malli. Au Maroc, les tribus arabes font régner la terreur dans les plaines et les déserts, le revenu agricole s’effondre et la confiance de la population envers le pouvoir mérinide s’amenuise d’année en année. Les Portugais grignotent peu à peu la côte marocaine, notamment le débouché atlantique de la route transsaharienne, Agadir et les ports voisins. La région du Touat, pont entre le Maroc et le Soudan, est la première victime de cette crise commerciale et monétaire (puisque l’or se raréfie), qui n’est pas sans conséquence sur l’ordre politique.
Dans ce contexte de crispation, toutes les tensions de la société vont se cristalliser au niveau religieux. Le peuple manifeste épisodiquement et bruyamment contre l’importante communauté juive locale.
Kabbalistes et talmudistes au cœur du pouvoir
Les Juifs étaient les maîtres de l’horloge dans un royaume marocain soumis déjà à la loi de l’argent. Leur savoir-faire leur ouvrait les portes des cours princières et les plaçait déjà au centre de la décision royale. Kabbalistes et talmudistes diffusaient leur poison dans les sociétés maghrébines de l’époque.
Les savants locaux demandent des avis ou fatwa sur la légalité de la présence de « nouvelles » synagogues et de leur extension. Cette crise, amorcée depuis le début du XVe siècle, touche également Fès, où les chorfas et les Andalous persécutent et excluent les descendants de juifs convertis à l’islam (islami), lesquels commercent abondamment avec leurs ex-coreligionnaires du Touat. Ces islami défendent courageusement leurs droits comme tout musulman.
En juillet 2021, peu avant sa mort, l’imam marocain Abou Naïm dénonçait la mainmise des juifs sur le pouvoir réel au Maroc. C’est dire combien les similitudes sont frappantes, à près de cinq siècles d’intervalle.
La révolution anti-mérinide de Fès, menée en 1465 notamment par l’élite chorfa, concorde avec l’éclosion de la dynastie songhaï (le peuple du fleuve) des Chi-Sonni de Gao, à la frontière nigéro-malienne. Cette dynastie naît avec le prince soudanais Sonni Ali, grand guerrier qui a hérité du royaume de Gao et qui va consacrer son règne (1464-1492) à en faire un puissant Etat. En 1468, Sonni Ali occupe Tombouctou et en chasse les Touaregs. A sa mort, c’est l’un de ses généraux, Muhammad Ibn Abou Bakr, qui devient l’Askia (titre royal en songhaï) et prend la tête de l’empire. Comme les Almoravides, il comprend l’intérêt d’asseoir sa légitimité par la religion et se fait accompagner d’un Alfa (religieux), Muhammad Toulé. Il entreprend la conquête de Ouallata, la cité caravanière occupée par les Arabes Banu Hassan, et de Jenné, en amont du fleuve Niger, jusqu’alors cité vassale de Malli. Désormais seul maître des routes de l’or, Askia Muhammad se lance en 1498 dans un grand pèlerinage, à l’instar de celui réalisé par Mansa Mousa de Malli, deux siècles auparavant.
Dernier exemple d’imprégnation, les califes songhaïs instituent le poste de Cheikh Al Islam (recteur général de la religion), titre d’inspiration ottomane. Le plus connu sera un certain Mahmoud Ibn Omar, vers 1550. Son neveu figure en bonne place dans les dictionnaires biographiques recensant les plus grands savants de Fès, pour les décennies précédant immédiatement la conquête saâdienne.
Le sel de la discorde
Cependant, les dynasties saâdienne et songhaï vont rapidement rivaliser sur la question des mines de sel de Taghazza (extrême nord du Mali actuel). Cet établissement dépend du Soudan depuis la défaite des Targa-Maqchara, les proto-Touaregs, en 1468.
Son contrôle est vital pour toute la région sahélienne, pauvre en sel, et permet d’éviter de l’acheter à prix « d’or » aux marchands maghrébins, donc d’enrichir outre mesure les cités du Maroc. Avoir le monopole des mines permet de maintenir le prix de l’or et d’acquérir à meilleur marché les produits manufacturés de la Méditerranée.
Le chérif Ahmed Al Aarej aurait exigé, dès 1526, alors qu’il ne contrôle pas encore le « Royaume de Fès », le retrait des troupes songhaïs des mines de sel. L’Askia répond à cette demande par l’injure et lance une expédition de Touaregs contre les oasis du Draâ, alors que les Saâdiens peinent à résister à la coalition de l’Espagne, des Turcs d’Alger et des Wattasides de Fès. Une des raisons de cette crispation tient peut-être à une hausse des taxes douanières à Tombouctou, dont auraient pâti les marchands maghrébins du Soudan.
Le « Tarikh As Sudan », notre source africaine principale, rédigé vers 1665 par le savant de Tombouctou Abderrahmane As-Saadi, et « Tarikh Al Fettach », de Mahmoud Kaati de Tombouctou, nous apprennent la réaction de Mohammed Ech Cheikh, le successeur saâdien, en 1557. Il utilise le limogeage d’un Filali, Az-Zubayri, du gouvernorat de Taghazza, et profite de sa frustration pour le monter contre ses anciens maîtres. Il le pousse à massacrer les légionnaires touaregs qui gardent la mine pour le compte de Gao. Après une génération de calme relatif, Ahmed El Mansour propose une conciliation : il envoie un cadeau et reçoit en contrepartie un don de musc et d’esclaves qui l’aurait profondément vexé, soit pour avoir été trop important, et donc outrecuidant, soit trop insignifiant, l’histoire ne le dit pas…
Assuré contre les offensives ibériques, après sa victoire de l’Oued El Makhazine (1578), et lié aux Turcs d’Alger par un traité de paix, Ahmed El Mansour envoie ses armées contre Taghazza et coupe l’approvisionnement en sel du Soudan (ex-Mali). Cette offensive est décrite de manière contradictoire par les trois sources de l’époque. Le chroniqueur soudanais Abderrahmane As Saadi rapporte une tentative infructueuse de conquérir le Soudan, qui aurait échoué à mi-chemin, à Ouaddan, dans la Mauritanie actuelle. Chez Al Ifrani, chroniqueur du début du XVIIIe siècle, on trouve simplement le récit de la conquête violente des oasis du Touat et du Gourara, l’étape essentielle entre Maghreb et Soudan, dans l’ouest algérien actuel.
La version d’As Saadi concorde assez avec ce que nous dit l’historien anonyme de la dynastie saâdienne, qui ne porte pas les chérifs dans son cœur. Selon lui, une troupe marocaine fut envoyée au Soudan, dans la foulée des attaques contre le Touat. Elle se serait perdue dans le désert, avant d’être dépouillée par des indigènes touaregs, se rétribuant ainsi de l’avoir sauvée ! C’est en tout cas à cette époque, vers 1582-83, que le grand sultan de Fès et de Marrakech s’intéresse de plus en plus à l’empire rival de la rive sud du Sahara.
L’élément déclencheur est sans aucun doute la grande crise financière qui secoue le monde méditerranéen en cette fin du XVIe siècle. La crise politique au Sahara, doublée de la présence des comptoirs portugais (et de plus en plus hollandais) sur la côte de Guinée, a sans doute limité les arrivages de métal numéraire dans les cités marocaines.
L’Express, 13 juin 2022
#Maroc #Algérie #SaharaOccidental