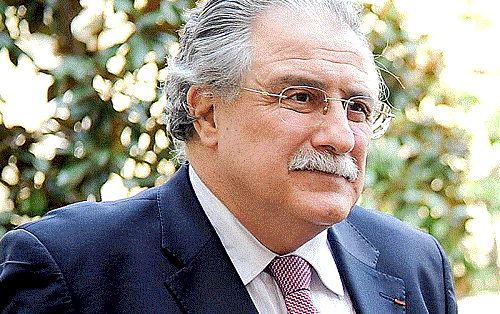Hafiz aux Algériens de France: « Il faut faire du lobbying » – Chems-Eddine Hafiz, Grande Mosquée de Paris, Musulmans de France,
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a détaillé hier 12 décembre 2021, les contours de sa rencontre avec le Président Tebboune. Chems-Eddine Hafiz a également souligné le rôle important que la diaspora algérienne pourrait jouer dans les défis politiques en France.
Invité hier par une chaîne de télévision privée algérienne, le recteur de la Grande Mosquée de Paris s’est montré particulièrement attaché aux aspirations de la diaspora algérienne en France. Outre les enjeux relatifs au domaine religieux, Chems-Eddine Hafiz s’est également pench sur les menaces liées à la politique, et plus précisément à la montée de l’extrême droite, qui planent sur les Algériens de France. Élections en France : un défi pour la diaspora Pour le recteur de la Grande Mosquée de Paris, « au coeur de chaque campagne électorale en France, on y trouve toujours l’Islam et les Algériens, spécialement les Algériens ».
Concernant la campagne pour la présidentielle, qui se déroule actuellement en France, Chems-Eddine Hafiz a évoqué Eric Zemmour, en soulignant que « tous les candidats font comme lui maintenant, ils parlent tous des Algériens. Quand j’ai vu ce qui se disait du côté des Républicains, je me suis dit, mais ils sont devenus fous ! », lâche le recteur de la Mosquée de Paris, avant de fortement dénoncer « la campagne qu’ils menent contre l’Algérie ». « Il y a un problème entre l’Algérie et la France ».
Selon Chems-eddine Hafiz, avocat franco-algérien, à la tête de la Grande Mosquée de Paris depuis le 11 janvier 2020, sur un plan politique, et spécialement dans le cadre des campagnes électorales, « il y a un problème entre l’Algérie et la France », ajoute-t-il. Il explique notamment que « quand les candidats veulent faire monter les sondages, ils commencent à insulter l’Algérie ». Déterminé, le recteur de la Grande Mosquée de Paris affirme avoir fait un appel aux Algériens pour qu’ils jouent un rôle lors des prochaines élections. « Il ne faut pas laisser ainsi la situation. Le jour du vote, il faut aller aux urnes et jouer un rôle dans la politique française », lance Chems-Eddine Hafiz aux Algériens de France. « Vous avez la nationalité française, vous êtes aussi des Algériens, cela va de votre avenir en France ». Faire à Zemmour ce qui a été fait à Sarko.
« Aujourd’hui, il y a un problème », affirme Hafiz, c’est pour cela « qu’il faut aller montrer à ces candidats qu’on a un rôle à jouer ». Pour étayer son point de vue, Chemseddine Hafiz rappelle que Sarkozy, après son échec face à François Hollande en 2012, « est venu à la Mosquée de Paris et a dit c’est vous qui m’avez fait perdre ». Les musulmans, et les Algériens en particulier, « doivent jouer ce rôle démocratique en France », estime le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui assure qu’ »il faut qu’on fasse du lobbying, pas contre la France ou contre son état, non, mais pour qu’on garantisse notre place ».
Cette déclaration rejoint celle qui a été faite par le l’ambassadeur algérien en France, quelques jours après les déclarations controversées du Président Macron. Mohamed Antar Daoud a déclaré que la diaspora algérienne en France doit « constituer un levier de commande » capable d’apporter une différence dans la politique française. « Nous faisons partie de ce pays, on vit dans ce pays, et il faut qu’on y vive de manière naturelle », lance enfin le recteur de la Grande Mosquée de Paris, avant denconclure en déclarant qu’ »on n’a pas besoin que quelqu’un vienne pour nous rappeler qu’on est algériens, musulmans, ou immigrés, ou bien pour nous accuser d’être des terroristes ».
Par : RAHIMA RAHMOUNI
Le Midi Libre, 13/12/2021
#Algérie #France #Grande_Mosquée_de_Paris #Lobbying