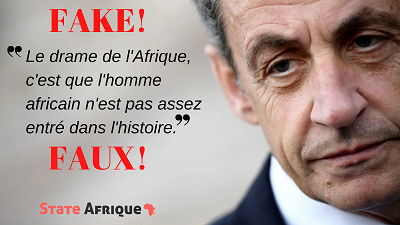Tags : Maroc, Sénégal, Gambie, Ouganda, Afrique du Sud, Cameroun, Madagascar, Tunisie, Ile Maurice, Kenya, tourisme sexuel, pédophilie, pédocriminalité,
Madagascar – Nosy Be, la pudique
L’accueil est chaleureux pour les touristes, le long du chemin qui va de l’aéroport à Ambatoloaka, la station balnéaire de Nosy Be, au nord-ouest de Madagascar. Chaleureux mais dissuasif, au vu des messages qui informent des lourdes peines prévues en cas d’«attentat à la pudeur» contre des mineurs.
Traduisez: le tourisme sexuel est interdit sur la Grande Île et puni d’une amende de 2 à 10 millions d’ariarys (de 715 à 3.500 euros), assortie de 5 à 10 ans de prison.
Mais la nuit tombée, la première destination touristique malgache se transforme en une véritable plaque tournante du commerce du sexe. Loin des plages de sable fin et des eaux luxuriantes de la mer, les pédotouristes, parmi les 400.000 visiteurs que Madagascar accueille chaque année, vont se fondre avec les habitants de Nosy Be. Une population de quelques 109.000 habitants, essentiellement constituée de jeunes et frappée par la pauvreté et le chômage. Acculés par la misère, ces jeunes ont entre 15 et 20 ans et affluent à Nosy Be pour «trouver» une Européenne ou un mari blanc.
La prostitution s’est développée dans cette île située sur la côte mozambicaine depuis les premiers grands licenciements provoqués par les programmes d’ajustement structurel des années 90.
Aujourd’hui, le chômage est massif et 76% de la population vit avec moins d’un dollar par jour, selon des chiffrés rapportés en avril 2011 par le journal Midi Madagascar. Les familles ont du mal à subvenir aux besoins des enfants, qui se retrouvent donc sur les plages à la merci des «prédateurs» occidentaux.
Cameroun – Kribi, la libertine
Dès la tombée de la nuit et loin du tumulte des plages, le cœur de Kribi bat au Carrefour Kinguè. A ce croisement de rues, se sont installés les principaux bars et cabarets ainsi que les plus grands restaurants qui rythment les soirées de cette petite ville de 50.000 habitants, située sur la côte atlantique, à quelques 200 km au sud de Douala, la capitale économique du Cameroun.
Cette petite station balnéaire, avec ses plages de sable fin doré, ses cocotiers, ses bungalows et ses coins sauvages, est un peu pompeusement appelée la «Côte d’Azur du Cameroun».
C’est ici que se déversent chaque année, surtout entre novembre et janvier, plusieurs centaines de milliers de touristes. Et pratiquement tous à la recherche de ce que Kribi offre de plus exotique en plus de son cadre paradisiaque: ses jolies filles et ses jeunes éphèbes.
Cependant, malgré le pipeline entre le Tchad et le Cameroun qui traverse la ville, malgré les travaux d’agrandissement du vieil aéroport, malgré le projet de construction d’un port en eau profonde, le chômage est accablant et le tourisme sexuel a le vent en poupe.
Ici, pour les touristes généralement en provenance de France ou des Etats-Unis, le bonheur ne coûte qu’une petite misère: 10.000 francs CFA (15 euros) pour un échange avec une jeune Kribienne — quand ils ne déboursent pas 60.000 CFA (90 euros) pour faire venir un mineur dans leur chambre, avec la complicité des vigiles des hôtels. Ces chiffres ont été rapportés par le journal camerounais “Le Messager”.
Pour l’heure, les autorités ferment les yeux et préfèrent parler de simple prostitution. Même si elles ont fait adopter en 2007 une charte contre le tourisme sexuel, signée par tous les acteurs de la filière touristique.
Et c’est l’écrivain Amély James Koh-Bela, grande militante pour les droits des femmes et la protection des mineurs, qui décrit bien le problème du tourisme sexuel au Cameroun, dans son ouvrage “Mon combat contre la prostitution”: «Des jeunes filles postées aux abords des grands hôtels et restaurants fréquentés par les Européens, des femmes quinquagénaires qui déferlent à Kribi pour trouver des petits jeunes ou des enfants livrés comme des colis dans la chambre d’étrangers avec la complicité du personnel hôtelier».
Kenya – Mombasa, l’effrontée
La police a l’habitude d’effectuer des descentes le long de la côte à Mombasa, une ville portuaire située à 440 km au sud-est de Nairobi, la capitale du Kenya. A chaque intervention, les personnes interpelées se révèlent être des mineurs. Ici, les travailleuses du sexe sont en majorité des adolescentes. Des jeunes filles qui se lancent dans le commerce de leur corps pour fuir la pauvreté.
Leur cible privilégiée ce sont les touristes, qui viennent principalement des Etats-Unis, de Suisse, de Suède, de Norvège ou d’Allemagne. Sur la plage de Mombasa, ces jeunes filles défilent sous le nez des wazungu (hommes blancs), qui n’ont alors que l’embarras du choix.
Une de ces jeunes filles a récemment déclaré au magazine du Bureau de la Coordination des Affaires humanitaires des Nations unies, Irin News:«Ma mère est veuve et a perdu les deux mains quand elle travaillait dans une aciérie de Mombasa, ce qui me force à faire ce que je fais.» Avant d’ajouter tout de même que la plupart de ses clients préfèrent des relations sexuelles non protégées.
Les autorités, aidées par des ONG, traquent les touristes sexuels, même s’il est encore difficile d’estimer l’ampleur du phénomène. Cependant, une étude conjointe du gouvernement kényan et de l’UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance) faisait savoir que jusqu’à 30% des adolescentes des villes côtières du Kenya se livrent au commerce du sexe. Et le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans l’industrie du voyage et du tourisme, adopté en 2004, semble toujours ne faire peur à personne. Ni aux pédotouristes, ni à leurs victimes.
Tunisie – Hammamet, l’opulente
Tous ceux qui ont eu l’occasion de visiter la ville s’accordent à le dire: avec sa médina, sa marina, sa plage, son parc animalier, et ses centaines d’hôtels, Hammamet est une vraie usine à touristes.
Très fréquentée l’été par une clientèle venant majoritairement d’Europe de l’Est, la station attire forcément par le charme luxuriant de ses plages, son cosmopolitisme et l’exubérance des soirées qu’elle propose, le plus souvent animées par les meilleurs DJ. Située à une soixantaine de kilomètres au sud de Tunis, la capitale, c’est l’une des principales stations balnéaires de la Tunisie.
Hammamet, c’est aussi ces cabarets surchauffés où les étrangers peuvent venir admirer les danseuses du ventre. Mais la ville est surtout une destination réputée pour être un véritable lieu de débauche. Partout, on peut croiser des prostituées qui semblent n’avoir aucun mal à offrir leurs charmes à des touristes. Et sur les plages, de très jeunes gens tiennent compagnie à des vieux messieurs souvent bedonnants ou à des femmes d’un âge assez avancé. On peut les voir aussi dans certains restaurants huppés de la ville, quand ils ne les accompagnent pas tout simplement sur les petites plages privées naturistes que compte Hammamet.
En Afrique du Nord, la station balnéaire est devenue, depuis plusieurs années, une destination de choix pour les touristes sexuels. Le soleil, la douceur du climat et surtout l’assurance de mettre la main sur des proies faciles, les encourage à revenir parfois plusieurs fois par an.
Pourtant, il continue de régner comme une sorte de silence sur la question. Tout le monde est au courant, mais presque personne n’en parle. Ni les autorités, ni les populations locales.
Ouganda – Kampala, la délurée
Un peu comme pour oublier les stigmates de la guerre qui l’a longtemps miné, l’Ouganda a mis en place une politique touristique pour le moins agressive. Kampala, la capitale, est ainsi progressivement devenue une destination populaire. La ville accueille nombre de touristes, des Occidentaux pour la plupart, qui, la nuit tombée, prennent d’assaut les bars, discothèques et hôtels qui pullulent dans la ville.
Beaucoup parmi eux viennent en Ouganda non pas pour les charmes du pays — qui croupit dans une pauvreté endémique (35% des Ougandais vivent en-dessous du seuil de pauvreté) —, mais plutôt pour les charmes des jeunes Ougandaises, le plus souvent à peine sorties de l’adolescence. Des statistiques estiment à plusieurs centaines de milliers le nombre de victimes du tourisme sexuel, dont une part considérable sont des enfants.
A l’exception de l’est du territoire, l’Ouganda est un pays relativement sûr pour les touristes sexuels, qui n’hésitent pas à vanter Kampala comme LA destination incontournable. Ceux-ci ont d’ailleurs ouvert un blog où ils décrivent leurs «souvenirs de voyage» et échangent des informations sur le physique des Ougandaises, les lieux où les trouver, le prix à payer, ainsi que sur la meilleure façon de les appâter.
Les plus aventureux osent même publier quelques photos montrant leurs rapports sexuels avec ces jeunes femmes. Un blog ouvert depuis 2004, sans que les auteurs soient vraiment inquiétés par les autorités.
En 2009, le Parlement ougandais a pourtant adopté une loi criminalisant le tourisme sexuel et la pédophilie.
Sénégal – Saly, l’allumeuse
Bienvenue à Saly, station balnéaire située à environ 90 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Hôtels de luxe, clubs et restos chics, plages de sable fin, bungalows au toit de paille… La station passe pour être le lieu de villégiature le plus séduisant d’Afrique de l’Ouest. Mais Saly est aussi et surtout la capitale du tourisme sexuel au Sénégal.
Le célèbre guide français du Routard, il y a quelques années, décrivait ainsi froidement ce petit village chaud de la commune de Mbour: «Saly est le point de ralliement des Occidentaux vieillissants qui souhaitent goûter aux charmes de jeunes Sénégalais(es), pas toujours majeur(e)s.»
Ici, des jeunes filles à peine sorties de l’adolescence rivalisent d’ingéniosité pour approcher les touristes blancs, tandis que les jeunes hommes exhibent fièrement leur forte musculature sur la plage, histoire de pouvoir offrir leurs services à des dames âgées… ou à des messieurs.
Cela conduit souvent à des situations bien dramatiques. Comme l’histoire de cette Française de 65 ans qui se suicide dans sa chambre d’hôtel en consommant une forte dose d’insecticide, après s’être fait dépouiller de tous ses biens par un jeune garçon. Ou comme celle de ces quatre Français condamnés de 2 à 10 ans de prison pour pédophilie.
Selon le magazine L’Express, qui rapportait la nouvelle il y a quelques temps, l’un d’eux avait attiré une fillette de 10 ans, vendeuse de cacahuètes sur la plage de Saly, avec un billet de 1000 francs CFA (1,50 euro) et lui avait ensuite fait perdre sa virginité.
Le phénomène a pris une telle ampleur qu’une ONG de lutte contre la pédophilie, Avenir de l’enfant, s’est créée en 2002 pour «briser l’omerta et faire se délier les langues».
Gambie – Banjul, la pédophile
Il y a encore une dizaine d’années, cela se murmurait seulement. Aujourd’hui, le phénomène a pris des proportions telles que, sur place, plus personne ne semble s’en offusquer. Banjul, la capitale de la Gambie, pays minuscule coincé entre le Sénégal et la Guinée Bissau, est devenue une destination de choix pour les amateurs de mineurs. Mais, plus spécifiquement encore, pour les amatrices occidentales de très jeunes éphèbes noirs.
C’est le quotidien britannique “The Guardian” qui décrivait le phénomène dans un reportage marqué par des détails et des témoignages pour le moins étonnants. Des femmes, entre 45 et 60 ans, venues tout spécialement des Pays-Bas, de la Belgique, de Suisse, du Royaume-Uni, et parfois de la France, à la recherche de plaisirs interdits… avec de jeunes garçons.
Sous la chaleur torride des plages gambiennes, on peut les voir se faire appliquer de la crème solaire par des adolescents. Là-bas, on les appelle les «Marie-Claire», un surnom qu’elles assument sans aucun état d’âme. D’autant plus que ceux pour qui elles viennent en nombre dans le pays ont l’air consentants.
En effet, plus de 50% de la population gambienne a moins de 18 ans. Soit, à peu près 750.000 personnes. Et, tous ces jeunes sont frappés par un chômage massif et une grande pauvreté des familles. Alors, quand ils ne rôdent pas aux abords des hôtels à touristes, ils se précipitent, la nuit tombée, à Sénégambia, tout juste à l’entrée de Banjul.
Ce quartier chaud, à la périphérie Est de la capitale, est le temple de la drague. Les quinquagénaires blanches viennent y faire leur marché du sexe. Et les jeunes pubères le savent, qui exhibent leur corps et rivalisent de déhanchements pour séduire des femmes souvent plus âgées qu’eux de 30 ans. Eux aussi ont un surnom, ce sont les «bumsters». Ces gigolos, rapporte une étude de l’Unicef, trouvent d’ailleurs très chic d’être vus avec des blanches.
Pourtant, explique le journal suisse L’hebdo, les vraies affaires entre les «Marie-Claire» et les «Bumsters» se déroulent un peu loin, dans des appartements ou des maisons de location, afin de ne pas s’attirer les foudres des gérants d’hôtels, dont un grand nombre commence à s’organiser pour lutter contre le phénomène des «Marie-Claire». Mais cela n’a pas l’air de décourager celles-ci. Non seulement beaucoup d’entre elles bénéficient de la complicité de la police, indique encore L’hebdo, mais en plus, elles savent qu’elles peuvent compter sur des proies malheureusement faciles.
Afrique du Sud – Cape Town, l’homosexuelle
Personne, dans la ville du Cap, ne s’en cache. Ni ceux qui débarquent d’avion avec leur bermuda au ras des cuisses, ni les autorités qui font tout pour faciliter l’entrée aux visiteurs. Ici, le touriste vient, bien sûr, découvrir les charmes de la nature et la beauté du paysage. Mais certains viennent, aussi, goûter aux plaisirs de la chair, masculine de préférence.
La plupart des guides touristiques vous l’indiqueront, Le Cap est une destination privilégiée pour les homosexuels, dans un continent où l’affaire est encore considérablement taboue. Et il faut dire que les ingrédients sont réunis: une nature luxuriante, un climat méditerranéen, une forte population gay locale (et souvent très jeune), et une législation qui n’interdit plus l’homosexualité depuis la nouvelle Constitution de 1996 qui a suivi la fin de l’apartheid.
De fait, aujourd’hui, n’importe quel gay un peu branché vivant en Occident, vous dira que San Francisco, Miami, Sydney, Berlin ou Amsterdam ne font plus tellement rêver. L’exotisme se trouve au en Afrique du Sud. Bilan, sur les 1,5 million de touristes qui affluent chaque année dans la ville, 15% sont homosexuels, fait savoir le Cape Town Tourism.
Ce qui les attire, ce sont les corps musculeux des «locaux», comme les appellent tous ceux qui débarquent. Lesquels locaux donnent d’ailleurs toutes ses couleurs au quartier gai du Cap. Mais en réalité, les gays sont partout dans la ville, et l’inévitable prostitution qui va avec. A tel point que, dans son Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle, la Fondation Scelles (qui lutte depuis 1993 contre la prostitution et le proxénétisme) a placé Le Cap dans sa liste des endroits à surveiller de près.
Mais ce sont les possibilités de faire du naturisme dans la ville, et donc en Afrique, qui font fantasmer les visiteurs. Beaucoup aussi, viennent tenter de voir, mais sans trop s’aventurer dans les profondeurs du continent «si l’homosexualité en Afrique noire est un mythe ou une réalité», comme le fait observer le sociologue Charles Gueboguo, spécialiste de la question homosexuelle en Afrique.
Île Maurice – Grand Baie, la partouzeuse!
Grand Baie, c’est un peu le Saint-Tropez de l’île Maurice. En près de 40 ans, ce qui n’était autre qu’un insignifiant village de pêcheurs est devenu le lieu de villégiature de la bourgeoisie locale. Mais aussi, le temple de la luxure et du libertinage.
Sur les plus de 900.000 touristes qui séjournent dans l’île du sourire chaque année, un nombre considérable se dirige immédiatement vers Grand Baie. À la recherche du soleil, des cocotiers et du sable fin et doré des plages…
Grand Baie, située à l’extrême-nord de Maurice, attire surtout, parce que, comme n’hésitera pas à vous le dire le premier chauffeur de taxi qui vous conduira à votre hôtel, on y trouve tout ce qu’on veut. Des plaisirs les plus simples, comme se la couler douce au soleil, aux extravagances les plus folles.
En 2010, un producteur de films X a même fait sensation, en vendant l’île comme une vraie destination sexuelle. Il a monté un site Internet dans lequel il met en scène des femmes sexagénaires effectuant des partouzes avec de très jeunes Mauriciens. Pour des raisons évidentes, nous ne vous redirigerons pas vers le site en question.
Toujours est-il que, à Maurice, presque tout le monde a toujours nié l’existence d’une quelconque forme de tourisme sexuel. Les autorités juraient même leurs grands dieux qu’elles ne savaient pas ce que cela voulait dire. Jusqu’à ce qu’un rapport du département d’Etat américain cite le pays comme étant un lieu d’exploitation de personnes, dont des enfants.
Après ces révélations, le gouvernement mauricien a fait voter une série de lois pour endiguer le phénomène. Mais cela suppose de rendre plus coercitives les conditions d’entrée à Maurice. Or, le tourisme est, avec la canne à sucre, l’autre mamelle de l’économie nationale.
Maroc – Marrakech, la perverse
Même avant la fameuse sortie de l’ancien ministre français Luc Ferry à la télévision, la ville de Marrakech au Maroc avait la réputation d’être un haut lieu du libertinage. Une ville où tout semble permis; une ville dont l’image est, depuis longtemps, associée au tourisme sexuel et à la pédophilie.
La ville ocre, comme on l’appelle, regorge en effet de tous les exotismes et de tous les plaisirs possibles. Les casinos du complexe hôtelier La Mamounia, les multiples boîtes de nuit branchées de Marrakech, ses riads et ses cabarets où l’on drague à tout-va.
Chaque année, ils sont entre 600.000 et un million de touristes (dont une moitié de Français) à assiéger la ville, qui a opté pour un tourisme de luxe. Conséquence, elle accueille essentiellement une clientèle aisée. Le tourisme représente aujourd’hui 10% du PIB du Maroc.
Les prostitués, hommes et femmes, ont bien vu la manne et ont eux aussi envahi Marrakech. Mais les touristes, en quête de chair plus fraîche, s’offrent les services de «rabatteurs» qui les accostent pour leur «livrer» des mineurs. Il y a quelques années, un reportage de la télévision française évoquait le cas de cette fillette de 8 ans qui avait été «livrée» pour environ 150 euros.
Ce n’est plus un secret pour personne: à Marrakech, les enfants sont les doubles victimes du tourisme sexuel. Celles des fameux «rabatteurs» et celles des pédotouristes. Des associations se sont engagées dans la lutte contre ce fléau et ont forcé les autorités à agir. Même si, comme l’explique Najat Anwar de l’ONG Touche pas à mon enfant, les résultats sont encore peu satisfaisants: «Les procédures contre les étrangers restent très rares. Les autorités craignent de porter préjudice au tourisme en ternissant la réputation du pays».
Le tourisme sexuel, version féminine, en Afrique
Amour… coûte que coûte?
Le phénomène de «chercher mon vieux blanc» est devenu omniprésent dans nos grandes villes, particulièrement chez beaucoup de ces jeunes filles et femmes qui espèrent une vie meilleure à travers le mariage avec un européen.
Les seuls critères de choix étant la couleur de la peau et l´indicateur économique du pays du concerné. Obsédées par leur projet ambitieux, elles transcendent tout sens de la mesure, tout appel à la raison et font fi des préjugés, des illusions et des dangers qui ne manquent pas de joncher un tel parcours.
Les cybercafés avec leurs Webcams V.I.P. se sont vite transformés en un espace où les affinités se trans-nationalisent et où les futurs relations, fiançailles et mariages avec un européen se négocient sur les sites de rencontre.
Dans cette obsession de trouver «son blanc» coûte que coûte, les coups bas, les complots et les détournements du contact de l´autre côté de l´Atlantique sont désormais monnaie courante entre les copines.
Dans un stand-up, la grand-mère représentée par l´humoriste Major ASSE, rentre bredouille de l´aéroport parce que son «vieux blanc» a été détourné, chemin faisant. C´est sans doute une représentation exagérée, cependant une parodie par excellence de l´obsession du rêve d´un mariage avec un européen et la tendance ascendante des âges des candidates.
La version féminine de ce phénomène, mutatis mutandis, qui consiste à attendre sa «vieille blanche» n´a pas aussi tardé à faire école dans les zones touristiques africaines.
A observer ces jeunes hommes alignés, tels les produits d´une foire commerciale, qui espèrent être choisis par les touristes blanches, on ne tarderait pas à penser à cette légendaire chanson du Jazz, «Love For Sale», de Cole PORTER. C´est à dire la dimension lucrative que ces rapports transnationaux ont prise.
Le profil des femmes: outre un petit nombre de jeunes femmes, ce sont généralement les femmes européennes âgées de 50 à 75 ans, baptisées les «sugar mamas». Retraitées, célibataires ou divorcées, elles sont à la recherche d´un environnement social ensoleillé et «exotique» pour s´évader du stress, de la froideur des rapports interindividuels dans les sociétés occidentales et de la «jachère sexuelle».
Rêvant expérimenter les prouesses de virilité propagées dans leurs sociétés sur l´homme noir, elles débarquent sur les plages, dans les hôtels des zones touristiques, en quête de l´aventure exotique chez ces jeunes qui se veulent virils.
Cibles: ce sont ces jeunes des zones touristiques comme Mombassa au Kenya (une destination favorite), âgés de 20 à 35 ans, attractifs, avec un profil sportif, soit au chômage ou faisant de petits jobs dans le domaine du tourisme, l´hôtellerie, les plages, avec la réputation, le profil de «Rastaman» ou de «sand sand boy».
Comme certains de ces beaux Massaïs à la merci du tourisme sexuel, ils sont prêts et pavoisent de procurer de la considération, la tendresse et de l´affection que ces femmes estiment ne plus trouver dans leur société d´origine.
Emportées par la «ruée sexuelle» vers l´Afrique à l´ère de la mondialisation, ces femmes blanches d´un certain âge choisissent comme lieu de vacances une destination touristique africaine, convaincues d´y rencontrer des jeunes hommes frais, sportifs et virils dont l´amour s´achète avec les cadeaux et les billets d´euro.
Toutefois, elles sont plus ou moins conscientes de la fragilité de leurs rapports, car ce qui fait la survie de telles relations s´avère être la dépendance financière des jeunes partenaires et la satisfaction de ces dernières.
Dans un contexte marqué par le chômage, la pauvreté et le rêve européen à tout prix, on est en droit de s´inquiéter de la vulnérabilité d´une jeunesse de plus en plus exposée à de relations de dépendance, les yeux tournés vers le Nord comme la planche de salut, souvent au prix de leur dignité et de leur vie.
#Tourisme_sexuel #Pédophilie #Pédocriminalité #Maroc #Sénégal #Madagascar #Cameroun #Ile_Maurice
#Kenya #Tunisie #Gambie #Ouganda #Afrique_du_sud