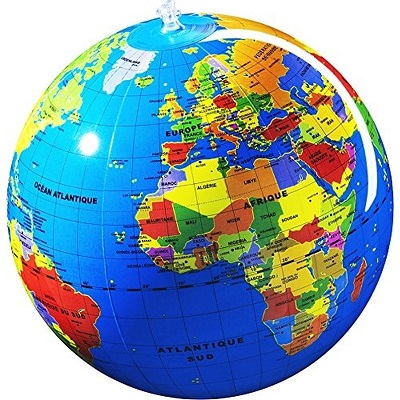Sahara Occidental, Palestine, Maroc, Christiania, Sealand, Wirtland, Kurdistan,
La Convention de Montevideo établit certaines conditions pour considérer un État comme tel : un peuple, un territoire, un gouvernement. Cependant, en dehors des limites de ces États officiels, on trouve d’autres projets, pas toujours prometteurs, qui aspirent à être reconnus par l’ensemble de la communauté internationale.
Par Astrid Portero / El Orden Mundial
Lorsque l’État-nation est apparu sur la scène, il était là pour rester. Avant lui, il y avait d’autres acteurs nationaux – des monarchies féodales, pour la plupart – des organisations administratives très inflexibles et féodales avec peu de portée internationale. Son apparition n’a pas été instantanée ; Il s’agissait plutôt d’un lent processus de transformation des monarchies féodales, leurs prédécesseurs historiques, en ce qui signifiait la rénovation – et, dans certains cas, le déplacement complet – des anciennes institutions qui régulaient la vie quotidienne des citoyens.
L’État-nation que nous connaissons aujourd’hui a subi un processus de maturation qui a duré des siècles, mais nous pouvons trouver son origine vers l’année 1648, avec la paix de Westphalie , qui a mis fin à la guerre de Trente Ans en Allemagne et à la guerre de Quatre-vingts ans. Guerre entre l’Espagne et les Pays-Bas. Avec ce traité, qui visait la paix et la stabilité dans toute l’Europe par la signature d’un accord multilatéral, d’autres concepts très importants ont été introduits qui représenteraient un changement définitif dans la manière de comprendre la politique et les gouvernements.
De manière innovante, l’accord reposait sur des bases juridiques et non religieuses, ce qui a eu un impact énorme : c’était la première fois dans l’histoire moderne que les gouvernements n’étaient pas fondés sur la foi ; au contraire, la liberté religieuse des individus a commencé à être prêchée. Tout cela est basé sur un concept appelé État , quelle que soit sa taille ou l’étendue de son pouvoir, puisqu’il est défini en ayant des limites internationales avec l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale. C’était également crucial pour le changement de paradigme international : en éliminant le facteur religieux des gouvernements et en introduisant la souveraineté nationale – c’est-à-dire le pouvoir politique venant du peuple -, le pouvoir n’était plus hérité ou avait une origine divine.
Nous entrions ainsi dans une ère de laïcité de l’État, avec une nouvelle importance de l’équilibre entre l’individu et la communauté et la sauvegarde de la liberté et de la sécurité individuelles à travers différents mécanismes administratifs. Avec l’intégrité territoriale, des frontières plus ou moins stables ont également émergé, certaines naturelles — des délimitations physiques telles que des rivières ou des montagnes — et d’autres créées artificiellement par des accords avec le ou les pays voisins pour tenter d’atteindre l’harmonie territoriale. Avec ce mélange d’éléments apparaît ce que nous connaissons aujourd’hui comme pratiquement la seule forme d’organisation et de gouvernement de la communauté internationale.
Qu’est-ce qu’un État ?
Bien que l’origine de l’État-nation remonte à 1648, la vérité est que sa définition n’a été officiellement consignée par écrit qu’en 1933, dans la Convention sur les droits et devoirs des États qui s’est tenue à Montevideo, un accord international promu par le président des États-Unis d’alors Franklin D. Roosevelt dans une tentative d’étendre sa politique de bon voisinage, totalement opposé à l’interventionnisme et à l’impérialisme que les États-Unis pratiquaient et qui commençaient à provoquer le rejet autour de lui.
Dans le premier point du traité on retrouve l’essentiel : ce qui est défini comme Etat. L’État en tant que personne ou acteur de droit international doit avoir une population permanente, un territoire déterminé et délimité, un gouvernement et une capacité effective d’établir des relations avec d’autres États. Quant à la population, elle doit être relativement homogène : le concept d’État-nation est né, entre autres, de la nécessité de régner sur un groupe de personnes ayant des affinités culturelles, physiques ou ethniques.
Le traité répondait aux besoins de l’époque et il conviendrait aujourd’hui de l’actualiser pour y inclure ce qui est devenu le point le plus important de l’émergence d’un État : la reconnaissance internationale, différente de cette capacité à établir des relations efficaces avec d’autres États. La reconnaissance par la communauté internationale de l’entité territoriale en tant qu’acteur étatique est devenue une chose à laquelle beaucoup aspirent, car le respect des trois exigences de la convention ne fait pas automatiquement de toute entité un État ; De plus en plus, le consensus de la communauté internationale sur le statut d’une entité donnée est nécessaire pour un avenir prospère.
Le fait qu’il existe une sorte de feuille de route qui précise ce qu’est un Etat a un double sens : tout ce qui ne répond pas à ces exigences ne l’est pas. Cependant, aujourd’hui, cette réalité est devenue plus complexe et a généré une série de particularités étatiques et de projets gouvernementaux qui envoient un message très clair : lorsque la perception est devenue une partie si importante de la réalité, beaucoup ne le font pas. Il importe tellement que d’autres voisins rejettent leur projets de pays.
Micronations : un message territorial
Même si cela peut sembler incroyable, les lieux considérés – par eux-mêmes ou par des tiers – comme des micronations sont très nombreux et représentent un défi constant aux normes établies et aux exigences exigées pour devenir un État à part entière reconnu par la communauté internationale – même si cela les prendre, à de nombreuses reprises, comme une blague ou un passe-temps—. En réalité, ce sont rarement des passe-temps. S’il est vrai que parfois l’implantation d’une micronation est un acte de rébellion, derrière l’émergence de nombre d’entre elles se cache une contestation politique ou une manière d’exprimer le mécontentement d’un ou plusieurs individus envers le pays auquel ils appartiennent pour diverses raisons.
En premier lieu, il faudrait savoir distinguer une micronation d’un petit Etat en termes de territoire —aussi appelé micro-Etat— . micronations _ sont devenus des lieux qui peuvent parfaitement répondre aux exigences de la Convention de Montevideo en termes généraux —territoire délimité, population permanente et un gouvernement ou une administration sur cette population—, mais qui, cependant, n’ont pas la reconnaissance de la communauté internationale, entre autres car elles naissent au sein d’Etats déjà reconnus dans une sorte de sécession. Beaucoup se comportent comme des États à tous égards, avec des documents juridiques pour leurs citoyens, l’émission de leur propre monnaie ou un drapeau qui les représente en tant que pays. Cependant, comme elles sont normalement implantées sur des territoires très réduits — dans certains cas, des bâtiments ou des fortifications — ou de peu d’intérêt étatique, cela ne pose généralement pas de réel problème pour l’État au sein duquel elles naissent ; dans d’autres cas, un accord est trouvé.
Parmi les plus connues figure la ville libre de Christiania , au Danemark, un quartier relativement autonome de Copenhague comptant environ un millier d’habitants qui se proclame indépendant de l’État danois. Le projet Christiania est né en 1971 d’un mouvement culturel et politique qui aspirait à un mode de vie communautaire et collaboratif. En 1989, le gouvernement danois a accepté de préserver la colonie et, depuis 2012, nombre de ses habitants ont acquis des terres à Christiania afin de maintenir leur communauté et leur mode de vie. Actuellement, c’est un lieu touristique dont profite le gouvernement danois, même si la tension entre les deux acteurs s’est accrue en raison de la vente de drogue au sein de la commune.
D’autres exemples de micronations incluent des territoires assez curieux et presque imaginaires. C’est le cas de la Principauté de Sealand , à dix kilomètres de la côte est du Royaume-Uni. Cette micronation repose sur une forteresse marine de l’armée britannique abandonnée après la Seconde Guerre mondiale, une sorte d’île artificielle que Paddy Roy Bates a conquise en 1967 et qui a sa propre Constitution depuis 1975, date à laquelle Bates s’est proclamé prince du nouveau pays apparemment prenant profitant du vide juridique que le lieu se trouvait dans les eaux internationales.
Directement sans territoire réel, nous pouvons trouver Wirtland , un cyber-pays soi-disant souverain qui expérimente la légitimité et l’autosuffisance d’un pays qui transcende apparemment les frontières nationales sans violer ni diminuer celle de toute autre nation. Actuellement, il a sa propre monnaie et son propre sceau et parmi ses citoyens les plus éminents figurent des personnalités telles que Julian Assange ou Edward Snowden, qui ont reçu ce statut en tant que symbole de reconnaissance et de soutien.
Bien que les micronations puissent sembler des idées récentes, il y en a eu plusieurs tout au long de l’histoire. La rébellion de Fredonia a été, par exemple, la première tentative des Texans de se séparer du Mexique en 1826. Les colons anglo, dirigés par l’homme d’affaires Haden Edwards, ont déclaré leur indépendance et créé la République de Fredonia, ce qui a entraîné l’augmentation de la présence militaire mexicaine dans le région et la résiliation du contrat du gouvernement mexicain avec Edwards. Certains historiens considèrent la rébellion de Fredonia comme le début de la révolution texane.
Une micronation est généralement, à plusieurs reprises, un message. C’est le cas de Waveland , Peaceland et Glacier Republic , lieux gérés et proclamés indépendants par l’ONG environnementale Greenpeace comme une forme de protestation environnementale pour diverses raisons : extraction de pétrole, opposition à la construction d’un radar américain ou dénonciation du manque de protection de la pôles, respectivement. La liste des micronations aux objectifs différents est finalement aussi longue que l’imagination le permet.
États à reconnaissance limitée
Si établir des relations avec un autre État n’est pas synonyme d’être reconnu par la communauté internationale, elles jouent parfois le même rôle. Bien que cette reconnaissance n’ait qu’un effet politique ou symbolique, la vérité est qu’en pratique elle a un rôle infiniment plus important dans l’avenir du pays ou de l’État nouvellement émergé. Il est possible que ces territoires aient les conditions pour se constituer en Etat —population, territoire et Gouvernement— et, cependant, finissent par échouer dans leur projet faute de reconnaissance internationale ; cela se traduit souvent par des blocus commerciaux, l’absence de traités, des obstacles à l’importation et à l’exportation, etc.
Au sein de ce groupe, ce qui attire peut-être le plus l’attention est la Chine, où il convient de faire la distinction entre la République de Chine et la République populaire de Chine. La République de Chine gouverne l’île de Taiwan et d’autres îles plus petites depuis 1949, date du transfert du continent après la défaite contre les forces communistes dans la guerre civile chinoise. Après la guerre, le ROC a maintenu la reconnaissance de nombreux pays dans la communauté internationale et sa revendication sur le reste du territoire qu’il avait perdu dans le conflit. Cependant, au fil du temps et des différents intérêts en jeu, la communauté internationale en est venue à reconnaître en grande partie la République populaire de Chine comme un État légitime, puisqu’elle contrôlait la quasi-totalité du territoire. Cette dualité dans la reconnaissance des gouvernements signifie que, même aujourd’hui, la République populaire de Chine a une reconnaissance internationale limitée, dans la mesure où 17 pays membres des Nations Unies continuent de reconnaître la République de Chine comme État officiel. Ces intérêts politiques se reflètent également en Corée du Nord, créée en 1948, autre pays peu reconnu : ni la France, ni la Corée du Sud, ni le Japon, ni la République de Chine ne le reconnaissent.
Les sécessions de pays déjà existants sont, peut-être, l’hypothèse la plus nombreuse de pays à reconnaissance limitée, généralement parce que la majorité de la communauté internationale trouve plus avantageux de ne pas les reconnaître et d’éviter un conflit diplomatique, politique ou commercial avec le pays qui combat la sécession ou parce que la reconnaissance du nouveau pays peut être comprise comme un symbole d’ingérence dans les affaires intérieures d’un autre État. Dans ce groupe, on retrouve le sud du Cameroun ou la République d’Ambazonia, qui lutte pour l’indépendance du Cameroun. Aussi Somaliland, dont les différents clans se sont proclamés indépendants de la Somalie en 1991 et qui a sa propre Constitution, sa propre monnaie et son propre gouvernement —beaucoup plus stables que ceux de la Somalie—, mais pas de reconnaissance internationale. Chypre du Nord, l’Ossétie du Sud —veut être indépendante de la Géorgie— et la République de Cabinda —indépendance de l’Angola— sont dans une situation similaire.
La dissolution historique de grands blocs étatiques, tels que la Yougoslavie et l’ URSS , a également encore des conséquences territoriales. Le cas le plus frappant est celui du Kosovo , dont l’indépendance vis-à-vis de la Serbie a produit une guerre qui s’est terminée par une résolution internationale du Conseil de sécurité des Nations unies prônant une administration internationale du territoire. Cependant, en 2008, le Kosovo a de nouveau déclaré son indépendance , à nouveau rejetée par la Serbie, mais acceptée par plusieurs pays occidentaux.
Un autre exemple serait l’Arménie, un pays indépendant de l’URSS, mais non reconnu par le Pakistan comme une manifestation de soutien à l’Azerbaïdjan dans son conflit sur la région à majorité arménienne du Haut-Karabakh . L’Artsakh ou le Haut-Karabakh, comme l’Abkhazie vis-à-vis de la Géorgie, peinent à être un pays à part entière, mais tous deux ont subi des conflits armés aux mains des pays dont ils veulent se séparer. De plus, l’Artsakh complique davantage le problème des pays à reconnaissance limitée ou non reconnue dans la mesure où il pourrait être considéré comme une sorte d’État ethnique : initialement, il était destiné à être un pays pour les Arméniens.
Ce type d’Etat pour une ethnie ou un groupe culturel précis — comme le fut en fait le Pakistan avec la partition de l’Inde : une nation pour les musulmans de l’Est et de l’Ouest de l’Inde — répond, normalement, aux conséquences de la colonisation et de l’imposition par l’Ouest des frontières qui répondaient plus à des intérêts économiques qu’à des populations homogènes — le Pakistan serait, justement, l’exception —. Parmi ces cas, on trouve le Balouchistan —la terre des Baloutches pakistanais—, le Khalistan —territoire sikh au sein de l’Inde—, le Kurdistan —un pays pour le peuple kurde transnational—, le Sunistan et le Chiistan —pour les sunnites et les chiites, respectivement— ou le Volkstaat — littéralement, ‘People’s State’, un projet indépendant pour les Afrikaners d’Afrique du Sud.
La Palestine est un autre pays qui subit les conséquences du manque de reconnaissance contre un autre pays avec plus de pouvoir – bien qu’aussi avec une reconnaissance limitée – en raison de l’irresponsabilité politique. Le cas se répète au Sahara Occidental : des lieux occupés par d’autres pays avec une présence plus internationale qui agit comme un groupe de pression dans les médias et la communauté internationale afin qu’ils s’immiscent le moins possible dans ce qui est compris comme les affaires intérieures d’un autre État.
Reconnaissance internationale dans un monde globalisé
Aujourd’hui, en route vers un monde de plus en plus interconnecté, certains affirment que les volontés sécessionnistes de nombreux territoires n’ont pas de sens . Dans un contexte où les supra-États ou les organisations supra-étatiques prennent de plus en plus d’importance, à quoi bon vouloir se séparer d’un pays pour rejoindre cette organisation ? D’un point de vue purement pratique, la perte de souveraineté peut être considérée comme la même. À l’époque où nous vivons, les États n’ont guère l’indépendance nécessaire pour prendre leurs propres décisions sans compter sur l’influence du reste de la communauté internationale et de l’économie mondiale. Gouverner isolément du reste du monde n’est plus une option pour la plupart.
Periodismo alternativo, 02/08/2022
#Sahara_Occidental #Maroc #Christiania #Sealand #Wirtland