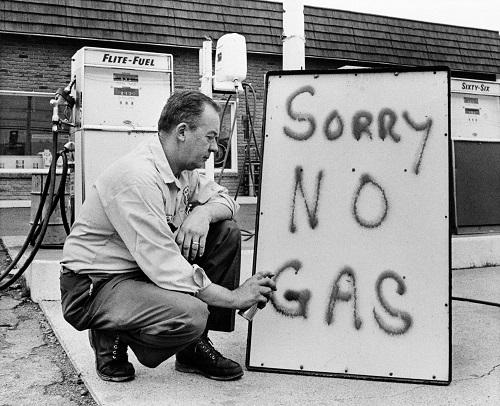Le Mali accuse l’armée française d’”espionnage” et de “subversion” – Sahel, France, terrorisme, Russie, Wagner, Barkhane, Takuba, Algérie,
Le Mali a accusé mardi l’armée française d’”espionnage” et de “subversion” après la diffusion par l’état-major français de vidéos tournées par un drone a proximité d’une base du centre du Mali récemment restituée par la France.
Bamako reproche a la France d’avoir filmé des vidéos montrant des soldats blancs, prétendument du groupe russe Wagner, s’affairant autour de cadavres près de la base de Gossi, et d’avoir ensuite diffusé ces preuves pour se disculper, selon Le Monde.
Les autorités maliennes ont “constaté depuis le début de l’année plus de cinquante cas délibérés de violation de l’espace aérien du pays par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises”, annonce un communiqué du gouvernement de Bamako. “Un des cas les plus récents a été la présence illégale d’un drone des forces françaises, le 20 avril 2022, au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle [avait] été transféré” aux Forces armées maliennes (FAMa) la veille, ajoute le texte, signé du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement mis en place par la junte.
“Ledit drone était présent (…) pour espionner nos vaillantes FAMa. Outre l’espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant [de] fausses images montées de toutes pièces afin d’accuser les soldats des FAMa d’être les auteurs de tueries de civils, dans le but de ternir [leur] image”, accuse enfin le communiqué.
Faire toute la lumière
Au lendemain de la publication de ces images, l’état-major malien a annoncé avoir découvert « un charnier, non loin du camp anciennement occupé par la force française “Barkhane” », du nom de l’opération française antidjihadistes au Sahel. “L’état de putréfaction avancée des corps indique que ce charnier existait bien avant la rétrocession. Par conséquent, la responsabilité de cet acte ne saurait nullement être imputée aux FAMa”, ajoutait l’état-major. Mardi, la justice militaire malienne a annoncé l’ouverture d’une enquête “pour faire toute la lumière” après “la découverte d’un charnier a Gossi”. Selon le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako, “l’opinion sera tenue régulièrement informée de l’évolution de l’enquête, dont les résultats seront rendus publics”.
Mis sous embargo par la Cédéao, le Mali rappelle ses ambassadeurs
Les dirigeants Ouest-africains (Cédéao) réunis a Accra ont décidé dimanche de fermer les frontières avec le Mali et de mettre le pays sous embargo, des mesures qualifiées de “très dures” sanctionnant le non-respect par la junte de l’échéance de février pour des élections ramenant les civils au pouvoir.
Les chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) siégeant a huis clos dans la capitale ghanéenne ont décidé de fermer les frontières avec le Mali au sein de l’espace sous-régional et de suspendre les échanges autres que de produits de première nécessité, affirme un communiqué lu a l’issue du sommet.
Ils ont aussi décidé de couper les aides financières et de geler les avoirs du Mali a la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Ils vont rappeler les ambassadeurs des pays membres au Mali, théâtre de deux coups d’Etat militaires depuis 2020 et en proie a une profonde crise sécuritaire.
Les dirigeants de la Cédéao ont entériné les mesures prises lors d’un sommet de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA) précédant immédiatement le leur, a dit sous le couvert de l’anonymat un participant au sommet, parlant de mesures “très dures”.
Les autorités maliennes ont réagi lundi a l’annonce de sanctions contre le Mali par les Etats Ouest-africains de la Cédéao en rappelant ses ambassadeurs dans ces pays et en fermant ses frontières terrestres et aériennes avec eux, selon un communiqué du gouvernement malien.
“Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes”, indique le communiqué du gouvernement.
“Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales Ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués”, a-t-il ajouté.
Maïga: “A cause de la France, le terrorisme s’étend a 80% du territoire malien”
Le premier ministre malien Choguel Maïga a reproché, dans un entretien accordé au Monde, a la France le fait que le terrorisme qui était confiné a Kidal s’est étendu a 80 % du territoire du pays, laissant entendre qu’un complot international serait concocté contre le Mali, souhaitant également une implication forte de l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme le long de la zone frontalière entre les deux pays où l’insécurité sévit selon lui.
Ces dernières semaines ont été tendues entre vous et le président Emmanuel Macron. Souhaitez-vous le divorce?
Il peut y avoir des scènes de ménage mais je ne crois pas beaucoup au divorce. Malgré tout ce qui se dit, je ne crois pas qu’une rupture des liens militaires avec la France soit pour demain. Sur le plan politique, économique et sécuritaire, trop de choses lient le Mali et la France pour qu’une équipe [celle d’Emmanuel Macron] en précampagne [électorale], sur un coup de tête ou une saute d’humeur, vienne tout remettre en cause. Nous avons décidé de n’insulter ni le passé ni le présent, encore moins l’avenir. Il nous reste encore beaucoup de choses a faire ensemble.
Dans un entretien accordé a l’agence russe RIA Novosti le 8 octobre, vous avez accusé la France d’avoir entraîné des groupes armés dans le nord du Mali après le déclenchement de l’opération «Serval» en 2013. Suggérez-vous qu’elle fait preuve de duplicité au Mali en matière de lutte antiterroriste?
Quand le gouvernement malien a demandé une intervention française en 2013, l’objectif était de détruire le terrorisme et d’aider l’Etat malien a se réinstaller sur l’intégralité de son territoire. Mais une fois arrivée a Kidal (bastion des rébellions touareg), l’armée française a empêché notre Etat de reprendre la ville. Je n’accuse pas, je donne des faits. A chacun d’en tirer ses conclusions. Les faits sont que le Mali a demandé a la France de l’aider a détruire le terrorisme et a recouvrir l’intégralité de son territoire. Près de neuf ans après, que constatons-nous? Le terrorisme qui était confiné a Kidal s’est étendu a 80 % de notre territoire. Cela conduit les Maliens a penser qu’il y a un complot international contre notre pays.
Souhaitez-vous que les forces françaises quittent votre pays?
Nous n’avons jamais dit cela. Nous n’avons jamais rompu l’accord bilatéral de défense qui nous lie a la France. Au contraire, c’est la France qui veut le remettre en cause. En juin dernier, on s’est réveillé un matin en entendant dans les médias que la France suspendait ses opérations militaires avec l’armée malienne, sans nous prévenir ni nous donner d’explication, tout ça parce qu’un nouveau gouvernement qui ne leur convenait pas avait été mis en place (suite au second coup d’Etat du 24 mai). Un mois plus tard, au sommet du G5 Sahel, Emmanuel Macron est venu nous annoncer que «Barkhane» allait se retirer.
La France assure pourtant que cela a été discuté avec tous les chefs d’Etat du G5 Sahel, dès février, en marge du sommet de N’Djamena…
Il n’y a pas eu de discussion. Emmanuel Macron l’a annoncé, tout de go. Le président de la transition (le colonel Assimi Goïta) l’avait pourtant dit a Emmanuel Macron: « Ce que vous voulez faire, c’est un abandon, en termes militaires. Asseyons-nous et dites-nous quand vous voulez partir, pour qu’on se prépare a prendre progressivement les emprises que vous allez laisser. Lorsqu’on sera prêts, vous pourrez partir. » Au lieu de ça, nous avons été abandonnés. Depuis, notre gouvernement a bien compris que s’il ne compte que sur un seul partenaire, il pourra a tout moment être abandonné. Nous en cherchons d’autres.
Y a-t-il eu des discussions menées avec la milice privée russe Wagner?
Ce sont les médias français qui en parlent. Moi, je ne connais pas de Wagner. Ce sont des rumeurs, a ce stade-la. Le jour où nous conclurons des accords avec quelque pays que ce soit, nous les rendrons publics. En attendant, qu’on ne nous fasse pas de procès d’intention!
Votre gouvernement entretient le flou autour de la question. Ne craignez-vous pas de vous aliéner les autres partenaires internationaux et d’aller a l’isolement?
Ce sont des menaces qui, aujourd’hui, sont sans objet, parce que nous n’avons pas signé d’accord avec qui que ce soit. Il n’y a pas de flou! Ce que nous avons, c’est un accord avec l’Etat russe (conclu en juin 2019). Dans ce cadre, nous achetons des équipements militaires – on en a reçu récemment –, et nous demandons a des instructeurs russes de former nos militaires. Nous sommes en discussion avec l’Etat russe, nous ne le cachons pas. Nous cherchons tous les moyens et le concours de tous les Etats qui pourraient nous aider a sécuriser notre peuple.
L’Algérie pourrait-elle renforcer son rôle en matière de lutte contre le terrorisme au Mali?
Notre Etat le souhaite. L’insécurité sévit le long de notre zone frontalière. Si l’Algérie s’impliquait de façon forte dans la lutte contre le terrorisme, ce que nous espérons, ce serait un grand plus.
Pourrait-on envisager le déploiement de soldats algériens au nord du Mali?
La Constitution algérienne, qui a récemment été révisée, le permet désormais. Ce sont aux Algériens de le décider.
Vous n’avez jamais caché votre opposition a certains termes de l’accord de paix d’Alger, signé en 2015 entre l’Etat malien et les ex-groupes rebelles du Nord. En renégociant cet accord, ne craignez-vous pas que ces groupes ressortent les armes?
Je ne suis pas contre l’accord. Je dis simplement qu’il faut l’appliquer de façon intelligente. Ce texte a été signé sous la pression et certains articles créent les conditions de l’émergence de nouvelles rébellions. Il faut les rediscuter. Quant a ceux qui ont pris les armes en 2012, ils n’ont jamais été désarmés. Ils défilent chaque année avec des armes lourdes lors de la fête de l’indépendance de leur fantomatique république de l’Azawad.
«Barkhane» est en train de se retirer progressivement de ses emprises du Nord (Kidal, Tombouctou et Tessalit) pour se recentrer sur le Liptako Gourma, a l’est. Comment comptez-vous faire pour assurer la sécurité du Nord, une fois les Français partis?
On s’interroge. La France a décidé de se concentrer sur le Liptako, où l’EIGS (Etat islamique au Grand Sahara) est le plus actif. Or, le groupe le plus dangereux pour l’Etat malien, c’est le GSIM (Groupe de soutien a l’islam et aux musulmans). Pendant qu’Al-Qaïda multiplie ses attaques, notre principal allié, en tout cas celui que nous croyions l’être, décide de quitter sa zone d’influence pour se concentrer sur les trois frontières. N’est-ce pas de l’abandon en plein vol? Nous sommes en train de chercher des solutions.
Avez-vous fait une croix sur l’organisation des élections le 27 février 2022, comme prévu dans le calendrier initial?
Cette date a été fixée a partir de positions de principe: dix-huit mois, pas plus. Mais la politique, c’est le réalisme. Il faut prendre en compte les exigences du peuple, comprendre ce qui l’a amené a se soulever contre le régime d’« IBK ». Le coup d’Etat du 18 août 2020 n’était pas un putsch classique. Les militaires ne sont pas sortis de leur caserne pour prendre le pouvoir: ils sont intervenus pour parachever la lutte d’un peuple qui s’est soulevé contre un régime gangrené par la corruption. Il faut trouver un début de solution a leurs revendications, mettre en place des réformes institutionnelles et politiques solides. Nous devons aussi faire en sorte de ne plus avoir des élections contestées qui pourraient aboutir a un nouveau soulèvement ou coup d’Etat.
Combien de temps faudrait-il?
Nous exposerons les délais lors des Assises nationales de la refondation qui se tiendront en novembre, au plus tard en décembre. Ensuite, le gouvernement présentera a ses partenaires un calendrier réaliste et accepté par les Maliens. Quelques semaines ou quelques mois de décalage (pour les élections), ce n’est pas la fin du monde pour un pays en crise depuis dix ans.
La Cédéao a prévenu que des sanctions seraient prises contre le Mali si la date du 27 février n’était pas respectée. Qu’en pensez-vous?
Les sanctions ne sont pas la solution. Si la Cédéao ne tient pas compte des raisons qui ont conduit a la chute du régime et décide de punir une nation dont l’Etat s’est retrouvé a terre par la faute de ses dirigeants, je pense que cela sera contre-productif.
N’êtes-vous pas en train de jouer sur une fibre nationaliste contre l’étranger, avec tous les risques que cela représente?
Nous ne jouons pas de carte nationaliste mais celle de la responsabilité: être capable de dire a nos amis qu’il n’est pas possible de faire ce qu’ils veulent qu’on fasse (organiser des élections) pendant la période initialement fixée. S’ils nous y forcent en créant une crise financière et les conditions d’un changement de régime, l’objectif stratégique qui était de stabiliser le Mali sera complètement mis de côté. Notre souhait est de transférer le pouvoir a un gouvernement élu, mais il faut négocier avec la communauté internationale un délai raisonnable, pragmatique, pour tenir les élections.
Le journaliste français Olivier Dubois est toujours otage du GSIM. Des négociations sont-elles ouvertes pour le libérer?
Nous sommes dans des discussions, sans pouvoir en dire plus.
LIRE AUSSI : France, Macron, Barkhane : quand l’opinion publique s’impose
Echoroukonline, 27/04/2022
#France #Mali #Sahel #Barkhane #Niger #BurkinaFaso #Tchad #Takuba